 « La réalité c’est ce qui refuse de disparaître quand on a cessé d’y croire ».
« La réalité c’est ce qui refuse de disparaître quand on a cessé d’y croire ».
L’aphorisme de Philip K. Dick est au cœur des oeuvres de Catherine Ikam et Louis Fléri, artistes de la vidéo et de l’image numériques, qui font actuellement l’objet d’une exposition à la Maison européenne de la photographie.
Relations entre apparence et réalité, virtuel et humain, singularité et archétype : les travaux de Fléri et Ikam interrogent l’homme contemporain des nouvelles technologies – dont les possibilités paraissent quasi-infinies –, sur la question d’un rapport au réel fondamentalement remanié.
En concevant, en 1980, Fragments d’un archétype, où l’on voit l‘Etude des proportions du corps humain de Léonard de Vinci figuré par un homme filmé et découpé sur plusieurs écrans en une « sculpture » monumentale, Catherine Ikam fut la première à introduire la fragmentation dans l’art vidéo.
Avec Louis Fléri, elle crée désormais des personnages 100 % virtuels à partir de captures en trois dimensions.
La reproduction des expressions humaines est saisissante ; ils sont à la fois nous et autres, visages immenses et tristes venus de nulle part, auxquels il ne manque que ce trois fois rien, l’éclat de vie qui viendrait pétiller du fond des yeux …
Le visiteur est pourtant invité à intervenir dans cet univers électronique éthéré.
Ici, en bougeant devant Elle, gigantesque visage projeté sur le mur, il la verra réagir, le suivre du regard, tourner, incliner la tête … avant de repartir au fond d’elle-même avec une cruelle indifférence.
Là, avec Identité III, il s’assoit sur un tabouret et se voit fragmenté, le visage zoomé sous différents angles à travers une multitudes de caméras et d’écrans …
L’effet surprise est évident – on a du mal à se reconnaître bien qu’aucune transformation ne soit opérée – avant un rapide repli : difficile de se voir représenté « en oeuvre » …
Enfin, avec Digital Diaries, espace restitué en 3 D grâce à des lunettes, le public assiste à la projection de photos, fragments de vidéos et de lettres gravitant et s’avançant au premier plan, au gré du hasard, sur fond noir.
A l’aide d’un track ball, il peut modifier – imperceptiblement à dire vrai – leur trajectoire.
Cette création est peut-être la plus forte : presque hypnotique, elle évoque le processus involontaire de la mémoire, qui fait ressurgir tout à coup un visage, un mot, une scène de vie. Jaillissements du souvenir dans lesquels la volonté de l’homme intervient avec une relative impuissance.
Ces interactions avec le visiteur donnent du sens à ces propositions, mais inquiètent autant qu’elles rassurent.
Si l’homme est encore quelque peu le maître de la « machine », le miroir d’artifice et de stéréotype qu’elle lui tend vient troubler, sur fond obscur, sa propre représentation et l’idée de son devenir.
Digital Diaries. Catherine Ikam/Louis Fléri
Jusqu’au 3 juin 2007
Maison européenne de la photographie
5-7, rue de Fourcy – Paris 4ème
Du mercredi au dimanche de 11 h à 20 h
Entrée 6 € (TR 3 €), libre le mercredi à partir de 17 h
Image : Oscar (2005), Portrait interactif
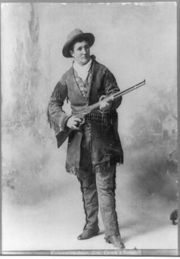 Femme de légende, Calamity Jane l’était, mais peut-être pas tout à fait celle qu’on a longtemps cru.
Femme de légende, Calamity Jane l’était, mais peut-être pas tout à fait celle qu’on a longtemps cru.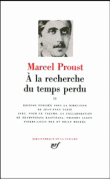 Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.
Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.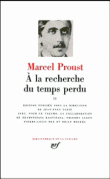 On sait à quel point le narrateur est attaché à sa grand’mère maternelle, qui est la délicatesse même.
On sait à quel point le narrateur est attaché à sa grand’mère maternelle, qui est la délicatesse même.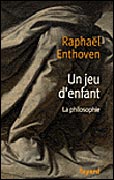 Contrairement à ce que son titre pourrait laisser supposer, Un jeu d’enfant La philosophie n’est pas un manuel de philosophie, une sorte de digest de Apprendre à vivre de Luc Ferry.
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser supposer, Un jeu d’enfant La philosophie n’est pas un manuel de philosophie, une sorte de digest de Apprendre à vivre de Luc Ferry. Tout au long de la saison, le théâtre du Rond-Point et France-Culture proposent des enregistrements publics d’émissions qui feront l’objet de diffusions dans la grille d’été de la station.
Tout au long de la saison, le théâtre du Rond-Point et France-Culture proposent des enregistrements publics d’émissions qui feront l’objet de diffusions dans la grille d’été de la station.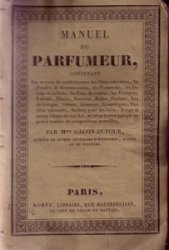 Au cours du XIX° siècle, période de la "deuxième révolution" du livre, la production connait un essor considérable et dans le même temps se renouvelle.
Au cours du XIX° siècle, période de la "deuxième révolution" du livre, la production connait un essor considérable et dans le même temps se renouvelle.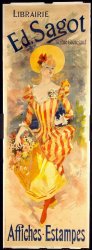 Production industrialisée, essor des tirages, évolution des contenus, apparition des "éditeurs", la révolution que connaît le livre au XIX° siècle se manifeste également dans de nouveaux modes de diffusions, de nouvelles techniques de vente.
Production industrialisée, essor des tirages, évolution des contenus, apparition des "éditeurs", la révolution que connaît le livre au XIX° siècle se manifeste également dans de nouveaux modes de diffusions, de nouvelles techniques de vente. Au XIXème siècle a lieu ce qu’on a l’habitude d’appeler la "deuxième révolution du livre", après celle de Gutemberg.
Au XIXème siècle a lieu ce qu’on a l’habitude d’appeler la "deuxième révolution du livre", après celle de Gutemberg. Dans un contexte d’industrialisation de la production du livre, de nouvelles personnalités font leur apparition : les éditeurs, autour desquels la production se réorganise.
Dans un contexte d’industrialisation de la production du livre, de nouvelles personnalités font leur apparition : les éditeurs, autour desquels la production se réorganise.