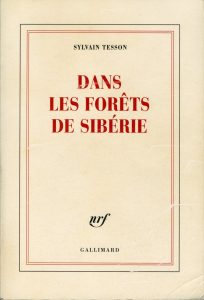 On a beaucoup aimé Les chemins noirs le dernier livre de Sylvain Tesson (sorti en 2016), dans lequel il raconte sa traversée à pied de la France, engagée à titre de thérapie physique et mentale après l’accident grave qu’il a subi. Un récit qui mériterait lui aussi un billet ici.
On a beaucoup aimé Les chemins noirs le dernier livre de Sylvain Tesson (sorti en 2016), dans lequel il raconte sa traversée à pied de la France, engagée à titre de thérapie physique et mentale après l’accident grave qu’il a subi. Un récit qui mériterait lui aussi un billet ici.
Dans les forêts de Sibérie, lui, a été publié en 2011 et a reçu le prix Médicis essai cette année-là. Voici de quoi il retourne. En 2010, de février à juillet, Sylvain Tesson a passé six mois seul dans une cabane en bois au bord du lac Baïkal et y a tenu un journal au jour le jour. Il tient en quelques 250 pages qui – assez étonnamment vu la monotonie apparente de sa villégiature – captivent totalement.
On le suit avec la curiosité du lecteur d’abord, puis – magie de l’écriture, talent de l’auteur – en épousant sans s’en rendre compte sa propre curiosité, pris par son attention au temps qu’il fait, au temps qui passe – si lentement bien souvent – aux bêtes (au début, il n’y a qu’un oiseau, seul ami sur place), à la chaleur de la cabane, refuge dans la glaciale taïga, à la végétation immobile, à l’évolution de la neige et des marbrures sur la glace du lac. Il y a aussi les ombles prises au bout de la cane et d’heures d’attentes, et les visites impromptues (une journée pour se remettre de ces irruptions venue crever la toile épaisse de la solitude). Le corps qui à débiter le bois se durcit, le teint qui s’éclaircit, les pensées qui ralentissent, le sens de l’observation qui se développe.
Les heures et les pages de lecture défilent, Tesson partage, cite romanciers, philosophes, poètes :
« Rainer Maria Rilke dans la lettre du 17 février 1903 adressée au jeune poète Franz Xaver Kappus : « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas. Accusez-vous vous-même de n’être pas assez poète pour attirer à vous ses richesses. » Et John Burroughs dans L’Art de voir les choses : « Le ton sur lequel nous parlons au monde est celui qu’il emploie avec nous. » ».
Moments d’abattement, ennui, hiver qui n’en finit pas, et puis, le 5 avril, par -23 ° : « Cette vie procure la paix. Non que toute envie s’éteigne en soi. La cabane n’est pas un arbre de l’Eveil bouddhique. La cabane resserre les ambitions aux proportions du possible. En rétrécissant la panoplie des actions, on augmente la profondeur de chaque expérience. La lecture, l’écriture, la pêche, l’ascension des versants, le patin, la flânerie dans les bois… l’existence se réduit à une quinzaine d’activités. Le naufragé jouit d’une liberté mais circonscrite aux limites de son îles. Au début des récits de robinsonnades, le héros tente de s’échapper en construisant une embarcation. Il est persuadé que tout est possible, que le bonheur se situe derrière l’horizon. Rejeté une nouvelle fois sur le rivage, il comprend qu’il ne s’échappera pas et, apaisé, découvre que la limitation est source de joie. On dit alors qu’il se résigne. Résigné, l’ermite ? Pas davantage que le citadin qui, hagard, saisit soudain sous les lampions du boulevard que sa vie ne lui suffira pas à goûter toutes les tentations de la fête. »
Quelques jours après, il explique pourquoi il tient un journal : « Tout ce qui me reste de ma vie ce sont les notes. J’écris un journal intime pour lutter contre l’oubli, offrir un supplétif à la mémoire. Si l’on ne tient pas le greffe de ses faits et gestes, à quoi bon vivre : les heures coulent, chaque jour s’efface et le néant triomphe. »
Son attrait pour l’érémitisme, que l’on retrouve dans Les chemins noirs, récit de la joie des chemins de traverse, il essaie de l’expliquer aussi : « Un ermite ne menace pas la société des hommes. Tout juste en incarne-t-il la critique. Le vagabond chaparde. Le rebelle appointé s’exprime à la télévision. L’anarchiste rêve de détruire la société dans laquelle il se fond. Le hacker aujourd’hui fomente l’écroulement de citadelles virtuelles depuis sa chambre. (…) Tous deux ont besoin de la société honnie. Elle constitue leur cible et la destruction de la cible est leur raison d’être. L’ermite se tient à l’écart, dans un refus poli. Il ressemble au convive qui, d’un geste doux, refuse le plat. Si la société disparaissait, l’ermite poursuivrait sa vie d’ermite. Les révoltés eux, se retrouveraient au chômage technique. L’ermite ne s’oppose pas, il épouse un mode de vie. Il ne dénonce pas un mensonge, il cherche une vérité. »
De ces Forêts de Sibérie, on a enfin envie de retenir ce passage, bien représentatif de la personnalité de Sylvain Tesson telle qu’elle ressort de ses journaux de bord aussi bien français que sibérien, un côté très attachant, pétri de questionnements, en perpétuels cheminement et recherche de réponses : « Ma présence ici, je la dois à ce jour de juillet, il y a sept ou huit ans, où je découvris les rives du Baïkal. L’impression inocula en moi la certitude que je reverrais ces lieux. A la manière de ces ésotéristes guénoniens obsédés par l’identification de « l’âge d’or », nous sommes quelques âmes nomades qui cherchons par tous les moyens à revivre les moments intenses de nos existences. Pour certains, ils se situent dans l’enfance, pour d’autres ils correspondent au premier baiser sous le pont de la départementale, pour d’autres encore à une sensation d’épanouissement inexplicable, un soir d’été, dans le crissement des cigales, pour d’autres enfin à une nuit d’hiver où auraient afflué de hautes et bonnes pensées. Pour moi c’était là, au bord du talus sablonneux ouvert sur le lac. »
Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson, Gallimard, 2011
Également en Folio