 Il y a trois ans, on avait beaucoup aimé, du même auteur, Comment vous racontez la partie vue dans ce même théâtre du Rond-Point à Paris. Le propos y était corrosif, la mise en scène efficace, le jeu des acteurs excellent.
Il y a trois ans, on avait beaucoup aimé, du même auteur, Comment vous racontez la partie vue dans ce même théâtre du Rond-Point à Paris. Le propos y était corrosif, la mise en scène efficace, le jeu des acteurs excellent.
Sur un thème fort différent, ces trois ingrédients de réussite sont à nouveau réunis dans cette nouvelle mise en scène par la célèbre dramaturge de l’une de ses propres pièces. Le cadre reste la province et, si on a quitté le milieu culturo-médiatique de Comment vous racontez…, Yasmina Reza nous invite une fois de plus à examiner les relations sociales. Mais ici, pas de chocs de milieux, on est dans la même marmite. Et ça bout, du début à la fin.
La situation de départ est des plus triviales : un couple illégitime s’engueule sur un parking, lui petit entrepreneur aux manières plutôt goujates, elle préparatrice en pharmacie un brin hystérique perchée sur talons vermillons, le tout « au cul » d’une voiture de sport vulgaire. Mais très vite, l’irruption accidentelle (c’est le moins qu’on puisse dire) de trois autres personnages va permettre de dépasser cette entame vaudevillesque pour dévoiler un tableau que l’auteur des Dieux du carnage excelle toujours à brosser : celui de ces petites misères humaines que la vie en société nous oblige en temps ordinaire à dissimuler.
Pour procéder à cette entreprise, Yasmina a une arme fatale : le personnage d’Andrea, très brillamment interprété par Emmanuelle Devos, aussi douée sur les planches que sur grand écran. C’est elle qui dérange, d’abord son amant Boris (parfait Louis-Do de Lencquesaing), puis les amis de celui-ci (interprétés tout aussi bien par Micha Lescot et Camille Japy). Tous, sauf la vieille mère Yvonne (délicieuse Josiane Stoléru), la pressent sans cesse de sortir, sans jamais y parvenir. Elle parle trop et trop fort, rit et s’enthousiasme de même. Exubérante, inconvenante, Andrea dit ce qui ne se dit pas et fait ce qui ne fait pas. Sans compter son statut de maîtresse, qui est tour à tour objet d’attraction pour le parfum de liberté qu’elle répand et de condamnation pour la trahison qu’elle incarne.
 Autour d’elle, dans une atmosphère devenue étouffante et tendue à l’extrême, chacun des personnages sent le sol tanguer sous ses pieds, Boris-le-sans-vaillance vacille sous la menace d’une liquidation judiciaire, Yvonne la veuve a toujours peur d’avoir perdu son sac devenu, avec son petit calepin dedans, son (seul) compagnon. Quant au couple d’amis, il finit par céder aussi, abandonnant son souci du prochain et sa bien-séance de bon aloi, remuant la vieille mère, jetant le dessert du grand restaurant, se dessoudant un instant… La Bella figura finit par craquer de toute part. Seule Andrea, assurément la plus esseulée de tous, parvient, grâce à son apparence de légèreté et de fantaisie, à continuer à faire Belle figura. Et apparaît en définitive comme la plus lucide de tous.
Autour d’elle, dans une atmosphère devenue étouffante et tendue à l’extrême, chacun des personnages sent le sol tanguer sous ses pieds, Boris-le-sans-vaillance vacille sous la menace d’une liquidation judiciaire, Yvonne la veuve a toujours peur d’avoir perdu son sac devenu, avec son petit calepin dedans, son (seul) compagnon. Quant au couple d’amis, il finit par céder aussi, abandonnant son souci du prochain et sa bien-séance de bon aloi, remuant la vieille mère, jetant le dessert du grand restaurant, se dessoudant un instant… La Bella figura finit par craquer de toute part. Seule Andrea, assurément la plus esseulée de tous, parvient, grâce à son apparence de légèreté et de fantaisie, à continuer à faire Belle figura. Et apparaît en définitive comme la plus lucide de tous.
Belle figura, à voir au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 31 décembre 2017
A 21h du mardi au samedi, à 15 h le dimanche – durée 1h30
Une pièce écrite et mise en scène par Yasmina Reza, avec Emmanuelle Devos, Josiane Stoléru, Camille Japy, Louis-Do de Lencquesaing, Micha Lescot



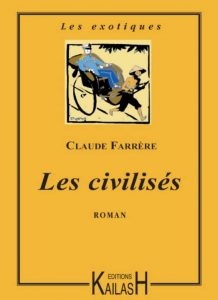 Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.
Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.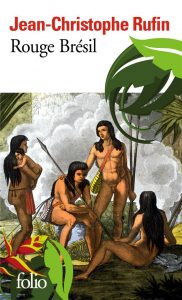 Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant.
Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant. Un livre fort que ce prix Goncourt 1996. Dans le genre plutôt court, après une lecture sans pause, il laisse le sentiment que tout est encore à comprendre dans la fascination de la narratrice pour le pilote kamikaze Tsurukawa.
Un livre fort que ce prix Goncourt 1996. Dans le genre plutôt court, après une lecture sans pause, il laisse le sentiment que tout est encore à comprendre dans la fascination de la narratrice pour le pilote kamikaze Tsurukawa. Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.
Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème. Bien sûr, il nous faut accepter de lire ce français étrange, image de l’acadien du XVIIIème siècle, qui fait toute la saveur du Goncourt 1979, si on veut en apprécier toute la richesse. Il faudra renoncer à comprendre tous les mots tout de suite, et patienter en comptant sur la répétition pour saisir le sens de « bâsir », « devanteau » ou « dumeshui ». La plupart de ces mots toutefois se laisse découvrir aisément (« asteur », « obstineux », « défricheter »).
Bien sûr, il nous faut accepter de lire ce français étrange, image de l’acadien du XVIIIème siècle, qui fait toute la saveur du Goncourt 1979, si on veut en apprécier toute la richesse. Il faudra renoncer à comprendre tous les mots tout de suite, et patienter en comptant sur la répétition pour saisir le sens de « bâsir », « devanteau » ou « dumeshui ». La plupart de ces mots toutefois se laisse découvrir aisément (« asteur », « obstineux », « défricheter »). C’est dans la tête de Sigismond Pons que se passe presque toute l’action de ce roman prix Goncourt 1967. Sigismond déambule dans le quartier « des putes » de Barcelone, durant quarante huit heures, a une relation avec l’une d’entre elles, entre dans les bars, restaurants, lieux de prostitution, qu’il nous décrit avec beaucoup de détails.
C’est dans la tête de Sigismond Pons que se passe presque toute l’action de ce roman prix Goncourt 1967. Sigismond déambule dans le quartier « des putes » de Barcelone, durant quarante huit heures, a une relation avec l’une d’entre elles, entre dans les bars, restaurants, lieux de prostitution, qu’il nous décrit avec beaucoup de détails.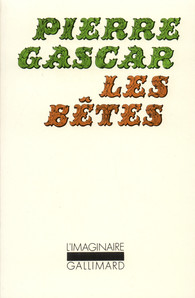 Le Goncourt 1953 n’est pas un roman mais un recueil de six histoires qui ont pour point commun des relations entre hommes et animaux. Le propos est explicite dans les toutes dernières pages du livre : « A chaque instant la bête peut changer : nous sommes à la lisière. Il y le cheval dément, le mouton rage, le rat savant, l’ours impavide, sortes d’états seconds qui nous ouvrent l’enfer animal et où nous retrouvons, dans l’étonnement de la fraternité, notre propre face tourmentée, comme dans un miroir griffu ».
Le Goncourt 1953 n’est pas un roman mais un recueil de six histoires qui ont pour point commun des relations entre hommes et animaux. Le propos est explicite dans les toutes dernières pages du livre : « A chaque instant la bête peut changer : nous sommes à la lisière. Il y le cheval dément, le mouton rage, le rat savant, l’ours impavide, sortes d’états seconds qui nous ouvrent l’enfer animal et où nous retrouvons, dans l’étonnement de la fraternité, notre propre face tourmentée, comme dans un miroir griffu ». Merci Jean-Yves de nous faire partager cette soirée unique !
Merci Jean-Yves de nous faire partager cette soirée unique !