 Si vous vous interrogez sur les questions essentielles de l’existence, demandez à un moine, il vous prêtera des films qui vous aideront. Si vous apprenez que vous êtes le père d’un enfant conçu par hasard dans la douceur d’une serre, allez planter une rare rose dite à huit pétales dans un jardin à des milliers de kilomètres de chez vous. Si vous venez de perdre votre mère, à 22 ans, essayez de vous rappeler comment elle réussissait la soupe au flétan, ça peut servir à votre père.
Si vous vous interrogez sur les questions essentielles de l’existence, demandez à un moine, il vous prêtera des films qui vous aideront. Si vous apprenez que vous êtes le père d’un enfant conçu par hasard dans la douceur d’une serre, allez planter une rare rose dite à huit pétales dans un jardin à des milliers de kilomètres de chez vous. Si vous venez de perdre votre mère, à 22 ans, essayez de vous rappeler comment elle réussissait la soupe au flétan, ça peut servir à votre père.
Mais surtout, si la mère de votre enfant, relation d’un quart de nuit, vous rejoint pour vous faire garder Flora-Sol pendant qu’elle rédige son mémoire de génétique, attendez-vous à craquer complètement : d’abord pour l’enfant, car ce n’est pas forcément le parent qui fait l’enfant, mais l’enfant qui fait le parent ; ensuite pour la mère, car ce n’est pas le désir de vivre ensemble qui fait le couple, mais le couple qui construit la relation amoureuse.
Audur Ava Ólafsdóttir, romancière Islandaise, aime prendre à rebours les pensées les plus communes. Mais elle le fait avec une telle tranquillité, une telle évidence, avec une naïveté si désarmante (et sans nul doute fausse) que nous sommes (nous, les milliers de lectrices et lecteurs) proprement embarqués dans ce récit qui, s’il ne nous dit pas les noms des lieux, nous parle du mystère des relations entre humains, que l’on vive dans le froid d’une île nordique ou dans la douceur méditerranéenne.
Un des charmes du livre tient peut-être à ce paradoxe : c’est une femme qui fait parler, penser, réagir un jeune homme, car c’est lui le narrateur. Elle lui donne des compétences acquises grâce à sa mère, comme palper le tissu pour distinguer dralon et mousseline, ou l’amour des plantes, et des roses en particulier. Contagion des genres… Mais par ailleurs, le personnage le moins connu du roman, et aussi très attachant, est la jeune Anna, nouvelle mère et future généticienne. Comme s’il était plus facile, pour la romancière, d’imaginer ce que peut être un garçon d’aujourd’hui que de rendre compte de la complexité de la situation d’une jeune femme, dans ses rapports à un homme, à l’enfant, à son devenir professionnel. D’un côté, un père attaché à son jardin et à son enfant, dont on a suivi l’évolution logique, de l’autre une jeune femme face à un avenir ouvert, dont on ne peut que deviner les désirs : décidemment, Audur Ava Ólafsdóttir nous a bien embarqués.
Rosa Candida
Audur Ava Ólafsdóttir
Zulma (2010)
336 pages, 20 €
 Une digne héritière des Borgia voudrait régner sur le monde en cette fin du XVIe siècle. Elle se nomme Fausta et manigance, assassine, capture, torture sans aucun complexe. Le moyen d’arriver à ses fins : prendre le pouvoir dans l’institution où les femmes sont le plus exclues, la papauté. Fausta sera Papesse ou ne sera rien.
Une digne héritière des Borgia voudrait régner sur le monde en cette fin du XVIe siècle. Elle se nomme Fausta et manigance, assassine, capture, torture sans aucun complexe. Le moyen d’arriver à ses fins : prendre le pouvoir dans l’institution où les femmes sont le plus exclues, la papauté. Fausta sera Papesse ou ne sera rien.
 Le décrottoir, ici, est fiché dans le mur, à droite ou à gauche de l’entrée, parfois un de chaque côté, à quelques 15 ou 20 centimètres du sol. On grattait ses chaussures face au mur, alors que dans d’autres villes ce pouvait être fait en parallèle, parfois sur l’instrument planté dans le sol. Dans un premier temps, les décrottoirs paraissent assez divers dans leur forme. En fait, l’observation attentive permet de s’apercevoir que beaucoup ont perdu une partie de leur état d’origine au point de les rendre méconnaissables. Ils ont beaucoup souffert du vandalisme automobile, lorsqu’à l’époque de la reine Voiture ils ont été écrasés sous les roues et les pare-chocs des véhicules envahissant les trottoirs. La remontée du niveau du sol a pu les noyer à demi dans le bitume ou le pavage. La restauration des façades, quand elle n’a pas provoqué l’enlèvement de l’objet gênant, l’a parfois arrosé de crépi.
Le décrottoir, ici, est fiché dans le mur, à droite ou à gauche de l’entrée, parfois un de chaque côté, à quelques 15 ou 20 centimètres du sol. On grattait ses chaussures face au mur, alors que dans d’autres villes ce pouvait être fait en parallèle, parfois sur l’instrument planté dans le sol. Dans un premier temps, les décrottoirs paraissent assez divers dans leur forme. En fait, l’observation attentive permet de s’apercevoir que beaucoup ont perdu une partie de leur état d’origine au point de les rendre méconnaissables. Ils ont beaucoup souffert du vandalisme automobile, lorsqu’à l’époque de la reine Voiture ils ont été écrasés sous les roues et les pare-chocs des véhicules envahissant les trottoirs. La remontée du niveau du sol a pu les noyer à demi dans le bitume ou le pavage. La restauration des façades, quand elle n’a pas provoqué l’enlèvement de l’objet gênant, l’a parfois arrosé de crépi. Si on en détermine l’architecture principale, on peut recomposer le type initial. Trois sont particulièrement fréquents. A défaut de connaître leur dénomination à l’époque de leur scellement, on inventera ici une typologie :
Si on en détermine l’architecture principale, on peut recomposer le type initial. Trois sont particulièrement fréquents. A défaut de connaître leur dénomination à l’époque de leur scellement, on inventera ici une typologie :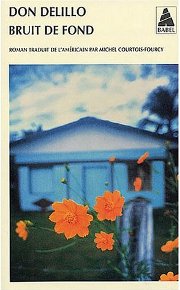 La vie quotidienne est faite de petits bonheurs et de petits soucis. Celle qui est décrite par Delillo dans les années 80 est américaine, concerne une famille habile à faire vivre ensemble des enfants issus de plusieurs couples précédents. Dans cette ambiance très animée les bruits de fond sont nombreux : les images et les voix de la télé, qui peuvent surgir à tout moment, les gestes de la consommation, qui aident bien à pousser aujourd’hui pour arriver à demain.
La vie quotidienne est faite de petits bonheurs et de petits soucis. Celle qui est décrite par Delillo dans les années 80 est américaine, concerne une famille habile à faire vivre ensemble des enfants issus de plusieurs couples précédents. Dans cette ambiance très animée les bruits de fond sont nombreux : les images et les voix de la télé, qui peuvent surgir à tout moment, les gestes de la consommation, qui aident bien à pousser aujourd’hui pour arriver à demain.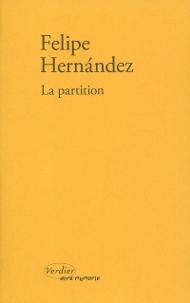 La frontière entre désir et folie peut être bien ténue.
La frontière entre désir et folie peut être bien ténue. Après l’univers des grottes évoquées (voire reconstituées) par l’art au
Après l’univers des grottes évoquées (voire reconstituées) par l’art au  Charley Case et Thomas Israel ont assimilé un des caractères de la peinture paléolithique : son apparence mouvante, lorsque la figure, qui a profité des reliefs de la paroi, semble bouger à la lumière vacillante des torches. Ici, point de torches, mais une vidéo intègre astucieusement dans le creux de la roche l’image d’une femme qui donne la vie. Sur une surface plus plane, passe une femme nageant. Une belle réussite. On retrouve dans un coin de la « salle des chamans » le travail de Serge Pey avec ses bâtons de mots et ses dessins à la craie. Les trois squelettes d’ours des cavernes de Mark Dion surgissent grâce à leur peinture fluo et Virginie Yassef nous fait vivre l’orage tellurique juste avant de revenir à la lumière du jour.
Charley Case et Thomas Israel ont assimilé un des caractères de la peinture paléolithique : son apparence mouvante, lorsque la figure, qui a profité des reliefs de la paroi, semble bouger à la lumière vacillante des torches. Ici, point de torches, mais une vidéo intègre astucieusement dans le creux de la roche l’image d’une femme qui donne la vie. Sur une surface plus plane, passe une femme nageant. Une belle réussite. On retrouve dans un coin de la « salle des chamans » le travail de Serge Pey avec ses bâtons de mots et ses dessins à la craie. Les trois squelettes d’ours des cavernes de Mark Dion surgissent grâce à leur peinture fluo et Virginie Yassef nous fait vivre l’orage tellurique juste avant de revenir à la lumière du jour.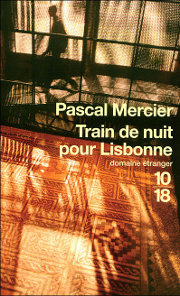 Un livre peut-il changer le cours de la vie ? Assurément oui pour Raimond Gregorius, professeur de littérature ancienne, proche de la soixantaine, qui découvre dans une librairie la phrase : « S’il est vrai que nous ne pouvons vivre qu’une petite partie de ce qui est en nous –qu’advient-il du reste ? ».
Un livre peut-il changer le cours de la vie ? Assurément oui pour Raimond Gregorius, professeur de littérature ancienne, proche de la soixantaine, qui découvre dans une librairie la phrase : « S’il est vrai que nous ne pouvons vivre qu’une petite partie de ce qui est en nous –qu’advient-il du reste ? ». On peut commencer la visite par entrer dans la grotte de Xavier Veilhan.
On peut commencer la visite par entrer dans la grotte de Xavier Veilhan. L’étonnement tient d’abord à l’architecture de Frank O. Gehry : certaines photos peuvent faire croire à un monstre de métal.
L’étonnement tient d’abord à l’architecture de Frank O. Gehry : certaines photos peuvent faire croire à un monstre de métal. Les expositions temporaires nous proposent des œuvres de Cai Guo-Qiang, artiste chinois connu pour ses feux d’artifice déployés au cours de la cérémonie d’inauguration des derniers Jeux olympiques, et de Takashi Murakami, peintre Japonais représentant de la génération néo-pop. Seules certaines œuvres du premier nous ont arrêté.
Les expositions temporaires nous proposent des œuvres de Cai Guo-Qiang, artiste chinois connu pour ses feux d’artifice déployés au cours de la cérémonie d’inauguration des derniers Jeux olympiques, et de Takashi Murakami, peintre Japonais représentant de la génération néo-pop. Seules certaines œuvres du premier nous ont arrêté. Ce sont celles qui témoignent d’un autre registre, celui de la longue durée, qui provoquent davantage de méditation. « De plein fouet » : 99 loups se précipitent en un grand bond contre une paroi vitrée, en ressortent plus ou moins assommés, et repartent, à terre, d’où ils viennent. Si les 99 loups sont figés dans leur mouvement, l’ensemble est perçu comme dynamique, et on entend presque le choc contre le verre.
Ce sont celles qui témoignent d’un autre registre, celui de la longue durée, qui provoquent davantage de méditation. « De plein fouet » : 99 loups se précipitent en un grand bond contre une paroi vitrée, en ressortent plus ou moins assommés, et repartent, à terre, d’où ils viennent. Si les 99 loups sont figés dans leur mouvement, l’ensemble est perçu comme dynamique, et on entend presque le choc contre le verre.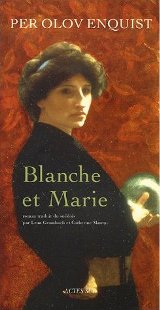 Dans le cœur du roman, on trouve ces deux phrases : « Pas non plus comme l’amour de Blanche pour Charcot, qui est en réalité le sujet que le Livre des Questions déclare traiter. Ce "en réalité" ! ».
Dans le cœur du roman, on trouve ces deux phrases : « Pas non plus comme l’amour de Blanche pour Charcot, qui est en réalité le sujet que le Livre des Questions déclare traiter. Ce "en réalité" ! ».