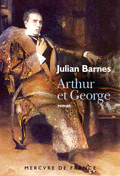 Arthur est le roi de l’enquête policière, par l’intermédiaire du héros qui l’a rendu célèbre : Sherlock Holmes.
Arthur est le roi de l’enquête policière, par l’intermédiaire du héros qui l’a rendu célèbre : Sherlock Holmes.
George vient d’être libéré, sans raison officielle, après trois années passées en prison sur les sept qu’on lui avait promis. Arthur Conan Doyle lit le dossier sur le cas de George Edalji et est immédiatement convaincu que le jeune avoué condamné « pour avoir grièvement blessé un cheval » ne peut pas être coupable.
Le livre est l’histoire de la rencontre entre ces deux hommes si différents l’un de l’autre. Les biographies se construisent d’abord peu à peu, en parallèle.
L’Angleterre de la fin du XIXème siècle nous est décrite du point de vue d’un village rural, dans la famille d’un pasteur d’origine indienne marié à une écossaise, et du point de vue de la classe urbaine aisée, dont les membres peuvent à la fois adhérer à l’esprit scientifique (Conan Doyle était médecin) et aux croyances spirites.
Arthur rencontre George et est encore davantage convaincu de l’erreur judiciaire : « non, je ne pense pas que vous êtes innocent ; non je ne crois pas que vous êtes innocent ; je sais que vous êtes innocent ». Et le père de Sherlock Holmes part en enquête sur le terrain. Il veut comprendre comment la machine policière puis la machine judiciaire ont pu produire une telle bévue.
Si nous avons l’impression de lire un polar, nous sommes en fait dans le récit d’une histoire minutieusement reconstituée d’après les documents de l’époque : George Edalji a bel et bien existé, Conan Doyle a effectivement pris sa défense.
Mais c’est aussi l’occasion pour Julian Barnes de faire le portrait d’un Arthur très attachant, pris dans de belles histoires d’amour, auteur prisonnier de son héros (il a dû ressusciter Sherlock sur la pression de ses lecteurs), animateur enthousiaste de sociétés spirites.
Mais l’hypothèse centrale du livre est très finement travaillée : pour Conan Doyle, c’est le racisme qui est à la base de toute l’affaire. Dans une Angleterre qui affichait haut et fort le respect pour ses minorités, il devenait impossible de démontrer « l’acte » raciste, même si souterrainement le sentiment anti étranger œuvrait. C’est la victime même qui ne peut croire à cette thèse, comme George veut le dire à Arthur : « Je ne suis pas assez naïf pour ne pas me rendre compte que certaines personnes me regardent différemment. Mais je suis un homme de loi, sir Arthur. Quelle preuve ai-je qu’on a agi contre moi à cause d’un préjugé racial ? Le brigadier Upton essayait de me faire peur, mais il rudoyait sûrement d’autres garçons aussi. Le capitaine Anson m’a pris manifestement en grippe, sans m’avoir jamais rencontré. Ce qui m’inquiétait davantage au sujet de la police c’était son incompétence ».
Un gros roman qui emplit de bonnes heures d’existence par l’impression qu’il nous laisse d’ouvrage « total », dans lequel individu et société se comprennent l’un par l’autre.
Arthur et George. Julian Barnes
Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Aoustin
552 p., 24,40 €
Mercure de France (2007)
 Quelques mètres plus bas, les vagues grimpent sur les rochers, faits d’un granit qui paraît bien solide.
Quelques mètres plus bas, les vagues grimpent sur les rochers, faits d’un granit qui paraît bien solide.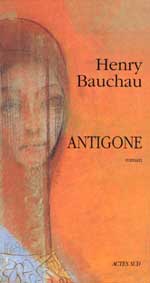 Depuis la mise en place de l’histoire et des personnages par Sophocle, on a connu beaucoup de versions d’Antigone. Elles ont été essentiellement été écrites pour le théâtre. Et voilà qu’un auteur, peu connu jusqu’alors malgré ses romans, ses recueils de poèmes, ses pièces de théâtre (et même sa biographie de Mao Zedong !), publie il y a dix ans un Antigone roman.
Depuis la mise en place de l’histoire et des personnages par Sophocle, on a connu beaucoup de versions d’Antigone. Elles ont été essentiellement été écrites pour le théâtre. Et voilà qu’un auteur, peu connu jusqu’alors malgré ses romans, ses recueils de poèmes, ses pièces de théâtre (et même sa biographie de Mao Zedong !), publie il y a dix ans un Antigone roman. En cheminant, dans l’ordre chronologique, devant les dessins et peintures présentés au musée Paul Dupuy sous le thème « Les Pyrénées des peintres », nous avons incontestablement le sentiment de nous élever peu à peu vers les sommets.
En cheminant, dans l’ordre chronologique, devant les dessins et peintures présentés au musée Paul Dupuy sous le thème « Les Pyrénées des peintres », nous avons incontestablement le sentiment de nous élever peu à peu vers les sommets.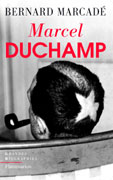 Marcel Duchamp est-il seulement celui qui renversa une pissotière pour en faire une fontaine ?
Marcel Duchamp est-il seulement celui qui renversa une pissotière pour en faire une fontaine ? Le musée Fenaille est au cœur de la ville, et il faut monter au dernier étage du bâtiment pour découvrir le trésor du musée : 17 statues-menhirs, bien plantées dans le sol, et certaines de belle taille (2 mètres).
Le musée Fenaille est au cœur de la ville, et il faut monter au dernier étage du bâtiment pour découvrir le trésor du musée : 17 statues-menhirs, bien plantées dans le sol, et certaines de belle taille (2 mètres).