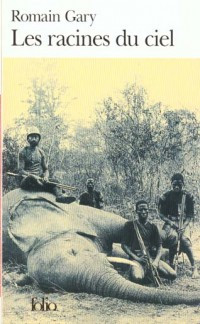Revoici un billet maglm, avec le 21ème épisode des Goncourt. Cette semaine : Pascal Quignard ! Merci à Andreossi pour ce très beau billet !
Revoici un billet maglm, avec le 21ème épisode des Goncourt. Cette semaine : Pascal Quignard ! Merci à Andreossi pour ce très beau billet !
Mag
PS : et si vous aussi affectionnez cet auteur singulier et passionnant, n’hésitez pas à lire les billets sur deux autres des écrits de Pascal Quignard : Inter et Triomphe du temps.
Le prix Goncourt 2002 n’est pas un roman. « Les ombres errantes » est un livre composé d’un ensemble de réflexions (quelquefois développées par de petits contes), dispersées en cinquante- cinq chapitres. Le volume est le premier de la série nommée « Dernier royaume ». Pourquoi ces titres ? L’auteur s’en explique : « A Paris Richelieu fit venir son luthiste et lui demanda d’interpréter la chaconne intitulée Le dernier Royaume. Puis il joua les Ombres qui errent, pièce dont François Couperin reprit le thème principal sous le nom Ombres errantes dans son dernier livre pour clavecin ».
La phrase citée est exemplaire des œuvres (lorsqu’elles ne sont pas des romans) de cet auteur : érudition, histoires du passé, et… incertitude sur la véracité historique de ce qui nous est conté. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans la littérature et non dans l’histoire, aussi ce jeu avec le passé constitue l’intérêt même de ses livres, et lorsque nous sont racontées de « belles histoires », la question de l’authenticité ne se pose plus.
Nous lisons donc des variations sur ce thème des ombres, manifestations discrètes du monde qui intéresse Pascal Quignard, pour lequel l’obstacle majeur à la visibilité des événements premiers sont les images. Il s’appuie, pour suggérer la présence de ses ombres qui errent, sur le corpus dans lequel il a l’habitude de puiser : « Le passé, les tombes, la mémoire, les histoires, les langues anciennes, les livres qui furent rédigés autrefois, les traditions religieuses, politiques, artistiques, individuelles, qui furent délaissées, arrachés à l’entrain légendaire qui les avait mis les uns après les autres au jour, sont à jamais disjoints du réel ».
Ce travail pour faire approcher un univers dont les apparitions sont fugaces, qui est resté à l’écart du projet moderne, aussi éloigné que possible des thèses du progrès, l’écriture peut le réaliser : « Eprouver en pensant ce qui cherche à se dire avant même de connaître, c’est sans doute cela, le mouvement d’écrire ». L’explicite, la conscience, la clarté de l’image, autant de moyens qui ne permettent pas d’accéder au sens.
On a le sentiment que domine finalement le regret de la naissance, autant individuelle que celle de l’humanité, dans la nostalgie d’un jadis antérieur à la présence humaine : « Une espèce d’empire social et violent, technique, de grande amplitude, de longue durée, bavard, plein de déchets et de ruines, né de l’imitation des animaux pourchassés et de l’observation puis de la mise à contribution des phénomènes de la nature, s’est substituée peu à peu au règne biologique, erratique, de petite amplitude, immédiat, presque autonettoyant des espèces végétales et animales sur la terre ».
Si le paradis perdu est celui de la nature, et si un écrivain se consacre à révéler quelques traces de la vie humaine dont le souvenir est tout de même à conserver, faisons profit de rêveries avec lui.
Andreossi
Les ombres errantes, Pascal Quignard (Gallimard)
 Le feuilleton des prix Goncourt : c’est reparti ! Andreossi nous en livre cette semaine le 20ème épisode. Vous laisserez-vous tenter, ne serait-ce que pour échapper à la déferlante de la rentrée littéraire ? … Bonne lecture et à bientôt !
Le feuilleton des prix Goncourt : c’est reparti ! Andreossi nous en livre cette semaine le 20ème épisode. Vous laisserez-vous tenter, ne serait-ce que pour échapper à la déferlante de la rentrée littéraire ? … Bonne lecture et à bientôt !
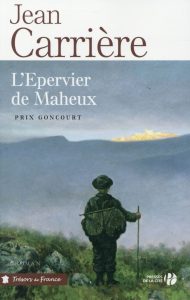 Andreossi nous livre le 18ème épisode du feuilleton des Goncourt, avec le prix 1972… Du rural, du rude… Bonne lecture ! Mag
Andreossi nous livre le 18ème épisode du feuilleton des Goncourt, avec le prix 1972… Du rural, du rude… Bonne lecture ! Mag Après plusieurs livraisons fort séduisantes, voici la recension du Prix Goncourt 1964 : un cru plutôt faible selon Andreossi… On attend le prochain !
Après plusieurs livraisons fort séduisantes, voici la recension du Prix Goncourt 1964 : un cru plutôt faible selon Andreossi… On attend le prochain ! Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture !
Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture ! 15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag
15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag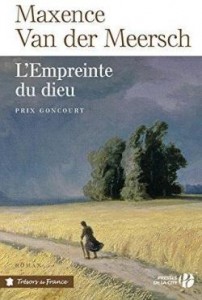 « L’empreinte du dieu », prix Goncourt 36, a inspiré Andreossi. Un billet qui donne bien envie d’aller y voir de plus près… Bonne lecture !
« L’empreinte du dieu », prix Goncourt 36, a inspiré Andreossi. Un billet qui donne bien envie d’aller y voir de plus près… Bonne lecture !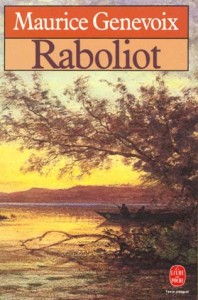 Voici la 13ème livraison du feuilleton des Prix Goncourt signé Andreossi. Il nous emmène cette fois à la campagne… il y a près d’un siècle. Bonne (re)découverte ! Mag
Voici la 13ème livraison du feuilleton des Prix Goncourt signé Andreossi. Il nous emmène cette fois à la campagne… il y a près d’un siècle. Bonne (re)découverte ! Mag