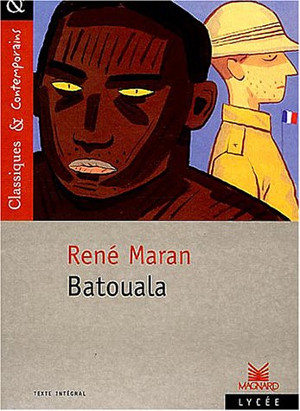 Aujourd’hui, deuxième épisode du feuilleton littéraire, signé Andreossi, sur les prix Goncourt, avec le cru 1921. Pour du cru, c’est du cru.
Aujourd’hui, deuxième épisode du feuilleton littéraire, signé Andreossi, sur les prix Goncourt, avec le cru 1921. Pour du cru, c’est du cru.
Étonnant roman, prix Goncourt 1921, qui met en scène un chef Africain dans sa vie quotidienne sous la colonisation française. Réputé comme premier roman de la « négritude », il apparaît aujourd’hui comme l’exemple de l’intérêt des jurés du Goncourt pour les questions de société, en promouvant parfois une littérature qui peut faire débat. De ce point de vue, c’est une réussite à plusieurs titres.
Si l’écrivain René Maran a été honoré par le prix dès son premier roman, l’administrateur des colonies en Oubangui qu’il était aussi a dû démissionner de son poste à la suite d’une campagne de presse agressive. Le livre a décidé de sa carrière d’écrivain, par rejet d’une administration sanctionnant un Noir (il était Martiniquais) osant écrire une vive critique (en particulier dans la préface) de la colonisation.
Pourtant, il s’agit de littérature avant tout et non de l’exposition d’idées. Comme il l’exprime dans sa préface, l’auteur se borne à constater, à enregistrer, en puisant dans les propos qu’il a entendu au cours de ses missions. Il reproduit beaucoup du vocabulaire local, surtout celui qui touche à l’environnement naturel, ce qui inscrit efficacement le récit dans un cadre original, et accentue l’impression que le narrateur est quelqu’un du pays plutôt qu’un colon. Dès les premières lignes nous sommes du côté des Noirs.
La trame de l’intrigue est mince (la rivalité entre Batouala et Bissibi’ngui pour l’amour de Yassigui’ndja) et ne constitue pas le plus grand intérêt du récit. Mais la forme d’écriture qui réussit à présenter à la fois le rôle des Blancs du point de vue des colonisés et les rites qui paraissent cruels aux yeux des colons est très efficace. Dans le premier registre la condamnation du colonialisme est sans appel : « Nous ne sommes que des chairs à impôts. Nous ne sommes que des bêtes de portage. Des bêtes ? Même pas. Un chien ? Ils le nourrissent, et soignent leur cheval. Nous ? Nous sommes, pour eux, moins que ces animaux, nous sommes plus bas que les plus bas. Ils nous crèvent lentement ».
Du côté du rituel, le lecteur a droit à une description de l’excision horrifiante dans son cynisme : « La vieille arrivait, interpellait l’une des danseuses, lui écartait rudement les cuisses, saisissait à pleins doigts ce qu’il fallait saisir, l’étirait à la manière d’une liane à caoutchouc et, d’un seul coup –raou !- le tranchait, puis, sans même retourner la tête, jetait derrière elle, à la volée, ces morceaux de chair chaude et sanglante, qui parfois atteignaient quelqu’un au visage. Quelle importance ces chairs pouvaient-elles avoir ? A peine tombées à terre, les chiens se les disputaient, en rognonnant ».
Mieux que de long discours ces phrases disent beaucoup sur la rencontre entre l’Afrique et ses colons.
Batouala, René Maran
Magnard, 2002
Andreossi
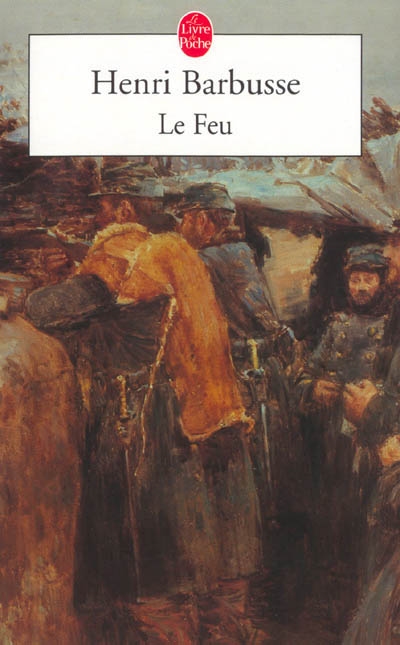
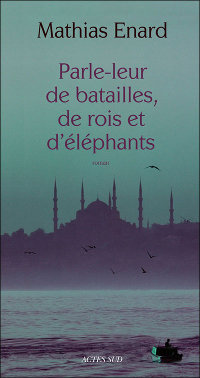 A l’heure où les prix littéraires tombent comme les feuilles arrachées par le vent de novembre, où l’on voit le jury du Goncourt récompenser l’auteur de sinistres romans, et applaudi en ce sens par des pelletés d’émerveillés, croyant découvrir le monde contemporain à travers l’œuvre de leur gourou atrabilaire, avec une complaisance pour son cynisme assez inquiétante, le temps et le besoin de lecture sont plus que jamais de saison.
A l’heure où les prix littéraires tombent comme les feuilles arrachées par le vent de novembre, où l’on voit le jury du Goncourt récompenser l’auteur de sinistres romans, et applaudi en ce sens par des pelletés d’émerveillés, croyant découvrir le monde contemporain à travers l’œuvre de leur gourou atrabilaire, avec une complaisance pour son cynisme assez inquiétante, le temps et le besoin de lecture sont plus que jamais de saison.