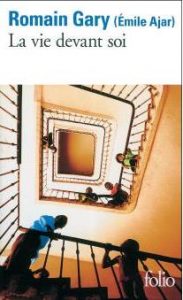 Phénomène unique dans l’histoire du prix Goncourt, Romain Gary, après Les Racines du ciel en 1956, a été à nouveau couronné en 1975, sous le nom d’Emile Ajar. Certes cela contrevenait aux règles de l’institution, et on peut évaluer aujourd’hui l’affaire comme un jeu malicieux de Gary avec la critique. On peut penser aussi que c’est Momo qui a dicté à Ajar, Gary ou Roman Kacew (nom d’origine de l’auteur) ce magnifique livre à la lecture tellement jubilatoire.
Phénomène unique dans l’histoire du prix Goncourt, Romain Gary, après Les Racines du ciel en 1956, a été à nouveau couronné en 1975, sous le nom d’Emile Ajar. Certes cela contrevenait aux règles de l’institution, et on peut évaluer aujourd’hui l’affaire comme un jeu malicieux de Gary avec la critique. On peut penser aussi que c’est Momo qui a dicté à Ajar, Gary ou Roman Kacew (nom d’origine de l’auteur) ce magnifique livre à la lecture tellement jubilatoire.
« La première chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait au sixième à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu’elle portait sur elle et seulement deux jambes, c’était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines ». La première phrase du roman nous lance dans la langue si particulière de Momo, faite des expressions qu’il a entendues de Madame Rosa qui l’a élevé, et du voisinage bigarré qui l’accompagne. Mais cette langue témoigne aussi d’une philosophie de la vie très déterminée, mélange d’empathie pour ses voisins et de volonté farouche de choisir sa vie.
Madame Rosa, ancienne prostituée, élève des enfants que d’autres femmes « qui se défendent avec leur cul » lui ont confiés, pour leur éviter l’Assistance Publique ou la mainmise des « proxynètes ». Momo est un jeune Arabe qui aide Madame Rosa, Juive qui s’approche de la fin de sa vie, à lutter contre les tentatives d’hospitalisation qui lui rappellent trop les rafles et l’enfermement dans les camps qu’elle a connus autrefois. A l’hôpital elle ne pourra pas « avorter » comme elle l’entend : « Tout le monde savait dans le quartier qu’il n’était pas possible de se faire avorter à l’hôpital même quand on était à la torture et qu’ils étaient capables de vous faire vivre de force, tant que vous étiez encore de la barbaque et qu’on pouvait planter une aiguille dedans ».
Cette histoire d’amour entre Momo et Madame Rosa se coule dans le réseau d’amitié déployé autour des deux personnages. On y rencontre par exemple Madame Lola : « Madame Lola circulait en voiture toute la nuit au bois de Boulogne et elle disait qu’elle était le seul Sénégalais dans le métier et qu’elle plaisait beaucoup car lorsqu’elle s’ouvrait elle avait à la fois des belles niches et un zob ». Ou Monsieur Charmette : « Ce Monsieur Charmette avait un visage déjà ombragé, surtout autour des yeux qui sont les premiers à se creuser et vivent seuls dans leur arrondissement avec une expression de pourquoi, de quel droit, qu’est-ce qui m’arrive ».
Mais c’est Madame Rosa qui fait l’objet des plus belles observations : « Madame Rosa mélangeait toutes les langues de sa vie, et me parlait polonais qui était sa langue la plus reculée et qui lui revenait car ce qui reste le plus chez les vieux c’est leur jeunesse ».
Andreossi
La vie devant soi, Romain Gary (Emile Ajar)
En 2008, avant le début du feuilleton des Goncourt, maglm avait déjà chroniqué ce chef-d’oeuvre. En complément du billet d’Andreossi, on peut relire celui-là, tout aussi enthousiaste.
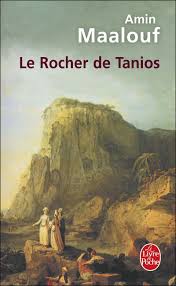 « En ce temps-là, le ciel était si bas qu’aucun homme n’osait se dresser de toute sa taille. Cependant, il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l’on n’attendait jamais le meilleur en ce monde, on espérait chaque jour échapper au pire ». C’est du Liban dont nous parle le Goncourt 1993 d’Amin Maalouf, pour nous conter l’histoire d’une disparition, celle du légendaire Tanios. Avant la disparition mystérieuse, une vie est reconstituée, dans une langue que l’on suivrait sur tous les chemins de l’imaginaire historique.
« En ce temps-là, le ciel était si bas qu’aucun homme n’osait se dresser de toute sa taille. Cependant, il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l’on n’attendait jamais le meilleur en ce monde, on espérait chaque jour échapper au pire ». C’est du Liban dont nous parle le Goncourt 1993 d’Amin Maalouf, pour nous conter l’histoire d’une disparition, celle du légendaire Tanios. Avant la disparition mystérieuse, une vie est reconstituée, dans une langue que l’on suivrait sur tous les chemins de l’imaginaire historique.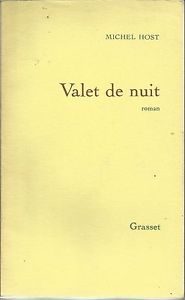 Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.
Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.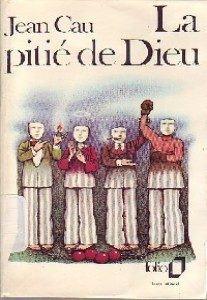 Retour à la littérature cette semaine, avec le prix Goncourt 1961 : assez difficile « à vendre », il faut le reconnaître ! L’occasion une fois de plus de redécouvrir avec le recul des années les choix du célèbre jury… et de prendre du recul par rapport à ceux-ci ! Bonne lecture quand même !
Retour à la littérature cette semaine, avec le prix Goncourt 1961 : assez difficile « à vendre », il faut le reconnaître ! L’occasion une fois de plus de redécouvrir avec le recul des années les choix du célèbre jury… et de prendre du recul par rapport à ceux-ci ! Bonne lecture quand même !  Pour la nouvelle année, on remonte 60 ans en arrière, avec le prix Goncourt 1957 relu par Andreossi. Partir dans le sud de l’Italie en ce début d’année, voici une idée séduisante…en tout cas en 2017… !
Pour la nouvelle année, on remonte 60 ans en arrière, avec le prix Goncourt 1957 relu par Andreossi. Partir dans le sud de l’Italie en ce début d’année, voici une idée séduisante…en tout cas en 2017… ! Notre feuilleton des prix Goncourt se poursuit, toujours grâce à notre ami Androssi. Cette semaine : le prix 1949.
Notre feuilleton des prix Goncourt se poursuit, toujours grâce à notre ami Androssi. Cette semaine : le prix 1949. Sans la voix du président du jury (en 1933, Rosny aîné), qui compte double, le Goncourt aurait échappé à André Malraux, au profit du roman Le roi dort, de Charles Braibant, totalement oublié depuis. Cela n’aurait sans doute pas empêché le succès de La condition humaine, dont la qualité ne fait pas de doute au lecteur d’aujourd’hui.
Sans la voix du président du jury (en 1933, Rosny aîné), qui compte double, le Goncourt aurait échappé à André Malraux, au profit du roman Le roi dort, de Charles Braibant, totalement oublié depuis. Cela n’aurait sans doute pas empêché le succès de La condition humaine, dont la qualité ne fait pas de doute au lecteur d’aujourd’hui.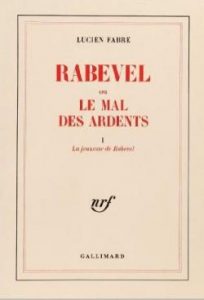 Alors que le prix Goncourt 2016 a été décerné cette semaine à Leïla Slimani pour « Chanson douce » (Gallimard), Andreossi a poursuivi pour nous la relecture des anciens Goncourt, avec le prix 1923.
Alors que le prix Goncourt 2016 a été décerné cette semaine à Leïla Slimani pour « Chanson douce » (Gallimard), Andreossi a poursuivi pour nous la relecture des anciens Goncourt, avec le prix 1923.  Les jurés des prix Goncourt de 1914 à 1918 ont tous couronné des œuvres évoquant la première guerre mondiale. Ces romans font part des horreurs de la guerre, mais l’esprit qui les anime a été fort différent. En cela, cette Flamme au poing de 1917 fait contraste avec
Les jurés des prix Goncourt de 1914 à 1918 ont tous couronné des œuvres évoquant la première guerre mondiale. Ces romans font part des horreurs de la guerre, mais l’esprit qui les anime a été fort différent. En cela, cette Flamme au poing de 1917 fait contraste avec 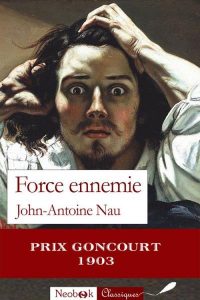 Verrait-on aujourd’hui le jury du prix Goncourt élire un roman publié à compte d’auteur, alors que les éditeurs rivalisent d’ardeur pour mettre en avant leurs favoris ? En 1903, à l’occasion du premier prix Goncourt, c’est pourtant ce qui est arrivé à John Antoine Nau. Et pour le moins à propos d’un livre fort original à divers points de vue.
Verrait-on aujourd’hui le jury du prix Goncourt élire un roman publié à compte d’auteur, alors que les éditeurs rivalisent d’ardeur pour mettre en avant leurs favoris ? En 1903, à l’occasion du premier prix Goncourt, c’est pourtant ce qui est arrivé à John Antoine Nau. Et pour le moins à propos d’un livre fort original à divers points de vue.