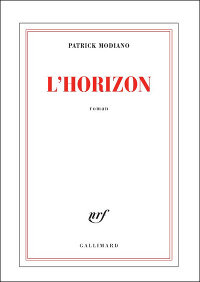 Jean Bosmans a peut-être désormais la soixantaine. Il marche dans Paris dont il connaît par cœur les rues, les stations de métro, pour les avoir arpentées sans cesse depuis des décennies.
Jean Bosmans a peut-être désormais la soixantaine. Il marche dans Paris dont il connaît par cœur les rues, les stations de métro, pour les avoir arpentées sans cesse depuis des décennies.
Derrière les plaques, les façades, les carrefours, c’est un fragment de son passé qu’il recherche : il y plus de quarante ans, il a aimé Marguerite Le Coz, une Bretonne née à Berlin. Ils avaient vingt ans à peine, s’étaient rencontrés dans une bousculade au métro Opéra, et dès lors ne s’étaient guère quittés, comme deux âmes échouées dans un monde peu fait pour eux.
Marguerite Le Coz est partie quelques temps après. La vie a continué son cours, Jean Bosmans a fait d’autres rencontres, les années ont passé.
Mais le souvenir de Marguerite Le Coz est encore présent et Bosmans se met en quête de retrouver des traces, des indices. Remontent à la surface les personnages côtoyés ensemble, les lieux fréquentés, ceux du maigre quotidien d’alors : le travail ; les cafés ; les modestes hôtels. Un Paris de l’après-guerre renaît sous la plume d’un Modiano tout à sa manière, un Paris gris et inquiétant, où le jeune couple craint de mauvaises rencontres, elle un homme obnubilé et armé, lui une mère violente et rançonneuse.
La mélancolie est là, prise dans la douceur de l’écriture, mais cette fois c’est le positif de l’écoulement du temps qui frappe le plus. Bosmans remarque à propos de ses parents justement : "Mon Dieu, comme ce qui nous a fait souffrir autrefois paraît dérisoire avec le temps, et comme ils deviennent dérisoires aussi ces gens que le hasard ou le mauvais sort vous avaient imposés pendant votre enfance ou votre adolescence, et sur votre état civil".
Surtout, petit à petit, retrouvant les souvenirs, il met la main sur l’essentiel, l’immuable, et Bosmans semble alors s’adresser directement à son auteur : "Mais qu’est-ce qui a vraiment changé ? C’était toujours les mêmes mots, les mêmes livres, les mêmes stations de métro".
Peut-être est-ce parce que l’essentiel n’a pas bougé que le roman se termine sur un horizon ouvert, très possiblement heureux – et que l’on brûle de citer, tant le dernier paragraphe du livre est magnifique.
Mais reste toujours le mystère de l’écriture de Modiano, cette simplicité, ce style apparemment plat dont on se demande comment peuvent sortir autant de reliefs, autant de récifs auxquels le lecteur s’accroche fermement, se découvrant peut-être parfois dans l’atmosphère et le miroir des personnages de Patrick Modiano.
L’Horizon
Patrick Modiano
Ed. Gallimard, 174 pages, 16,50 euros