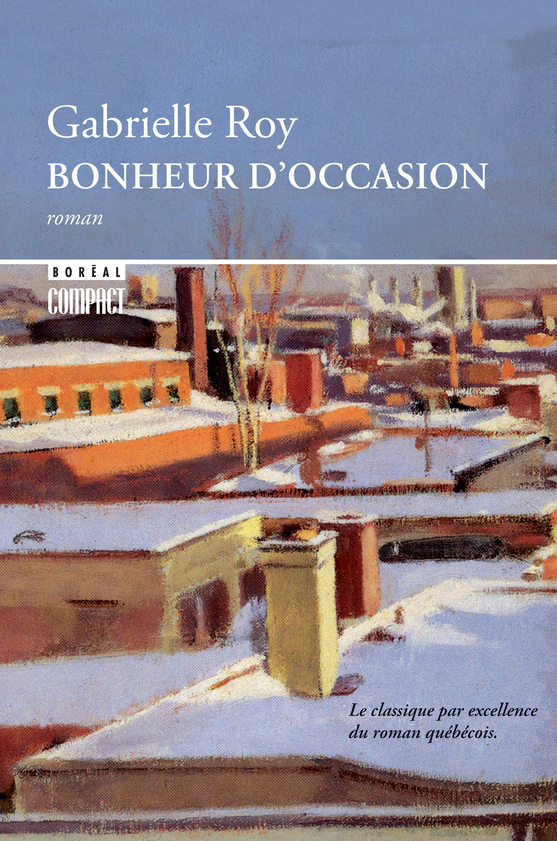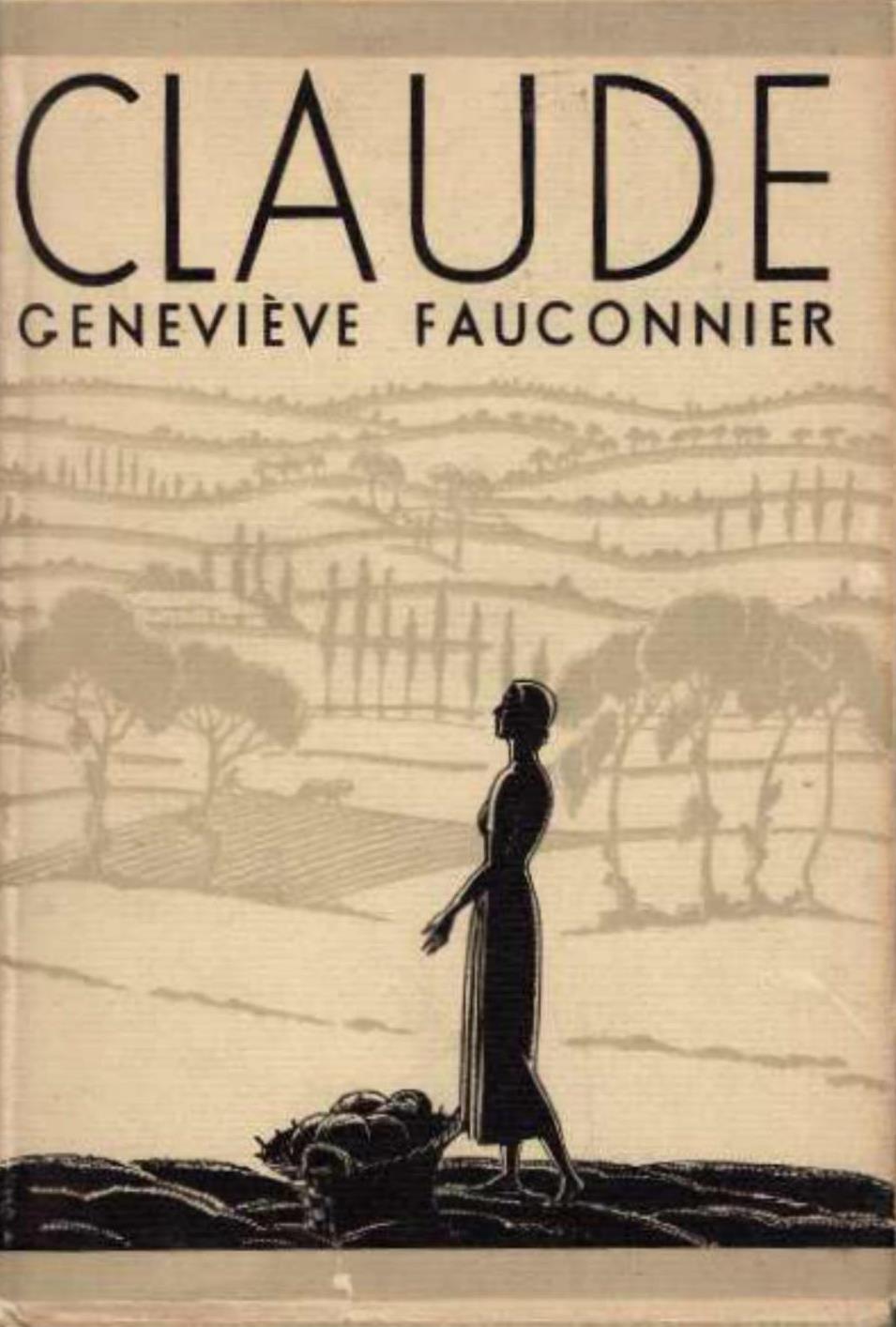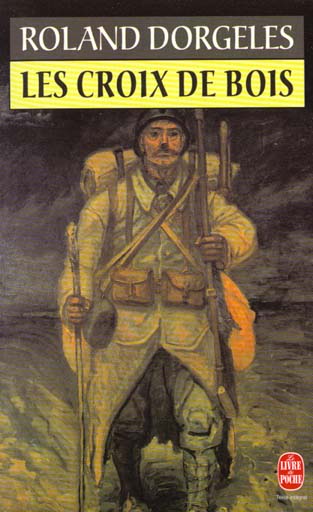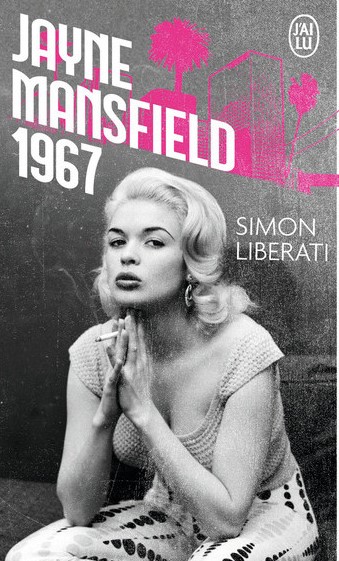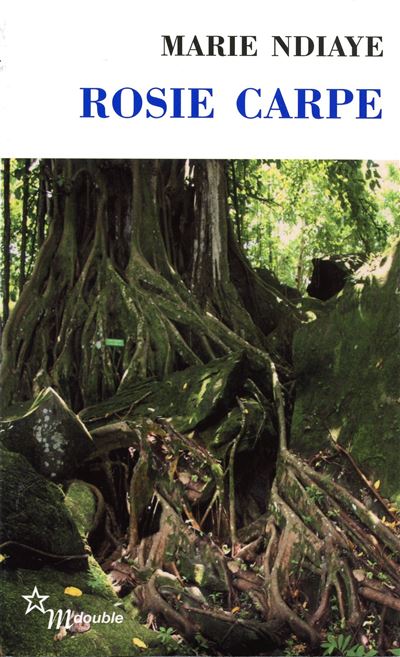Un homme âgé s’affaiblit lentement et dans un état semi-conscient rêve sans cesse de celle qui l’a laissé veuf. Le souffle est le sien, qui n’en finit pas d’être le dernier. Pendant ce temps, qui s‘étire sur des mois, et jusqu’à sa mort, leurs cinq enfants s’agitent, nouent des relations avec d’autres, et entretiennent la vie de leur fratrie par des disputes et des réconciliations, chacun suivant « son chemin secret au long duquel il est impossible de se perdre ».
Le roman qui a valu à Dominique Rolin le prix Fémina en 1952 surprend par la manière dont elle nous décrit les sentiments de ses personnages, particulièrement ceux des cinq enfants de la fratrie. Ils paraissent à la fois exacerbés et ambigus. Exacerbés, car les liens sont forts mais ne sont pas exempts de colères et de gifles allègrement distribuées. Ambigus car les sautes d’humeur sont telles que le lecteur a de la peine à se faire une idée de la réalité de ces sentiments. C’est que chacun tente de concilier rapports aux autres et vie intérieure : « Elle avait posé sa main sur le bras de Florent et elle tenait aussi la petite main de Luc. C’était en les touchant ainsi qu’elle pouvait le mieux s’éloigner d’eux pour protéger son rêve intérieur ».
Simplice, installée dans une vie bourgeoise, ne trouve son bonheur que dans l’enfantement : mari et enfants déjà faits ne l’intéressent guère. Laure, l’aînée célibataire, reporte un désir inassouvi sur un peintre brutal et sans sentiments. Olympe, soucieuse de son autonomie, peut-elle se laisser manipuler par Barnabé ainsi qu’il opère avec ses marionnettes ? Jérôme, passionné de nature, épouse-t-il l’agricultrice Constance pour elle-même ou pour la terre ? Valentin, trop souvent nommé « le doux Valentin », peut-il vivre avec Norine dont les goûts de luxe vont à l’encontre de ses possibilités ?
Chacun et chacune tente de vivre ses rêves alors qu’ils ne peuvent être partagés. Le mensonge semble être le moyen, qui a ses limites, de vivre malgré tout ses relations : « Il s’ingéniait à provoquer d’autres mensonges, puis d’autres, d’autres encore ; à chaque mensonge il se sentait devenir plus sûr de lui ».
Rares sont les personnages du roman qui sont dans le vrai, telle Lilou, que Valentin a quitté, et qui dans une belle scène ouvre son sac à main comme elle ouvre son cœur.
Andreossi