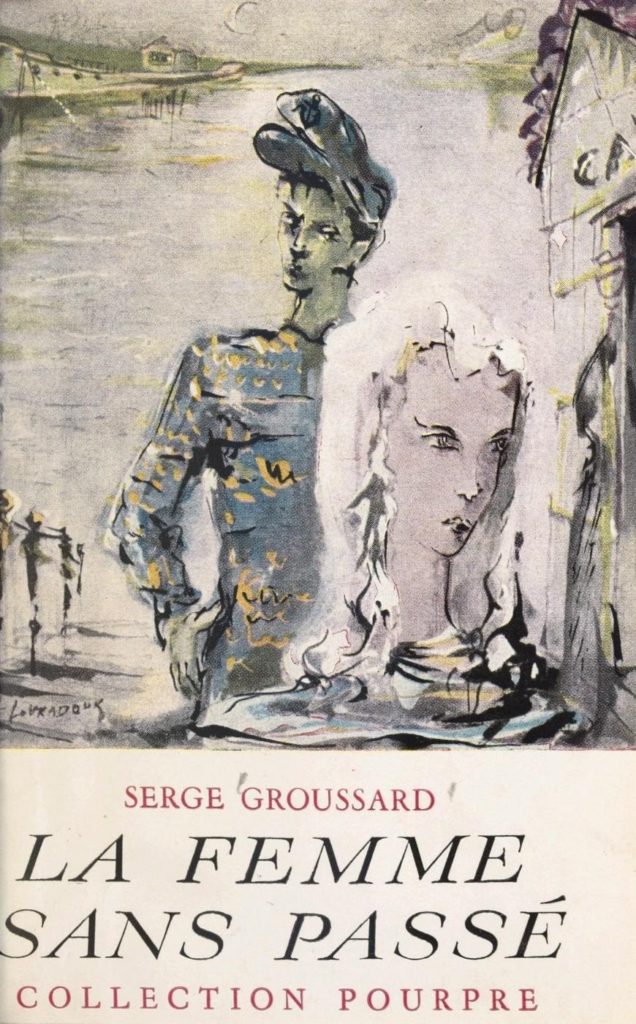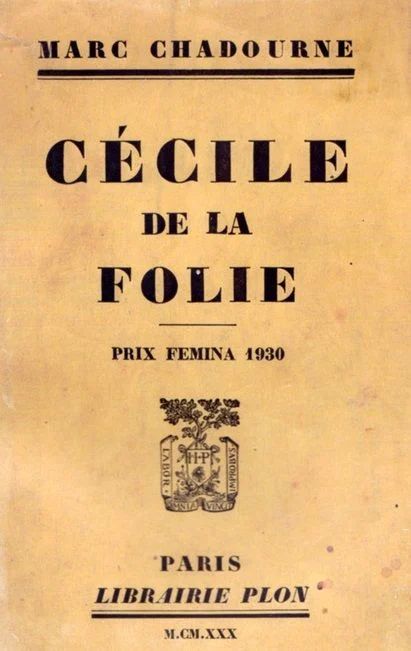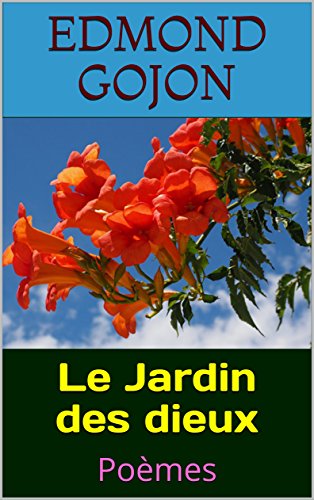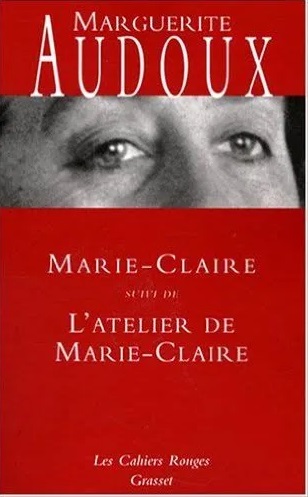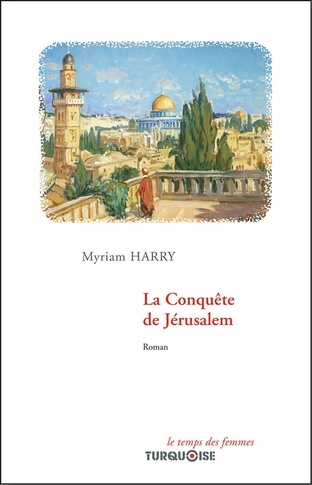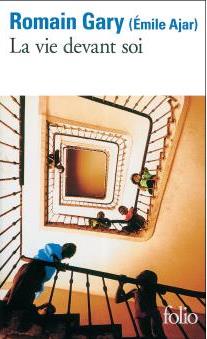L’attribution du prix Fémina 1960 a provoqué la démission d’une des jurées, Béatrix Becq, par ailleurs lauréate du Goncourt en 1952 pour son « Léon Morin, prêtre » : « Je n’admets pas qu’on couronne un mauvais roman, mal écrit, et dans lequel, en plus, il y a des allusions antisémites », avait-elle déclaré. Nous avons du mal en effet à défendre un roman qui nous a plus d’une fois ennuyé, tant par le thème, dont on a vite fait le tour, que par une écriture sans relief.
Le thème en est la décadence d’une famille de la grande bourgeoisie bordelaise, narrée à travers le destin des quatre enfants Laumond. Ils sont nés avant la guerre de 14-18, et se retrouvent dans les années cinquante pour vendre la maison familiale. A cette occasion, chaque pièce de la maison, qui donne son intitulé aux chapitres du roman, est le prétexte pour à la fois évoquer les rapports entretenus par le frère et les sœurs, et pour faire revivre les souvenirs de chacun liés à cette maison.
Nous ne connaissons le dernier de la fratrie que par ce qu’en disent les autres, car il est mort pendant la guerre, en héros de la Résistance, épargné en quelque sorte du malheur familial, « L’un sauvé par sa mort, les autres perdus par leur vie ». L’autre frère, l’aîné, est un personnage sans caractère mais débrouillard, qui a fait du trafic pendant l’Occupation. Il manifeste une certaine ironie devant la vie qui se prolonge jusque dans ses relations avec ses sœurs.
Mais Louise Bellocq, puisant sans doute dans sa propre biographie, s’attache surtout aux portraits de Madeleine et de Monique, sœurs que tout oppose. L’aînée est romanesque, attachée aux traditions bourgeoises, dont la jeunesse n’a eu pour souci que la réalisation d’un bon mariage. Hélas elle doit se contenter de prendre pour mari Martin, éconduit par Monique. Certes il devient général, mais son machisme conduit le couple au divorce, provoquant chez Madeleine une cascade de déchéances (drogue, emploi modeste).
Monique, affectée d’une haine de classe acquise jeune, refuse le mariage, a une fille d’un amant de passage, se pose en réfractaire à des valeurs bourgeoises qui sont aussi des valeurs masculines, et pense de sa sœur : « Qu’elle était bizarre, cette Madeleine, de voir l’homme partout, de le croire indispensable à la femme, de le poursuivre sans cesse ».
Aussi les jugements constants, entre les deux sœurs, envahissent le roman, presque autant que les histoires d’ameublement et de toilettes conformes ou non à la position sociale. Ainsi, la voilette ne serait-elle pas conseillée le matin, après la nuit de noces ? « Demain, je la nouerai autour de mon chapeau pour y dissimuler mon embarras lorsque je réapparaîtrai après la nuit d’hôtel à la face des gens, afin que personne ne puisse se douter, lire je ne sais quoi sur mon visage, voir ce dont je serai peut-être marquée aux yeux, aux lèvres, que sais-je ? les traces que cela laisse sans doute… »
Andreossi