 Exposition d’art paysager exceptionnelle, les Folies Végétales de Patrick Blanc sont avant tout le résultat de ses expériences de botaniste de haut vol.
Exposition d’art paysager exceptionnelle, les Folies Végétales de Patrick Blanc sont avant tout le résultat de ses expériences de botaniste de haut vol.
Chercheur au CNRS, Patrick Blanc a voyagé très jeune dans les milieux tropicaux pour essayer de comprendre le mystère des végétaux qui poussent dans des conditions extrêmes.
Depuis, l’inventeur du Mur végétal n’a eu cesse de pousser plus loin ses observations et réflexions.
Il nous en présente aujourd’hui une sorte de bilan.
Ambiance nocturne surchauffée, masses de chlorophylle vert fluo, on entre dans un autre monde en poussant la porte opaque de l’Espace Electra.
Un magnifique plafond végétal, dégradé, touffu accueille le visiteur. Il peut s’asseoir sous cette « entrée de grotte », admirer les petites fleurs rouges qui parsèment la verte coulée ; et commencer à s’adapter à cet « ailleurs ».
Avec la reconstitution d’un sous-bois de forêt tropicale, Patrick Blanc montre que les espèces poussant à faible luminosité ont l’apparence, brune, des feuilles mortes. C’est tellement vrai qu’on a envie de s’y rouler dedans.
On descend ensuite pour découvrir, dans une pièce toute noire, des bégonias présentés dans des globes, précisément éclairés : l’irisée des feuilles évoque le moiré, la finesse, la douceur de la soie.
Juste en face, c’est la baie d’Along : dans un petit espace saturé d’humidité, des sculptures végétales s’élèvent d’un bassin aux douces vapeurs blanches, figurant les reliefs karstiques de la baie du Vietnam, vestiges de la plus grande barrière de corail datant de la fin de l’Ere Primaire.
Le coup de coeur Mag :
Le moment où l’on monte l’escalier pour aller voir les plantes aquatiques qui poussent dans les ruisseaux à très fort courant : le murmure de l’eau qui nous berçait insensiblement depuis le début de la visite s’accentue ; l’espace d’un instant on croit qu’on va surgir devant un véritable torrent, en pleine forêt, en pleine montagne. Ici encore, un peu trop de tubes, de lumière artificielle … mais la magie a opéré ; l’instant d’illusion est magnifique.
Ne pas louper le film dans lequel Patrick Blanc explique ses recherches, sa passion de botaniste.
Ni la présentation des travaux architecturaux qu’il a réalisés à travers le monde : les images montrent qu’il a su intégrer son exceptionnel « paysagisme vertical » aussi bien dans l’architecture ancienne que moderne, dont la façade du Musée du quai Branly à Paris est un très bel exemple.
Espace EDF Electra
6, rue Récamier – Paris 7ème
Jusqu’au 18 mars 2007
De 12h à 19h, tlj sauf le lundi
Entrée libre
Pas de vestiaire
 Cyrano de Bergerac, la célèbre pièce d’Edmond Rostand méritait bien le bichonnage que lui a réservé le Français.
Cyrano de Bergerac, la célèbre pièce d’Edmond Rostand méritait bien le bichonnage que lui a réservé le Français. Auguste Rodin a commencé à dessiner très jeune, bien avant de devenir le sculpteur admiré que l’on sait.
Auguste Rodin a commencé à dessiner très jeune, bien avant de devenir le sculpteur admiré que l’on sait.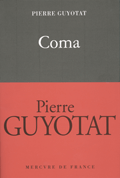 Pierre Guyotat a reçu le prix Décembre 2006 pour « Coma », texte dans lequel il fait le récit de la dépression qu’il a traversée.
Pierre Guyotat a reçu le prix Décembre 2006 pour « Coma », texte dans lequel il fait le récit de la dépression qu’il a traversée.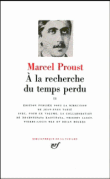 Dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur part en villégiature à Balbec, sur la côte, avec sa grand-mère.
Dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur part en villégiature à Balbec, sur la côte, avec sa grand-mère. Et si on partait en randonnée ? Une vraie randonnée dans les Alpes, pendant une semaine, avec un accompagnateur ?
Et si on partait en randonnée ? Une vraie randonnée dans les Alpes, pendant une semaine, avec un accompagnateur ?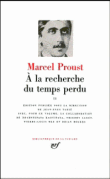 Dans Du côté de chez Swann et A l’ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur tombe amoureux de la fille de Charles Swann, Gilberte.
Dans Du côté de chez Swann et A l’ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur tombe amoureux de la fille de Charles Swann, Gilberte. Départ pour un lointain voyage avec une conservatrice de la Bibliothèque nationale de France … C’était mardi dernier, et il y en aura d’autres …
Départ pour un lointain voyage avec une conservatrice de la Bibliothèque nationale de France … C’était mardi dernier, et il y en aura d’autres … A New-York, Léo, vieil immigré juif de Pologne, vit seul dans son appartement exigu.
A New-York, Léo, vieil immigré juif de Pologne, vit seul dans son appartement exigu.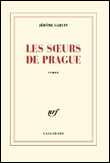 Le roman commence par une cinglante lettre d’insultes bien soignée adressée par une certaine Klara à un « cher petit grand con ».
Le roman commence par une cinglante lettre d’insultes bien soignée adressée par une certaine Klara à un « cher petit grand con ».