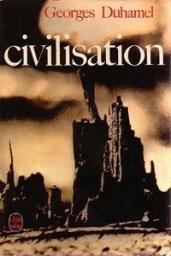 La Grande Guerre était terminée depuis un mois lorsque le Goncourt 1918 a été attribué à Georges Duhamel, médecin engagé comme chirurgien juste à l’arrière du front. Seize chapitres constituent autant d’histoires racontées par un narrateur différent mais dont le trait commun est sa présence auprès de blessés et agonisants, parce qu’il est brancardier, soldat à la morgue, ou bien blessé lui-même.
La Grande Guerre était terminée depuis un mois lorsque le Goncourt 1918 a été attribué à Georges Duhamel, médecin engagé comme chirurgien juste à l’arrière du front. Seize chapitres constituent autant d’histoires racontées par un narrateur différent mais dont le trait commun est sa présence auprès de blessés et agonisants, parce qu’il est brancardier, soldat à la morgue, ou bien blessé lui-même.
Sans aucune description de champs de bataille, ce livre est un des plus poignants de ceux qui ont été écrits sur 14-18. Duhamel nous révèle les conséquences immédiates de la guerre : les hommes à l’hôpital de campagne, dévastés dans leur chair, qui tentent de mourir sans se plaindre, qui gardent souvent espoir malgré leurs mutilations, honteux de la puanteur que leur corps dégage. Ces corps que le narrateur qui prend soin des cadavres imagine si près de la vie qu’ils viennent de quitter : « Je lis leur histoire sur leur corps ; je pense combien ils ont besogné avec ces bras que voilà, je pense qu’ils ont vu bien des choses avec leurs yeux, qu’on a embrassé leur bouche, qu’ils étaient coquets de leur moustache ou de leur barbe, sur laquelle, maintenant, je vois remonter les poux saisis par le froid de la peau ».
Au-delà des souffrances de ces hommes, la critique de la civilisation qui conduit à ces guerres est vive, d’abord par l’observation d’un changement de nature des conflits : « L’artillerie à longue portée s’y prodiguait. Les pièces étaient servies par des soldats en manches de chemise, en pantalons longs, souillés d’huile et de cambouis, qui ressemblaient beaucoup plus à des ouvriers d’usine qu’à des militaires. On sentait là combien la guerre est devenue une industrie, une entreprise mécanique et méthodique de tuerie ».
Et puis l’absurdité des situations vécues au cours de moments tragiques : le cadavre que l’on ne sait où déposer, les religions qui se disputent le privilège de la bénédiction du corps, et ces séances où l’on juge qui est bon pour le « service armé » : « Et toujours la chair humaine afflue ; toujours, du même coin de la pièce, arrive la file ininterrompue des corps blêmes qui avancent à pas mous sur le parquet. Sainte chair humaine, substance sacrée qui sers à la pensée, à l’art, à l’amour, à tout ce qu’il y a de grand dans la vie, tu n’es plus qu’une pâte vile et malodorante que l’on prend entre les mains avec dégoût pour évaluer si, oui ou non, elle est bonne à tuer ! ».
C’est le médecin qui est frappé par l’humiliation et la meurtrissure des corps. Le romancier parvient souvent à découvrir, malgré tout, sous la chair, « le cœur de l’homme ».
Civilisation, Georges Duhamel
Andreossi