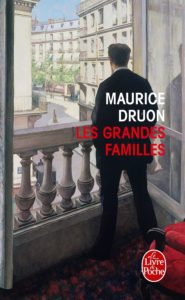 Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.
Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.
Deux familles nous sont présentées : l’une aristocratique, qui compte dans ses rangs un poète célèbre, un général, un ministre plénipotentiaire. L’autre est grande bourgeoise : on est plutôt du côté de la banque, de l’industrie, de la presse, de quoi dominer la place parisienne. Le jeune Simon, d’origine très modeste mais très ambitieux, part à l’assaut de ces familles, et ses qualités de séducteur font mouche, tant du côté des femmes (pour le corps) que du côté des hommes (pour l’emploi). Mais l’essentiel est de repérer les barreaux les plus solides de l’échelle sociale.
Au-delà de ce parcours tout de même assez convenu, d’autres personnages alimentent les intrigues : par exemple un médecin violeur de patientes, mais surtout Lulu Maublanc, demi-frère mal aimé qui cherche à se venger des humiliations subies. Certaines femmes sont davantage épargnées par Druon : écartées des affaires et des fonctions sérieuses, leurs tentatives pour sortir du lot peuvent paraître sympathiques.
L’intérêt du roman ne tient pas aux descriptions des lieux (« Vers le ciel de décembre, obscur à la fois et encombré d’astres, Paris lançait son immense lueur rose » !!!), mais plutôt à celles des personnes. Et de ce point de vue, notre auteur met assez de piment dans ses ingrédients pour nous rendre des portraits plutôt savoureux. Tel ministre : « ce corps bref, tassé, cette chevelure argentée qui bouffait sous les bords du haut-de-forme, ces paupières de volaille qui battaient en ponctuant la parole ». Le vieux Schoudler qui finit son petit verre de chartreuse : « il sortait, pour lécher ce qui restait au fond, une langue violette, recourbée, épaisse, qui se mouvait lentement dans le cône transparent et l’obstruait, comme une espèce de sangsue bien pleine de sang et prête à crever ».
C’est bien ce sentiment d’épuisement d’un monde, qui demeure dans l’esprit du lecteur après la fin du roman. Mais l’épuisement peut paradoxalement laisser la place à d’autres agréments, ainsi qu’on l’apprend à propos d’amours finissantes : « Parce que Simon était de plus en plus lent à se libérer d’un pénible plaisir, Mme Eterlin en éprouvait de plus longs bienfaits. Singulière dérision que cet accroissement de la joie, chez l’un, par la diminution du désir chez l’autre ».
Andreossi
Les grandes familles, Maurice Druon