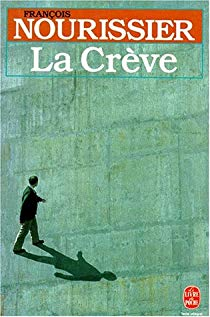
Ce Benoît- là n’est guère enthousiasmant. Il est éditeur et s’auto-flagelle à longueur de pages. François Nourissier n’est pas allé chercher bien loin son modèle, lui qui a hanté le milieu littéraire français par ses fonctions de critique ou de juré et président du Goncourt durant trente ans. Il obtient le prix Fémina en 1970 pour ce roman dont l’intrigue est d’une banalité éprouvante tandis que l’écriture à phrases courtes bloque la respiration du lecteur qui attend vainement de pouvoir sortir des méandres du cerveau de Benoît, torturé par sa mauvaise conscience.
Notre éditeur, parisien, est marié, a deux enfants, et, à quarante- huit ans connaît une histoire d’amour avec une jeunesse. La différence d’âge lui pose problème, d’où l’occasion de se dévaloriser, en particulier du point de vue du corps. Obsédé par le souvenir des moments passés avec Marie, il décide de la rejoindre en Suisse. Tout le roman est l’histoire de ce voyage, et surtout des pensées intimes de Benoît, sur lui-même essentiellement, car nous n’avons pas l’impression que les autres personnages, en particulier les femmes, son épouse et son amante, aient véritablement une existence hors de ses soucis.
D’ailleurs, l’évocation des femmes (qui ne peuvent être que jeunes) fait preuve d’un machisme bien ancré dans les années soixante : « On les voit, filles de vingt ans aux accents rauques et aux membres longs, dont tournoie l’appétit de vivre, traîner, un livre sous le bras, dans les rues qui avoisinent Sèvres et Notre-Dame-des-Champs, sauvages et trop charnelles. Leur corps ravage la solitude des hommes. Elles ne font pas tant d’histoires. Elles viennent de rivages où l’on prête vite son ventre aux assauts d’une nuit ». Ou bien : « On les croise, vêtues impitoyablement à la mode, leurs cuisses suffoquant les comptables et les nègres ».
Benoît quitte donc Paris en voiture, bloqué dans des embouteillages qui nous rappellent que le phénomène a bien ses soixante ans. Il a ainsi le temps de faire appel à ses souvenirs, comme celui qui donne son titre au roman, évoquant l’année soixante- huit et l’ambiance d’une classe de lycée : « il arrivait qu’un professeur fût interrompu par une sorte de mélopée à bouche cousue, un murmure anonyme, un grognement qui bientôt s’enflait, couvrait sa voix : Crève salope…Crève… crève salope ». Ce climat malsain est entretenu le long du récit par une vision de soi bien dégradée : « Je me promène dans ce vide que j’ai fait en moi sans parvenir à y croire. Le petit ressort, quelque part, cassé. La réserve de forces, quelque part, épuisée. (…) Alors je me promène en moi et je cherche. La faille. La fissure par où tout s’est vidé ».
Andreossi