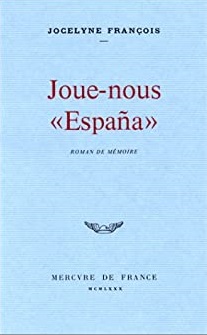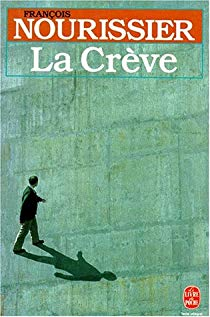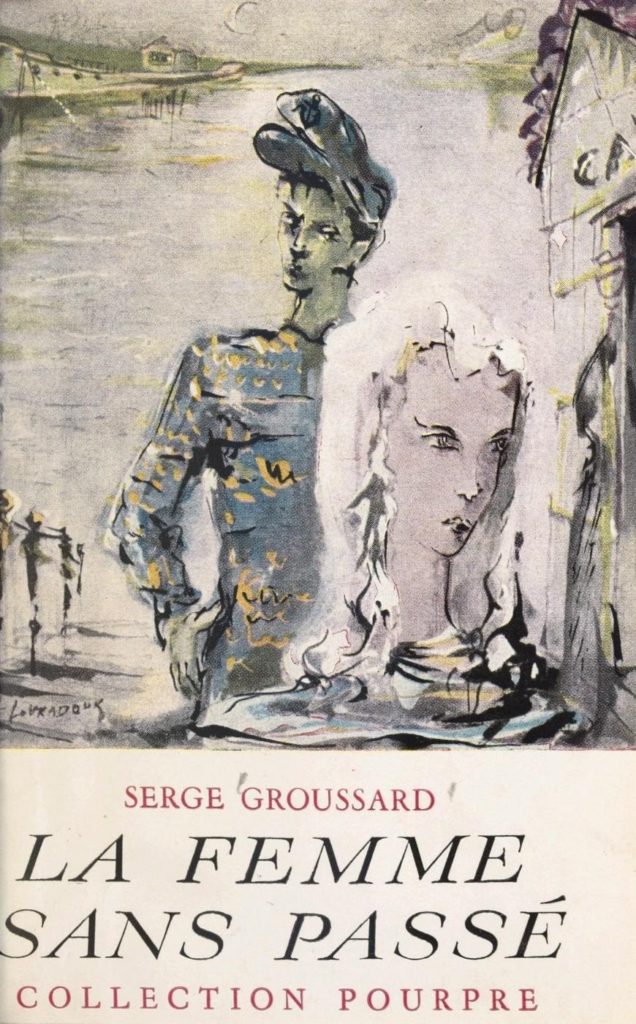Philippe Lançon, rescapé du massacre de l’équipe de Charlie Hebdo en 2015 publie ce livre, qui lui vaut le prix Fémina, trois ans après. Grièvement blessé (il a, entre autres, la mâchoire inférieure emportée par une balle) il nous conte comment l’écriture a été le moyen de retrouver une place dans un monde qui l’avait lâché.
D’abord par nécessité de la communication avec les autres : ne pouvant plus parler, avant qu’une longue série d’opérations lui reconstitue une mâchoire, il échange à l’aide d’une tablette sur laquelle il écrit. Dès les premières semaines d’hôpital il peut exercer son métier de journaliste en envoyant des articles à Charlie et à Libération. Il s’aperçoit que cette activité est essentielle à sa reconstruction : « Quand j’écrivais au lit, avec trois doigts, puis cinq, puis sept, avec la mâchoire trouée puis reconstituée, avec ou sans possibilité de parler, je n’étais pas le patient que je décrivais ; j’étais un homme qui révélait ce patient en l’observant, et qui contait son histoire avec une bienveillance et un plaisir qu’il espérait partager. Je devenais une fiction ».
Car l’enjeu est de recoller à un monde qu’il ne partage plus. Allongé tout contre les cadavres de ses amis, il voit un visage s’approcher : « Je me souviens simplement qu’elle fut la première personne vivante, intacte, que j’aie vue apparaître, la première qui m’ait fait sentir à quel point ceux qui approchaient de moi, désormais, venaient d’une autre planète –la planète où la vie continue ».
Nous pouvons faire avec lui l’inventaire de tout ce qui lui a permis de revenir, dont il parle avec une extrême délicatesse, avec une grande justesse et beaucoup d’honnêteté. D’abord sa propre capacité à accepter, dès la première phrase écrite : « écrire, c’était protester, mais c’était aussi, déjà, accepter. La première phrase a donc eu cette vertu immédiate : me faire comprendre à quel point ma vie allait changer, et qu’il fallait sans hésitation admettre tout ce que le changement imposerait ».
Il a pu aussi compter beaucoup sur la famille, sur son ex-épouse et son frère en particulier ; ses amis et amies, dont la variété même des personnalités a constitué un réconfort. Une place particulière est faite aux soignantes et soignants, dont de beaux portraits restent dans la mémoire du lecteur : Chloé la chirurgienne miracle, la Marquise des Langes, Annette aux yeux clairs, Serge l’anesthésiste et bien d’autres, comme la première infirmière dont il se souvient : « J’étais enveloppé dans sa jeunesse comme dans un tapis, certes rugueux, certes troué, mais volant et filant dans l’instabilité vers une contrée où je n’aurais pu aller seul, une contrée où la vie était brutalement la plus forte ».
L’ont suivi, tout au long de son parcours de reconquête, la littérature (Proust, Kafka) et la musique (Bach). Il ne s’interroge pas beaucoup sur les assassins, mais à la suite d’une discussion avec un ami sur la question du Mal, il conclut : « Ni la sociologie, ni la technologie, ni la biologie ni même la philosophie n’expliquaient ce que d’excellents romanciers, eux, avaient su décrire. Il n’y avait peut-être aucune explication au goût de la mort donnée ou reçue ».
La littérature nous pousse à vivre.
Andreossi