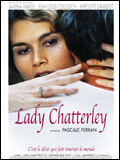 Lady Chatterley est un film sur le désir, la découverte de l’autre, la découverte de soi, la transformation, la renaissance. On en sort sous l’emprise d’un charme – qui n’est peut-être autre que le charme de la vie-même – et, longtemps, durable, son empreinte demeure.
Lady Chatterley est un film sur le désir, la découverte de l’autre, la découverte de soi, la transformation, la renaissance. On en sort sous l’emprise d’un charme – qui n’est peut-être autre que le charme de la vie-même – et, longtemps, durable, son empreinte demeure.
Après avoir été conquis par ce film magnifique, on découvre sa réalisatrice, Pascale Ferran. Elle apparaît comme une dame simple, sincère, dont la timidité s’efface derrière la détermination.
Sa voix, singulière, semble venir d’un autre monde, qui n’est pas celui du cinéma. Pourtant, qui mieux qu’elle au cours de ces dernières années a aussi justement parlé du cinéma ?
Que ce soit à l’émission Le Masque et la Plume sur France-Inter, dont les auditeurs ont désigné Lady Chatterley meilleur film français de l’année, ou lors de la soirée de remise des Césars, dont le jury de professionnels a confirmé le choix du – d’un certain – public, Pascale Ferran, après son film, a elle-même séduit.
Avec le numéro du mois de mars, Les cahiers du cinéma offrent à leurs lecteur un petit « Carnet d’une cinéaste » contenant des notes de Pascale Ferrand, des croquis, photos qui ont servi à la préparation et à la réalisation du film.
Tout y est beau, simple, extraordinairement précis, délicat.
Notamment, on peut lire une longue « note d’intention en forme de lettre au futur coscénariste du film ».
La lettre est une telle merveille qu’on ne peut que conseiller de la lire dans son intégralité.
Elle commence par des considérations – passionnantes – purement cinématographiques pour se clôturer sur de très belles réflexions personnelles de la cinéaste. En voici tout de même des extraits.
4. (…) Il me semble de la plus haute importance d’arriver à restituer cinématographiquement l’extraordinaire impression de première fois qui se dégage du livre :
La première fois que cette histoire a été racontée.
La première fois que cet homme et cette femme se sont rencontrés.
La première fois qu’un homme et une femme se sont aimés.
(Il y a quelque chose d’archaïque dans ce projet, de pré-moderne. Je pense tout le temps à Blissfully Yours et aux films de Boris Barnett. Je ne sais pas grand-chose et pourtant j’ai souvent l’impression que c’est un projet pour lequel il me faudrait encore désapprendre).
5. Etre le plus possible dans le présent des choses, dans l’espoir d’arriver à faire venir au premier plan la présence des choses et des gens. C’est évidemment l’un des motifs souterrains du livre (et du film à venir) : le miracle de l’incarnation. L’émerveillement devant la pure présence de l’autre. Mais on n’a pas le droit d’en parler. C’est comme la poésie pour Cocteau.
8.Il n’empêche, c’est un projet fou. La tâche paraît, par moments, écrasante. Mais la beauté du projet tient tout entier dans son étranger paradoxe : l’ambition la plus folle n’est accessible ici qu’au moyen de la plus grande modestie.
Carnet d’un cinéaste. Pascale Ferran, Lady Chatterley
Supplément au dernier numéro des Cahiers du Cinéma (mars, n° 621)
A lire également : le discours de Pascale Ferran lors de la cérémonie des Césars
sur le site du journal Le Monde
 Dans la série « la montagne et nous », voici Les Bottin aux sports d’hiver.
Dans la série « la montagne et nous », voici Les Bottin aux sports d’hiver. Le « Grand Siècle » évoque les splendeurs de Versailles, le classicisme français, le siècle de Louis XIV, l’apogée du l’absolutisme.
Le « Grand Siècle » évoque les splendeurs de Versailles, le classicisme français, le siècle de Louis XIV, l’apogée du l’absolutisme. Lorsqu’en 1937 Simone de Beauvoir termine « La primauté du spirituel » – titre qu’elle avait choisi initialement – elle est âgée d’à peine trente ans.
Lorsqu’en 1937 Simone de Beauvoir termine « La primauté du spirituel » – titre qu’elle avait choisi initialement – elle est âgée d’à peine trente ans.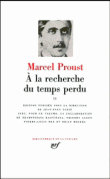 A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.
A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.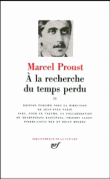 Dans Le côté de Guermantes, le narrateur est régulièrement reçu dans le monde aristocratique, les meilleurs salons de Paris, dont celui de la duchesse de Guermantes.
Dans Le côté de Guermantes, le narrateur est régulièrement reçu dans le monde aristocratique, les meilleurs salons de Paris, dont celui de la duchesse de Guermantes.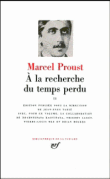 Dans Le côté de Guermantes, le narrateur obtient d’Albertine à Paris ce qu’il avait fortement désiré en vain à Balbec.
Dans Le côté de Guermantes, le narrateur obtient d’Albertine à Paris ce qu’il avait fortement désiré en vain à Balbec. Après le départ de sa femme, Nashe, âgé d’une trentaine d’années laisse sa fille chez sa sœur, quitte son emploi de pompier et, l’héritage de son père en poche, se met à avaler des kilomètres, le volant d’une routière rouge entre les mains.
Après le départ de sa femme, Nashe, âgé d’une trentaine d’années laisse sa fille chez sa sœur, quitte son emploi de pompier et, l’héritage de son père en poche, se met à avaler des kilomètres, le volant d’une routière rouge entre les mains.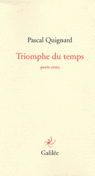 Les contes s’enchaînent sans aucune frontière matérielle.
Les contes s’enchaînent sans aucune frontière matérielle. Les 19èmes Rencontres Cinémas d’Amérique Latine se dérouleront à Toulouse du vendredi 16 au dimanche 25 mars.
Les 19èmes Rencontres Cinémas d’Amérique Latine se dérouleront à Toulouse du vendredi 16 au dimanche 25 mars.