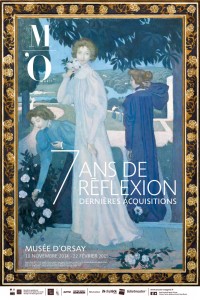Il existe depuis quelques mois à Paris un nouveau musée du parfum, installé dans les anciens locaux de feu le magasin de meubles anglais Maple, à deux pas du théâtre Edouard VII et du boulevard Haussmann.
Il existe depuis quelques mois à Paris un nouveau musée du parfum, installé dans les anciens locaux de feu le magasin de meubles anglais Maple, à deux pas du théâtre Edouard VII et du boulevard Haussmann.
C’est Fragonard, le célèbre parfumeur de Grasse dans les Alpes-Maritimes (où sont fabriqués ses parfums et où un musée est ouvert depuis longtemps) qui en est le fondateur et, si tout est fait pour préparer le visiteur à l’acquisition de quelques uns de ses célèbres essences, savons et autres bains parfumés adorablement présentés en fin de parcours, la visite guidée (et gratuite) réserve un très agréable et instructif moment.
Devant gravures et affiches anciennes, on commence par une petite introduction sur le passé mouvementé du bâtiment, où l’on apprend qu’il fut notamment, à la fin du XIX° siècle, un théâtre de variété puis un manège vélocipédique, c’est-à-dire un endroit pour apprendre à pédaler…
 Puis, dans une douce pénombre où brillent de riches vitrines, on admire près de 300 objets anciens, remontant l’histoire de la toilette, de la fabrication et de l’usage du parfum. Ce sont des aryballes de la Grèce antique, des brûle-parfums, des vases à khôl, de précieux nécessaires de toilette, des étiquettes recherchées, d’impressionnants alambics et bien sûr une extraordinaire collection de flacons, en particuliers du XVIII° siècle (très raffinés) à nos jours.
Puis, dans une douce pénombre où brillent de riches vitrines, on admire près de 300 objets anciens, remontant l’histoire de la toilette, de la fabrication et de l’usage du parfum. Ce sont des aryballes de la Grèce antique, des brûle-parfums, des vases à khôl, de précieux nécessaires de toilette, des étiquettes recherchées, d’impressionnants alambics et bien sûr une extraordinaire collection de flacons, en particuliers du XVIII° siècle (très raffinés) à nos jours.
Evidemment, parmi les plus séduisants figurent les incomparables flacons en verre dessinés par René Lalique au début du siècle dernier. Recourant aux motifs végétaux et géométriques, cet extraordinaire « designer » a été un maître en son domaine, promoteur des lignes Art Nouveau puis Art Déco et hissant de luxueux objets du quotidien et d’ornementation au rang d’œuvres d’art.
 L’histoire de la maison ne saurait être oubliée, où il est rappelé que c’est en 1926 qu’Eugène Fuchs a donné à l’ancienne parfumerie grassoise le nom de Fragonard, en hommage au peintre Jean-Honoré Fragonard originaire de la ville.
L’histoire de la maison ne saurait être oubliée, où il est rappelé que c’est en 1926 qu’Eugène Fuchs a donné à l’ancienne parfumerie grassoise le nom de Fragonard, en hommage au peintre Jean-Honoré Fragonard originaire de la ville.
Enfin, le visiteur a droit à une petite initiation aux fondamentaux du parfum : qu’est-ce qu’un « nez », quelles sont les différences entre les « notes » (de tête, de cœur, de fond) d’un parfum, mais aussi les grandes familles de parfums (les hespéridés, les floraux, les chyprés, les boisés, les ambrés…). Exercice à l’appui, avec, dans la boutique, un moment réservé à la découverte de quelques uns des grands succès de la maison… A vos nez, prêts, partez !
Nouveau musée du parfum Fragonard
3-5, square de l’Opéra Louis-Jouvet – Paris 9ème
TLJ de 9 h à 18 h
Entrée libre avec visite guidée
 Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée.
Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée. Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ».
Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ». La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène.
La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène.