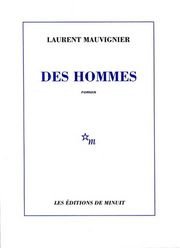 Le roman commence par l’anniversaire de Solange, soixante ans, dans la salle des fêtes du village. Description minutieuse, lente, d’une scène qui va agir comme un détonateur : Bertrand, surnommé Feu-de-bois parce qu’il en porte l’odeur âcre à laquelle s’ajoutent celles de l’alcool et de la crasse, un marginal haineux et entretenu offre à sa soeur Solange un bijou dont tous se demandent comment il a pu le payer.
Le roman commence par l’anniversaire de Solange, soixante ans, dans la salle des fêtes du village. Description minutieuse, lente, d’une scène qui va agir comme un détonateur : Bertrand, surnommé Feu-de-bois parce qu’il en porte l’odeur âcre à laquelle s’ajoutent celles de l’alcool et de la crasse, un marginal haineux et entretenu offre à sa soeur Solange un bijou dont tous se demandent comment il a pu le payer.
Réactions hostiles du groupe, méfiant et jaloux à la fois, gêne de Solange, la seule peut-être à connaître les tenants secrets de ce geste – sentiments de son frère, origine lourde de l’argent.
Contre-réaction agressive de Bertrand, qui s’en prend à un ami de Solange, Chefraoui : "Et lui… Il a le droit d’être là… le bougnoule".
Cette montée en tension souverainement menée par Mauvignier fait resurgir à la surface d’autres tensions, d’autres haines et d’autres souffrances trop superficiellement enfouies : celles de la guerre d’Algérie, à laquelle ont participé Rabut, le narrateur de la fête, son cousin Bertrand – le fameux Feu-de-bois – et un certain Février, plus tard narrateur à son tour.
Comment restituer la force destructrice que les douleurs passées, non dites et non reconnues irradient plusieurs décennies après ? Laurent Mauvignier – mû par une quête personnelle autour du suicide de son père (1) – le fait de façon bouleversante dans ce très grand roman.
De la fête, l’on glisse dans ce terrible après-fête, dont l’épisode de la broche a sonné l’ouverture, avec les sombres pensées, l’inquiétude, le silence et les pauvres mots. De cet aujourd’hui raconté au passés l’on passe à la Guerre d’Algérie. Racontée au présent. Peur, fatigue, questionnement, tout est là : Il pense que parmi les hommes et les femmes qu’ils croisent dans la rue certains veulent sa mort, à lui et à tous ceux qui portent l’uniforme. Mais en même temps tout ça lui paraît faux parce que le soleil et la ville sont là, qu’on entend des conversations de rien, des rires, de la vie, c’est toute une ville qui bat, le bruit des moteurs des voitures et des scooters, un homme assis devant sa petite boucherie qui regarde des enfants jouant au foot sur une placette, les pieds nus, avec une boîte de conserve qui roule dans un bruit affreux et parfois s’arrête en silence dans les cartables et les chandails qui servent de filet. Est-ce que c’est ça, la guerre ?. Plus loin : La vérité, c’est l’humiliation, et puis, venant conclure un long paragraphe digne de Céline : Voilà ce qu’on veut, qu’on en finisse.
Est-ce à cause de la guerre et de ses horreurs que les deux cousins se battront à Oran dans un bal lors d’une permission, ou pour des histoires personnelles qui s’entremêleront à la Grande histoire ? Quarante ans après, que reste-t-il de tout cela ?
Et comme un con, moi, à soixante-deux ans, comme un gosse j’ai eu peur du noir, il m’a fallu allumer, me redresser et me relever et sortir de la chambre, passer de l’eau sur mon visage, se rafraîchir, oui se rafraîchir la mémoire aussi alors qu’enfin on voudrait juste que la mémoire nous foute la paix et qu’elle nous laisse dormir. J’ai repensé à tout ça, et je me disais, qu’est-ce qui m’a échappé ? Qu’est-ce que je n’ai pas compris ? Il faut bien que quelque chose soit passé tout près de moi, que j’ai vu, vécu, je ne sais pas, et que je n’ai pas compris.
Des hommes
Laurent Mauvignier
Les Éditions de Minuit, 2009, 288 p., 17,50 €
(1) Dans une interview pour le magazine Page de septembre 2009, Laurent Mauvignier se livrait ainsi :
"C’est très intime ce que je vais dire, mais ça participe de ce qui a fait naître ce livre -, il y a eu le suicide de mon père quand j’étais adolescent, et les questions qui sont venues plus tard : et si la guerre d’Algérie avait participé de sa mort ? Ces photos seront-elles toujours muettes, le seront-elles forcément toujours ? J’avais besoin de tourner autour de ce vide, qui n’est pas seulement personnel, mais que beaucoup d’autres ont connu. C’est quelque chose de la mémoire de nos pères, pour reprendre le titre d’un film d’Eastwood, que j’ai voulu aller chercher".
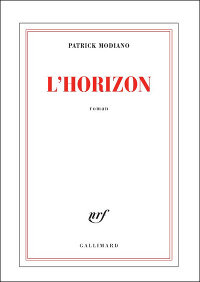 Jean Bosmans a peut-être désormais la soixantaine. Il marche dans Paris dont il connaît par cœur les rues, les stations de métro, pour les avoir arpentées sans cesse depuis des décennies.
Jean Bosmans a peut-être désormais la soixantaine. Il marche dans Paris dont il connaît par cœur les rues, les stations de métro, pour les avoir arpentées sans cesse depuis des décennies.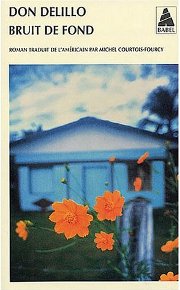 La vie quotidienne est faite de petits bonheurs et de petits soucis. Celle qui est décrite par Delillo dans les années 80 est américaine, concerne une famille habile à faire vivre ensemble des enfants issus de plusieurs couples précédents. Dans cette ambiance très animée les bruits de fond sont nombreux : les images et les voix de la télé, qui peuvent surgir à tout moment, les gestes de la consommation, qui aident bien à pousser aujourd’hui pour arriver à demain.
La vie quotidienne est faite de petits bonheurs et de petits soucis. Celle qui est décrite par Delillo dans les années 80 est américaine, concerne une famille habile à faire vivre ensemble des enfants issus de plusieurs couples précédents. Dans cette ambiance très animée les bruits de fond sont nombreux : les images et les voix de la télé, qui peuvent surgir à tout moment, les gestes de la consommation, qui aident bien à pousser aujourd’hui pour arriver à demain.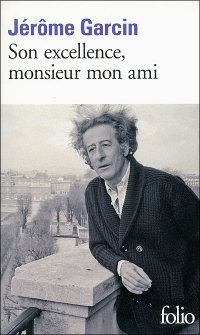 François-Régis Bastide. Un nom séduisant, avec un prénom (d’emprunt) à la fois bien planté et un peu en suspens, un patronyme rassurant, mais qui parle à bien peu de monde aujourd’hui.
François-Régis Bastide. Un nom séduisant, avec un prénom (d’emprunt) à la fois bien planté et un peu en suspens, un patronyme rassurant, mais qui parle à bien peu de monde aujourd’hui.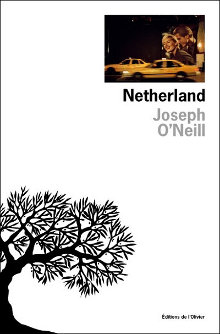 Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions.
Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions.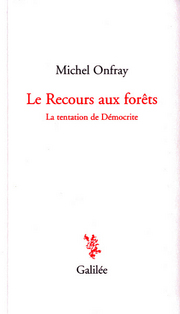 A l’issue de sa conférence
A l’issue de sa conférence 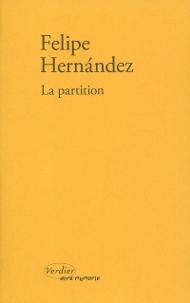 La frontière entre désir et folie peut être bien ténue.
La frontière entre désir et folie peut être bien ténue. Le lièvre de Patagonie est une pierre précieuse aux facettes multiples.
Le lièvre de Patagonie est une pierre précieuse aux facettes multiples.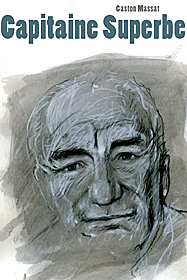 Poète, romancier, résistant, communiste, Gaston Massat aurait eu cent ans cette année.
Poète, romancier, résistant, communiste, Gaston Massat aurait eu cent ans cette année. Seul roman qu’il ait écrit, Capitaine Superbe a été publié aux éditions Bordas en 1946 puis dans le journal Action en 1947. Il a fait dire à Aragon qu’il était à lire « avec une espèce de reconnaissance ». Il vient d’être réédité à l’initiative de sa nièce Catherine Massat aux éditions Libertaires avec des illustrations d’Ernest Pignon Ernest.
Seul roman qu’il ait écrit, Capitaine Superbe a été publié aux éditions Bordas en 1946 puis dans le journal Action en 1947. Il a fait dire à Aragon qu’il était à lire « avec une espèce de reconnaissance ». Il vient d’être réédité à l’initiative de sa nièce Catherine Massat aux éditions Libertaires avec des illustrations d’Ernest Pignon Ernest.