 Dans un passage Des vents contraires, Paul, le narrateur, dit à son frère Alex qu’il a rendez-vous avec un producteur de cinéma pour une commande sur les derniers jours de Nino Ferrer. "Ben c’est gai encore ton truc" lui fait remarquer Alex. "C’est pour ça qu’il ont pensé à moi" répond Paul. Clin d’œil d’auto dérision de la part d’Olivier Adam, écrivain et scénariste lui même connu et reconnu pour ses sujets pas drôles…
Dans un passage Des vents contraires, Paul, le narrateur, dit à son frère Alex qu’il a rendez-vous avec un producteur de cinéma pour une commande sur les derniers jours de Nino Ferrer. "Ben c’est gai encore ton truc" lui fait remarquer Alex. "C’est pour ça qu’il ont pensé à moi" répond Paul. Clin d’œil d’auto dérision de la part d’Olivier Adam, écrivain et scénariste lui même connu et reconnu pour ses sujets pas drôles…
Mais, dans ce tout dernier roman, Olivier Adam réchauffe le froid tranchant du malheur d’une flamme douce et nouvelle.
La femme de Paul a disparu depuis plus d’un an sans qu’aucune explication ni trace n’ait pu être trouvée, et Paul se retrouve seul avec ses enfants, ses questions sans réponse et sa souffrance. Il décide de quitter le cadre francilien du bonheur passé pour s’installer avec ses deux petits à Saint-Malo, la ville de son enfance. Là, il se fait embaucher par son frère qui a repris l’auto-école familiale. Cet emploi de dépannage sera pour lui davantage l’occasion de rencontres et d’embardées au bord de l’eau que de leçons de conduite.
Des vents contraires est l’un des plus beaux romans d’Olivier Adam, qui explore avec bonheur la relation fusionnelle d’un père avec ses enfants. Son narrateur est profondément singulier en ceci qu’il est à la fois très "mec", fort comme un bœuf, toujours prêt à se défouler sur le sac de sable pendu dans le garage ou à en coller une à celui qui le cherche, à fumer des cigares, à picoler jusqu’à plus soif, surtout des alcools forts… mais il est en même temps un papa-poule incroyable, ultra attentif au silence de son fils, à la tristesse de la petite dernière, à leur sommeil, à leur appétit, à leurs envies, à leurs angoisses. Pour voir des étoiles dans leurs yeux, il leur fait louper une après-midi d’école, construit une balançoire au prix d’une nuit sans sommeil de plus, monte dans des manèges qui ne sont plus de son âge, dévalise les magasins de jouets, dort avec eux à même le tapis. La souffrance de ses enfants privés de leur mère lui fait oublier sa propre souffrance. Leur joie lui fait croire à un retour possible.
Et puis il y a toutes ces rencontres, le déménageur, la voisine, les élèves, l’inspecteur de police, des êtres ordinaires, avec leurs poids de malheur, leurs vieux trucs qui les lestent. Des semblables que Paul aide comme il peut et qui le détournent de son chagrin. Face à la dureté sociale, à l’aveuglement administratif, aux jugements péremptoires du monde enseignant, surgissent alors des moments d’une chaleur inattendue, magnifique.
Sans angélisme, et de son écriture toujours aussi efficace et incisive, mais teintée d’une poésie des plus inspirées pour décrire l’ambiance et les lumières d’une Saint-Malo hors saison, Olivier Adam fait rougeoyer sur son petit monde un doux soleil d’hiver. Il parvient même à contrarier enfin les vents glacés du malheur, par la grâce de la tendresse, de l’amour et de la fraternité.
Des vents contraires
Olivier Adam
Éditions de l’Olivier (janvier 2009), 256 p., 20 €
Des vents contraires est le sixième roman d’Olivier Adam. Il a reçu les prix Goncourt de la nouvelle en 2004 pour Passer l’hiver, France Télévisions 2007 pour Falaises et Jean-Amila-Mecker 2008 pour A l’abri de rien. Il est également l’auteur et le scénariste du roman (2000) et du film (2006) Je vais bien ne t’en fais pas
 Novembre a été long ? Décembre s’étire vers des fêtes pour lesquelles vous n’avez guère d’appétit ?
Novembre a été long ? Décembre s’étire vers des fêtes pour lesquelles vous n’avez guère d’appétit ? Ce que l’on peut trouver très étonnant dans ce livre, c’est d’abord la quatrième de couverture : pas vraiment l’élégance du code barre, mais la fin du texte de présentation qui veut nous faire acheter le roman : « un roman plein d’entrain et de péripéties, qui montre l’impuissance de l’homme dans la civilisation moderne ».
Ce que l’on peut trouver très étonnant dans ce livre, c’est d’abord la quatrième de couverture : pas vraiment l’élégance du code barre, mais la fin du texte de présentation qui veut nous faire acheter le roman : « un roman plein d’entrain et de péripéties, qui montre l’impuissance de l’homme dans la civilisation moderne ».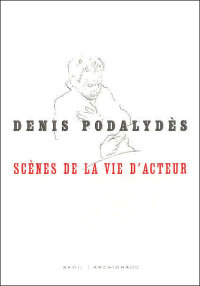 Etre dans la peau d’un acteur, tout le temps, ou à n’importe quel moment. Etre dans la peau de Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, qui a réuni dans ces Scènes les notes prises au fil de son métier d’acteur : descriptions très précises de tournages, de répétitions, d’attentes, de représentations devant le public, partagées avec le lecteur comme s’il y était.
Etre dans la peau d’un acteur, tout le temps, ou à n’importe quel moment. Etre dans la peau de Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, qui a réuni dans ces Scènes les notes prises au fil de son métier d’acteur : descriptions très précises de tournages, de répétitions, d’attentes, de représentations devant le public, partagées avec le lecteur comme s’il y était. Le roman nous fait suivre cinquante ans de la vie de Luisa, de son enfance sur l’île de San Pedro, dans les Caraïbes, où elle naît en 1926, jusqu’à l’âge de la maturité et des projets réalisés.
Le roman nous fait suivre cinquante ans de la vie de Luisa, de son enfance sur l’île de San Pedro, dans les Caraïbes, où elle naît en 1926, jusqu’à l’âge de la maturité et des projets réalisés. Brooklyn Follies a d’emblée quelque chose d’évident, comme si le narrateur – Nathan, un sexagénaire divorcé et tout juste retraité des assurances – nous était familier, et qui nous donne en même temps une furieuse envie de le connaître tout à fait.
Brooklyn Follies a d’emblée quelque chose d’évident, comme si le narrateur – Nathan, un sexagénaire divorcé et tout juste retraité des assurances – nous était familier, et qui nous donne en même temps une furieuse envie de le connaître tout à fait. Il y a quelques mois,
Il y a quelques mois, 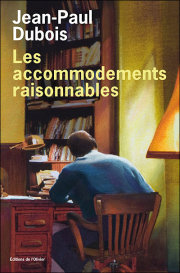 Suivre la famille Stern pendant douze mois, à travers Paul, quinquagénaire, époux, père, grand-père et fils, tel est l’objet du dernier roman de Jean-Paul Dubois, publié comme ses succès précédents aux Éditions de l’Olivier.
Suivre la famille Stern pendant douze mois, à travers Paul, quinquagénaire, époux, père, grand-père et fils, tel est l’objet du dernier roman de Jean-Paul Dubois, publié comme ses succès précédents aux Éditions de l’Olivier.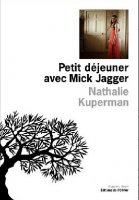 Pour mieux les connaître et découvrir leurs secrets, Olivier Cohen a demandé à des auteurs d’écrire sur leurs héros préférés.
Pour mieux les connaître et découvrir leurs secrets, Olivier Cohen a demandé à des auteurs d’écrire sur leurs héros préférés.