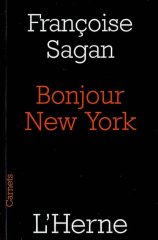 New York, Capri, Naples, Venise… elle y est allée, elle a vu, ressenti.
New York, Capri, Naples, Venise… elle y est allée, elle a vu, ressenti.
Elle a vécu quelques jours, quelques semaines dans ces villes mythiques, le temps parfois d’y prendre ses habitudes. Elle ne prétend pas connaître. Elle n’en fait pas un roman. Elle nous offre simplement son regard.
Quand Françoise Sagan s’est fait ainsi "reporter" pour le magazine Elle dans les années 1950, cela donnait :
Car New York est aussi une grande école. C’est à New York que débarquent d’Europe les étrangers. Vingt races différentes qu’il va falloir transformer en Américains. (…) Tous ont adopté ces interpellations à la fois courtoises et barbares, ces sourires vides, cette vraie cordialité, si généreuse, cette assurance de faire partie d’un tout, ce souci de l’uniformité.
Un peu plus loin :
A quel coin de rue commence l’Amérique, qui n’y renonce jamais ? On n’efface pas si facilement de la mémoire les souvenirs de la douce et vieille Europe, de l’amère et vieille Asie. Sur les trottoirs de New York, le regard ricoche comme des cailloux sur une eau grise, allant d’une rive du monde à l’autre. (…)
Sans doute parlera-t-on des défilés de fierté nationale, et du sentiment triomphant, parfois pénible d’être américain. Mais en fait ce porte-à-porte, ce frontière-à-frontière n’est qu’une traversée de nostalgies en nostalgies.
Le recueil ne compte qu’une cinquantaine de pages, petites et imprimées en gros caractères. Autant dire que le commencer est déjà le finir. Mais deux jours après on a envie de le relire. Car Françoise Sagan n’écrivait comme personne. Elle avait le brio involontaire et l’élégance évidente. Elle conciliait l’acuité du regard à une légèreté profonde. Sa singularité, sa plume précise et son souffle efficace séduisent encore et toujours. La retrouver avec ces petits carnets de voyage est un pur bonheur.
Bonjour New York. Françoise Sagan
L’Herne (2007)
54 p., 9,50 €
 Au bord de l’abîme et dans le refus du deuil, le narrateur raconte son amour perdu : l’histoire encore brûlante et tragique de Sola, romancière de l’extrême qui finit par se suicider.
Au bord de l’abîme et dans le refus du deuil, le narrateur raconte son amour perdu : l’histoire encore brûlante et tragique de Sola, romancière de l’extrême qui finit par se suicider.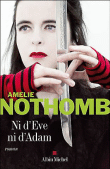 Lire toute la production d’Amélie Nothomb exposerait à deux risques, celui de la lassitude et, pire, celui de tomber de temps en temps sur de piètres écrits.
Lire toute la production d’Amélie Nothomb exposerait à deux risques, celui de la lassitude et, pire, celui de tomber de temps en temps sur de piètres écrits. Voici le monde délicat des âmes errantes, des habitants de la ville qui ne s’ancrent véritablement que dans les rues et les cafés, dans ces lieux de passage qui, chez Modiano, deviennent des lieux à part entière, et même au-delà, des lieux de mémoire.
Voici le monde délicat des âmes errantes, des habitants de la ville qui ne s’ancrent véritablement que dans les rues et les cafés, dans ces lieux de passage qui, chez Modiano, deviennent des lieux à part entière, et même au-delà, des lieux de mémoire. Neige, publié en 2005 a connu un grand succès critique et public. Parmi ses précédents romans, Le livre noir et Mon nom est rouge ont valu à l’écrivain turc Orhan Pamuk une grande renommée et de nombreuses distinctions. Son dernier roman, Istanbul, Souvenirs d’une ville a été publié en 2007.
Neige, publié en 2005 a connu un grand succès critique et public. Parmi ses précédents romans, Le livre noir et Mon nom est rouge ont valu à l’écrivain turc Orhan Pamuk une grande renommée et de nombreuses distinctions. Son dernier roman, Istanbul, Souvenirs d’une ville a été publié en 2007. Olivier Adam a l’art de décrire les souffrances intimes, les moments de vide, la solitude, la détresse, l’errance, la perte de soi. Il le fait avec finesse, sobriété, de son écriture courte qui oscille entre délicatesse et coup de poing.
Olivier Adam a l’art de décrire les souffrances intimes, les moments de vide, la solitude, la détresse, l’errance, la perte de soi. Il le fait avec finesse, sobriété, de son écriture courte qui oscille entre délicatesse et coup de poing. Bleue van Meer a seize ans. Sa mère, qui ne parvenait à attraper que les papillons les plus rares, est morte dans un accident alors que Bleue était toute petite.
Bleue van Meer a seize ans. Sa mère, qui ne parvenait à attraper que les papillons les plus rares, est morte dans un accident alors que Bleue était toute petite. Combien de temps a-t-il fallu à Yasmina Reza pour être séduite par Nicolas Sarkozy ? On ne le sait pas exactement.
Combien de temps a-t-il fallu à Yasmina Reza pour être séduite par Nicolas Sarkozy ? On ne le sait pas exactement.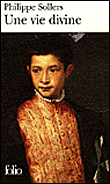 Contre la résignation, le nivellement par le bas, le triste et misérable bougli-bougla culturel et sexuel, le modèlement social, l’anxiété générale, voici le singulier, l’esprit, l’esthétique, la joie.
Contre la résignation, le nivellement par le bas, le triste et misérable bougli-bougla culturel et sexuel, le modèlement social, l’anxiété générale, voici le singulier, l’esprit, l’esthétique, la joie. A la toute fin de A la recherche du temps perdu, alors qu’il est malade et craint de ne pas avoir la force d’écrire son oeuvre, le narrateur évoque ce moment de réminiscences où, lorsqu’il était dans l’hôtel des Guermantes, un tintement de sonnette lui fit "entendre" celui qui, quand il était enfant, à Combray, marquait le signal du départ de M. Swann que ses parents venaient de raccompagner à l’entrée du jardin, c’est-à-dire celui du moment où il pourrait embrasser sa mère avant de dormir.
A la toute fin de A la recherche du temps perdu, alors qu’il est malade et craint de ne pas avoir la force d’écrire son oeuvre, le narrateur évoque ce moment de réminiscences où, lorsqu’il était dans l’hôtel des Guermantes, un tintement de sonnette lui fit "entendre" celui qui, quand il était enfant, à Combray, marquait le signal du départ de M. Swann que ses parents venaient de raccompagner à l’entrée du jardin, c’est-à-dire celui du moment où il pourrait embrasser sa mère avant de dormir.