 Au début des années 1930, l’écrivain Walter Benjamin fuit l’Allemagne pour se réfugier à Ibiza puis à Paris, en passant par le Danemark.
Au début des années 1930, l’écrivain Walter Benjamin fuit l’Allemagne pour se réfugier à Ibiza puis à Paris, en passant par le Danemark.
Ses conditions d’existence sont précaires ; son isolement, les difficultés à trouver du matériau et des soutiens pour ses travaux le minent.
Malgré ce quotidien souvent problématique, il ne cesse d’écrire, de trouver des sujets d’intérêt et d’investigation, notamment Paris et le XIXème siècle.
Gretel Karplus, diplômée de Chimie, compagne du philosophe Theodor Wiesengrund-Adorno fait la connaissance de Benjamin à Berlin peu de temps avant son départ.
Lorsque leur correspondance débute, elle vient d’être embauchée dans une manufacture de gants, dont elle prendra la direction rapidement.
Adorno enseigne à Oxford et la laisse pour l’essentiel du temps seule à Berlin, étreinte par le travail et ses responsabilités de chef d’entreprise.
Autour d’elle, la capitale allemande se dépeuple chaque jour davantage.
La correspondance de Gretel Karplus-Adorno et Walter Benjamin peut dans ce contexte apparaitre comme le trait d’union entre deux êtres écrasés par la solitude, dont chaque lettre vient alléger un peu le fardeau.
Mais elle ne ne peut être réduite à ce seul aspect.
Elle est aussi la marque d’une amitié sincère et profonde entre une femme et un homme devenus nécessaires l’un à l’autre et qui, par là-même pose la question : qu’est-ce que l’amitié entre un homme et une femme ?
Entre Gretel Karplus et Walter Benjamin, c’est d’abord une relation fraternelle, faite de protection et de dévouement mutuels, mais aussi un espace de liberté, de franchise et de respect.
Il y a cependant un autre partage : Walter Benjamin, malgré son absence de suffisance, et l’humilité à laquelle son dénuement l’astreint est aussi l’homme littéraire qui joue auprès de Gretel Karplus le rôle – et il est étonnant qu’il ait cette place à côté d’Adorno, dont Gretel Karplus future Mme Adorno est visiblement très amoureuse – de « partenaire intellectuel » .
S’il lui demande régulièrement les livres dont il a besoin pour son travail, il lui envoie sans cesse à son tour des romans, français notamment, qu’il choisit pour son amie dévoreuse de livres.
De son côté, Gretel Karplus – figure d’indépendance féminine malgré son besoin de protection – lui donne avec assurance son avis sur ses lectures, avis que son correspondant ne manque pas de solliciter le cas échéant.
Malgré l’aura de son compagnon Adorno, elle exprime franchement à Benjamin ce qu’elle pense de ses écrits et l’encourage systématiquement dans son travail.
Une estime intellectuelle extraordinairement réciproque, Benjamin regrettant souvent les « discussions sérieuses » qu’il avait avec elle. Ainsi, en 1939, alors qu’accablé tant par les difficultés personnelles que par la situation politique en Europe, il a de plus en plus de mal à écrire, il lui confie, à propos de ses travaux en cours : « Comme ce serait important pour moi d’en parler avec toi, un être sensé ! ».
Mais elle l’aide aussi matériellement autant qu’elle le peut, le conseille si elle anticipe une mauvaise direction, dans tous les sens du terme.
Lui a souvent des mots tendres, parfois poétiques, s’enquiert avec urgence de sa santé dans les périodes de migraines névralgiques qui la handicapent régulièrement.
D’un grand frère confident à une jeune femme en détresse ( « Comme toujours, je m’adresse à toi lorsque j’ai quelque chose sur le coeur dont je n’arrive pas à venir à bout » lui écrit-elle en 1937 lorsque le mariage avec Adorno qu’elle attend depuis des années lui paraît enfin possible), d’une mère protectrice à un écrivain desespéré, c’est une alchimie de forces et de fragilités qu’est faite cette singulière relation entre deux êtres dont la curiosité intellectuelle, le désir de connaître, la vivacité d’esprit sont le socle commun et inébranlable.
Jalonnée de joie, d’inquiétudes et de crises, c’est plus qu’une amitié, c’est presque une histoire d’amour : « où passe finalement la subtile limite entre amitié et amour ? ». C’est Gretel Adorno qui un jour pose ouvertement la question.
Gretel Adorno – Walter Benjamin. Correspondance 1930-1940
Le Promeneur – Gallimard (2007)
411 p., 26,50 €

 Le premier séjour, de plusieurs années, que le narrateur fait dans une maison de santé est suivi d’un autre plus long encore, dans une nouvelle maison, où il ne guérit pas davantage.
Le premier séjour, de plusieurs années, que le narrateur fait dans une maison de santé est suivi d’un autre plus long encore, dans une nouvelle maison, où il ne guérit pas davantage. Revenu à Paris après de longues années passées en vain dans une maison de santé, le narrateur, qui a perdu tout espoir d’écrire, notamment en perdant, plus généralement, toute foi en la littérature, se rend à une matinée chez le prince de Guermantes.
Revenu à Paris après de longues années passées en vain dans une maison de santé, le narrateur, qui a perdu tout espoir d’écrire, notamment en perdant, plus généralement, toute foi en la littérature, se rend à une matinée chez le prince de Guermantes. Alors qu’il se rend à une matinée, le narrateur, trébuchant sur deux pavés disjoints de la cour de l’hôtel des Guermantes, éprouve la même et heureuse sensation qu’il avait connue, bien des années auparavant, sur deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc à Venise.
Alors qu’il se rend à une matinée, le narrateur, trébuchant sur deux pavés disjoints de la cour de l’hôtel des Guermantes, éprouve la même et heureuse sensation qu’il avait connue, bien des années auparavant, sur deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc à Venise. En 1916, après de longues années passées à se faire soigner dans une maison de santé, le narrateur revient à Paris.
En 1916, après de longues années passées à se faire soigner dans une maison de santé, le narrateur revient à Paris. Lors de son séjour de « retour » à Combray, au cours duquel il n’éprouve pas l’émotion qu’il avait espérée, le narrateur séjourne chez Gilberte, la fille de Swann, devenue Mme de Saint-Loup.
Lors de son séjour de « retour » à Combray, au cours duquel il n’éprouve pas l’émotion qu’il avait espérée, le narrateur séjourne chez Gilberte, la fille de Swann, devenue Mme de Saint-Loup. Lors de sa promenade solitaire dans Paris, le narrateur, après avoir rencontré par hasard M. de Charlus s’aperçoit qu’il s’est fortement éloigné de chez lui et qu’il ne pourra rentrer avant d’avoir pris quelque boisson et repos.
Lors de sa promenade solitaire dans Paris, le narrateur, après avoir rencontré par hasard M. de Charlus s’aperçoit qu’il s’est fortement éloigné de chez lui et qu’il ne pourra rentrer avant d’avoir pris quelque boisson et repos. Dans Elles, succession de courts récits sur les femmes que J.-B. Pontalis a connues, aimées, dont il a lu ou entendu l’histoire, le célèbre psychanalyste parle-t-il véritablement des femmes ?
Dans Elles, succession de courts récits sur les femmes que J.-B. Pontalis a connues, aimées, dont il a lu ou entendu l’histoire, le célèbre psychanalyste parle-t-il véritablement des femmes ?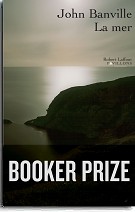 A l’aube de la vieillesse, Max perd son épouse, vaincue par la maladie.
A l’aube de la vieillesse, Max perd son épouse, vaincue par la maladie. Au début des années 1930, l’écrivain Walter Benjamin fuit l’Allemagne pour se réfugier à Ibiza puis à Paris, en passant par le Danemark.
Au début des années 1930, l’écrivain Walter Benjamin fuit l’Allemagne pour se réfugier à Ibiza puis à Paris, en passant par le Danemark. Le narrateur finit par faire avec sa mère le voyage à Venise dont il rêvait si fort et depuis si longtemps, auquel il avait même un temps renoncé après la mort d’Albertine.
Le narrateur finit par faire avec sa mère le voyage à Venise dont il rêvait si fort et depuis si longtemps, auquel il avait même un temps renoncé après la mort d’Albertine.