 Dès leur première rencontre, en 1946, ils se reconnurent.
Dès leur première rencontre, en 1946, ils se reconnurent.
Derrière eux, il y avait la guerre, la Résistance, et les engagements d’avant-guerre.
Ils appartenaient à la même espèce d’hommes.
De ce passé, des combats menés, et de ceux à mener encore naquit un respect mutuel sur lequel s’épanouit une profonde amitié.
La correspondance d’Albert Camus et René Char suit le lien précieux que l’écrivain et le poète développèrent au fil de leurs écrits respectifs, de leurs doutes, de leurs succès, de leurs préoccupations.
Tous deux se tiennent au courant de leurs travaux, s’envoient ou se font envoyer leurs manuscrits à peine achevés, se dédicacent leurs livres.
Il tient dans ces gestes non seulement une admiration réciproque, mais aussi et surtout le sentiment de maintenir le cap dans la même direction.
Si l’un comme l’autre demeure le plus souvent laconique sur les difficultés qu’il rencontre, pour ne pas « encombrer » l’autre, ni alourdir un quotidien qu’il sait déjà chargé, l’ami vient rappeler sa présence, demander des nouvelles, renouveler sans cesse son soutien. Leur commune délicatesse est exemplaire.
Malgré la pudeur, lorsqu’avec le temps les soucis deviennent trop pesants, et qu’avec le temps aussi la confiance et l’estime se renforcent encore, ils s’épanchent plus longuement.
Leur correspondance en devient extrêmement attachante. La figure de Char se dessine à travers ses lettres de façon progressive. Colosse qui sait si bien se défendre (comme on peut le voir à travers les aventures littéraires de l’époque) et qui a souvent l’air de « protéger » un Albert Camus en proie à la maladie aussi bien qu’aux attaques virulentes, notamment de Jean-Paul Sartre, René Char se met pourtant à exprimer furtivement sa souffrance.
Quant à Camus, malgré l’anxiété permanente, et souvent pire, il ne lâche rien de son amour de la vie, de son humanisme.
Enviable amitié :
« Un peu, où êtes-vous, cher Albert ?
J’ai la sensation cruelle, tout à coup, de vous avoir perdu. Le Temps se fait en forme de hache.
A quand ? »
(carte postale de René Char, le 14 septembre 1957).
Réponse de Camus :
« Plus je vieillis et plus je trouve qu’on ne peut vivre qu’avec les êtres qui vous libèrent, et qui vous aiment d’une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. (…) C’est ainsi que je suis votre ami, j’aime votre bonheur, votre liberté, votre aventure en un mot, et je voudrais être pour vous le compagnon dont on est sûr, toujours. »
(17 septembre 1957).
Et Char d’ajouter :
« Ils sont en si petit nombre ceux que nous aimons réellement et sans réserve, qui nous manquent et à qui nous savons manquer parfois, mystérieusement, si bien que les deux sensations, celle en soi et celle qu’on perçoit chez l’autre emporte même élancement et même souci … »
(septembre 1957).
Mais c’est aussi à l’amour de la lumière du sud que les deux hommes se sont reconnus. L’un né en Algérie ne se fera jamais à Paris, l’autre natif de l’Isle-sur-Sorgue n’aura de cesse d’y revenir. C’est là-bas dans le Vaucluse qu’ils partageront et assouviront leurs besoins de soleil et de grands espaces.
René Char y invitera systématiquement Albert Camus et cherchera pour lui une maison à acheter dans la région.
En peu de mots, la communion sur ce sujet semble totale.
« Ici il pleut, Paris a sa gueule d’acné. Je vous envie d’être au pays, le seul. »
(Camus, le 19 septembre 1950).
« Le contre-poison à l’arbre de bâtisse parisien, c’est l’arbre saisonnier de la forêt. »
(René Char, 20 octobre 1952).
Et encore :
« Le bel arc-en-ciel de vos livres fait ma joie. ensemble, ils miroitent entre le jour et la lampe, comme une truite de la Sorgue, entre gravier et cresson.
» (René Char, 29 octobre 1953).
Albert Camus – René Char, Correspondance 1946-1959
Edition établie, présentée et annotée par Franck Planeille
Gallimard, 263 p., 20 € (mai 2007)

 Au début du Temps retrouvé, le dernier tome de A la recherche du temps perdu, le narrateur retourne à Combray.
Au début du Temps retrouvé, le dernier tome de A la recherche du temps perdu, le narrateur retourne à Combray. Albertine est partie et ne reviendra pas.
Albertine est partie et ne reviendra pas. A la fin de La Fugitive, alors que son amour pour Albertine est éteint et qu’aucun autre n’est venu le remplacer, le narrateur apprend le mariage de deux de ses connaissances, son ami Robert de Saint-Loup et le fils Cambremer.
A la fin de La Fugitive, alors que son amour pour Albertine est éteint et qu’aucun autre n’est venu le remplacer, le narrateur apprend le mariage de deux de ses connaissances, son ami Robert de Saint-Loup et le fils Cambremer. Le narrateur est terrassé de chagrin par la mort d’Albertine.
Le narrateur est terrassé de chagrin par la mort d’Albertine. « Mademoiselle Albertine est partie ! ».
« Mademoiselle Albertine est partie ! ». Albertine est donc repartie chez elle en Tourraine, laissant le narrateur en proie aux pires douleurs.
Albertine est donc repartie chez elle en Tourraine, laissant le narrateur en proie aux pires douleurs. Andreossi a lu Dans le scriptorium, le dernier roman de Paul Auster, et m’a fait part de son commentaire.
Andreossi a lu Dans le scriptorium, le dernier roman de Paul Auster, et m’a fait part de son commentaire. Dès leur première rencontre, en 1946, ils se reconnurent.
Dès leur première rencontre, en 1946, ils se reconnurent. Dans La prisonnière, le narrateur, épris d’Albertine, la tient chez lui en liberté très surveillée.
Dans La prisonnière, le narrateur, épris d’Albertine, la tient chez lui en liberté très surveillée.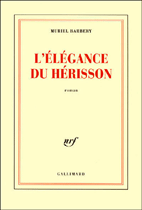 Renée est concierge dans une immeuble cossu du 7ème arrondissement.
Renée est concierge dans une immeuble cossu du 7ème arrondissement.