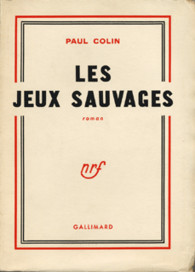 L’auteur du Goncourt 1950 est complètement oublié, et on ne voit pas comment il aurait pu en être autrement. Que son roman ait devancé cette année-là Marguerite Duras et son « Barrage contre le Pacifique » relève d’un des plus grands mystères de l’attribution du Goncourt. Mais Paul Colin a peut-être été assez lucide sur ses talents pour se retirer, sitôt le prix obtenu, sur une propriété viticole et ne publier qu’un seul autre roman une dizaine d’années plus tard.
L’auteur du Goncourt 1950 est complètement oublié, et on ne voit pas comment il aurait pu en être autrement. Que son roman ait devancé cette année-là Marguerite Duras et son « Barrage contre le Pacifique » relève d’un des plus grands mystères de l’attribution du Goncourt. Mais Paul Colin a peut-être été assez lucide sur ses talents pour se retirer, sitôt le prix obtenu, sur une propriété viticole et ne publier qu’un seul autre roman une dizaine d’années plus tard.
Les jeux sauvages sont d’abord des jeux d’enfance, marqués par la violence des garçons, qu’elle s’exerce sur les filles ou sur les autres enfants de plus basse extraction sociale. Quatre enfants jouent ensemble, un frère et une sœur, une amie à eux et François, d’abord narrateur puis héros à la troisième personne. La violence est clairement valorisée : « lorsque je me revois dans mon furieux assaut je pense que les plus hauts exploits sont accomplis sous le coup de cette colère subite, si puissante qu’elle décuple votre force en même temps qu’elle vous enlève toute faculté de réfléchir ».
Les coups reçus par les filles ne sont qu’une sorte d’apprentissage pour la vie d’adulte. Au delà de la banale misogynie, il s’agit d’humilier (« Baumier, d’un ample mouvement du bras comme pour rattraper une balle basse à la paume, lui appliqua vivement sa large main sur les fesses : – Sacrée petite volaille ! »), et éventuellement de réduire la compagne au statut d’esclave amoureuse : « Je saurai bien la briser, disait-il. Je la briserai, je la briserai… Et cette colère, à la vérité, était singulièrement exaltante ». Auparavant l’autre garçon a assassiné une adolescente.
Que peut-on sauver de ce roman ? Difficile de trouver des arguments. L’ensemble est particulièrement mal ficelé, les personnages fort peu crédibles, des formes d’écriture totalement invraisemblables, en particulier lorsqu’il s’agit de lettres échangées par les protagonistes, et des digressions qui tombent comme un cheveu sur la soupe (par exemple sur la culture de l’asperge).
On pourrait penser que l’auteur dénonce les situations qu’il décrit. Rien, ni dans le contenu ni dans la forme ne peut nous le faire supposer. On a le sentiment que des fantasmes masculins se laissent librement aller, comme si le narrateur devait exercer une vengeance sur les femmes dont l’origine lui est inconnue.
« C’était une grosse molasse à faire sauter tous les boutons de sa blouse dangereusement tendue sur les mamelles et sur les fesses ; ses bras nus lui pendaient des épaules aux hanches, son encolure dégagée tirait sur la boutonnière de son corsage, le tout bien blanc, avec des bourrelets, coussinets, matelassures ; un premier prix de concours agricole, tout en viande et réserve de graisse ».
Andreosssi
Les jeux sauvages. Paul Colin
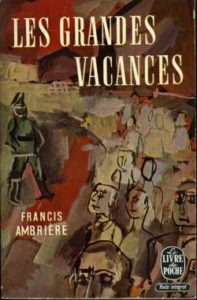 Drôle de titre pour ce prix Goncourt 1940, décerné en fait en 1946, pour cause de perturbation due à la guerre 39-40 : il s’agit du récit de la vie d’un prisonnier de guerre français sous le régime nazi, soit cinquante six mois de vie en camp décrits avec une précision journalistique.
Drôle de titre pour ce prix Goncourt 1940, décerné en fait en 1946, pour cause de perturbation due à la guerre 39-40 : il s’agit du récit de la vie d’un prisonnier de guerre français sous le régime nazi, soit cinquante six mois de vie en camp décrits avec une précision journalistique.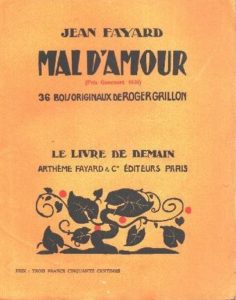 Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit…
Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit…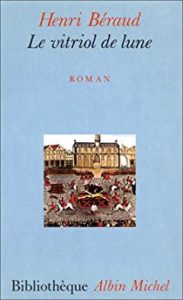 Le vitriol de lune est un poison qui aurait été utilisé par les assassins de Louis XV, selon Henri Béraud qui obtint par ce roman historique le Goncourt 1922. Curieusement le livre a été pour ce même prix couplé à un autre roman du même auteur, Le Martyre de l’obèse, alors que la qualité du Vitriol de lune suffit au plaisir du lecteur.
Le vitriol de lune est un poison qui aurait été utilisé par les assassins de Louis XV, selon Henri Béraud qui obtint par ce roman historique le Goncourt 1922. Curieusement le livre a été pour ce même prix couplé à un autre roman du même auteur, Le Martyre de l’obèse, alors que la qualité du Vitriol de lune suffit au plaisir du lecteur.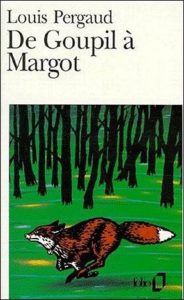 Les histoires de bêtes de Louis Pergaud (prix Goncourt 1910) ne sont pas des fables. Il nous conte la vie des animaux dans leur cadre naturel, confrontés à leurs semblables ou aux humains, dans un monde où règne la sauvagerie, à peu près la même qui a fait perdre la vie à Pergaud à Verdun, en 1915.
Les histoires de bêtes de Louis Pergaud (prix Goncourt 1910) ne sont pas des fables. Il nous conte la vie des animaux dans leur cadre naturel, confrontés à leurs semblables ou aux humains, dans un monde où règne la sauvagerie, à peu près la même qui a fait perdre la vie à Pergaud à Verdun, en 1915.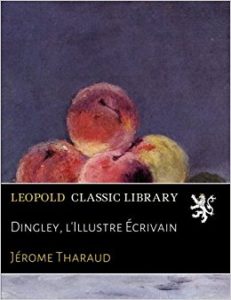 Le quatrième Prix Goncourt, en 1906, a été un ouvrage des frères Tharaud. Connus pour avoir toujours écrit à quatre mains plus de cinquante livres, ils sont entrés à l’Académie Française dans les années 40. Celui-ci est un court roman, qui évoque pour nous une guerre lointaine, celle des Boers en Afrique du Sud.
Le quatrième Prix Goncourt, en 1906, a été un ouvrage des frères Tharaud. Connus pour avoir toujours écrit à quatre mains plus de cinquante livres, ils sont entrés à l’Académie Française dans les années 40. Celui-ci est un court roman, qui évoque pour nous une guerre lointaine, celle des Boers en Afrique du Sud. Le Goncourt de l’an 2000 n’a pas inauguré une nouvelle ère de la littérature : on a du mal à s’intéresser à ces personnages publics des années 70, artistes qui ont certes marqué leur temps mais dont les anecdotes qui les font vivre sous nos yeux ne réussissent pas à réaliser des portraits qui les rendent vraiment attachants.
Le Goncourt de l’an 2000 n’a pas inauguré une nouvelle ère de la littérature : on a du mal à s’intéresser à ces personnages publics des années 70, artistes qui ont certes marqué leur temps mais dont les anecdotes qui les font vivre sous nos yeux ne réussissent pas à réaliser des portraits qui les rendent vraiment attachants. C’est avec intérêt qu’on lit ce roman prix Goncourt de 1980, et avec amusement que l’on découvre certaines formules (« peindre des natures vivantes », ou « la place qui respire à plein poumons morts » ou encore lorsque les malentendus sont plutôt des « mal écoutés ») ; mais malgré ces clins d’œil, le climat du livre reste très pesant, car on assiste, pour la plupart des personnages, à l’impossibilité de faire leur deuil de la perte d’un proche.
C’est avec intérêt qu’on lit ce roman prix Goncourt de 1980, et avec amusement que l’on découvre certaines formules (« peindre des natures vivantes », ou « la place qui respire à plein poumons morts » ou encore lorsque les malentendus sont plutôt des « mal écoutés ») ; mais malgré ces clins d’œil, le climat du livre reste très pesant, car on assiste, pour la plupart des personnages, à l’impossibilité de faire leur deuil de la perte d’un proche. Un Goncourt 1974 vite lu car très court, mais qui laisse bien songeur. Car ce portrait de cette jeune femme, Pomme, nous semble à la fois très suggestif (nous avons l’impression de l’avoir rencontrée), et aussi très incomplet car, comme le narrateur le reconnaît à la fin du roman, nous avons le sentiment d’avoir manqué Pomme.
Un Goncourt 1974 vite lu car très court, mais qui laisse bien songeur. Car ce portrait de cette jeune femme, Pomme, nous semble à la fois très suggestif (nous avons l’impression de l’avoir rencontrée), et aussi très incomplet car, comme le narrateur le reconnaît à la fin du roman, nous avons le sentiment d’avoir manqué Pomme.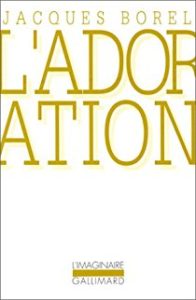 Une grosse autobiographie a eu les honneurs du Goncourt 1965. Ce discours sur soi ne manque pas d’intérêt et l’écriture est impeccable, faite de phrases longues et bien balancées. Bien sûr le lecteur intéressé souscrit aux lois du genre : une vie présentée comme un roman qui serait vrai, hypothèse qui demande d’accepter ce qui n’est, au bout du compte, que l’épanouissement d’un ego sans possibilité de confirmation par les autres protagonistes du roman.
Une grosse autobiographie a eu les honneurs du Goncourt 1965. Ce discours sur soi ne manque pas d’intérêt et l’écriture est impeccable, faite de phrases longues et bien balancées. Bien sûr le lecteur intéressé souscrit aux lois du genre : une vie présentée comme un roman qui serait vrai, hypothèse qui demande d’accepter ce qui n’est, au bout du compte, que l’épanouissement d’un ego sans possibilité de confirmation par les autres protagonistes du roman.