 Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence.
Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence.
Les historiens peuvent trouver intérêt à cette description des idées débattues juste après la Libération de 1945. Les protagonistes, dont la critique a reconnu les traits (outre Simone de Beauvoir elle-même, Sartre et Camus en particulier), se trouvent pris entre les feux américains et soviétiques pour définir leur ligne politique. La grande affaire, qui va poser question longtemps en France, est l’attitude à adopter face au puissant Parti Communiste Français. Ne pas s’y associer n’est-ce pas faire le jeu de l’Amérique et abandonner l’espoir d’une URSS qui représente le contre modèle à l’exploitation capitaliste ?
Mais les cailloux dans les chaussures se font de plus en plus douloureux : les récits concernant les camps soviétiques passent désormais les frontières : faut-il les publier ou attendre d’être plus amplement informé ? L’éventail des positions apparaît dans les dialogues entre ces parisiens pour lesquels le monde se résume à leurs échanges. En termes d’action, on a tout de même, pour les plus excités, la chasse très expéditive aux collabos.
 On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis.
On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis.
La narratrice a peut-être tiré des leçons de son voyage du point de vue de la littérature. L’écrivain français, de son côté : « C’est à ça que ça sert la littérature : montrer aux autres le monde comme on le voit ; seulement voilà : il avait essayé, et il avait échoué ». Le romancier américain a d’autres qualités : « On sentait à travers ses récits qu’il ne se reconnaissait aucun droit sur la vie et que pourtant il avait toujours eu passionnément envie de vivre ; ça me plaisait, ce mélange de modestie et d’avidité ». Un aveu tardif mais réconfortant.
Andreossi
Les mandarins. Simone de Beauvoir
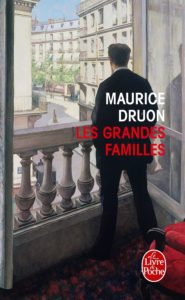 Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.
Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.

 Ce n’est pas que le prix Goncourt 1938 ne se lise pas sans intérêt, car tout au long du roman l’on se demande jusqu’où ira Gérard dans son odieux comportement vis-à-vis de ses sœurs. Mais qu’un tel personnage est pénible à suivre dans les méandres de ses bassesses !
Ce n’est pas que le prix Goncourt 1938 ne se lise pas sans intérêt, car tout au long du roman l’on se demande jusqu’où ira Gérard dans son odieux comportement vis-à-vis de ses sœurs. Mais qu’un tel personnage est pénible à suivre dans les méandres de ses bassesses !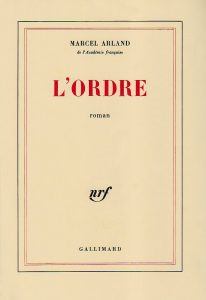 Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.
Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.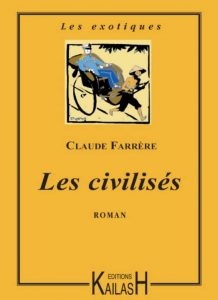 Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.
Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.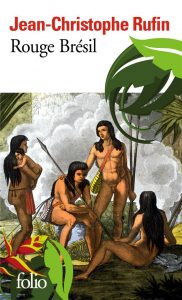 Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant.
Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant. Un livre fort que ce prix Goncourt 1996. Dans le genre plutôt court, après une lecture sans pause, il laisse le sentiment que tout est encore à comprendre dans la fascination de la narratrice pour le pilote kamikaze Tsurukawa.
Un livre fort que ce prix Goncourt 1996. Dans le genre plutôt court, après une lecture sans pause, il laisse le sentiment que tout est encore à comprendre dans la fascination de la narratrice pour le pilote kamikaze Tsurukawa. Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.
Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème. Bien sûr, il nous faut accepter de lire ce français étrange, image de l’acadien du XVIIIème siècle, qui fait toute la saveur du Goncourt 1979, si on veut en apprécier toute la richesse. Il faudra renoncer à comprendre tous les mots tout de suite, et patienter en comptant sur la répétition pour saisir le sens de « bâsir », « devanteau » ou « dumeshui ». La plupart de ces mots toutefois se laisse découvrir aisément (« asteur », « obstineux », « défricheter »).
Bien sûr, il nous faut accepter de lire ce français étrange, image de l’acadien du XVIIIème siècle, qui fait toute la saveur du Goncourt 1979, si on veut en apprécier toute la richesse. Il faudra renoncer à comprendre tous les mots tout de suite, et patienter en comptant sur la répétition pour saisir le sens de « bâsir », « devanteau » ou « dumeshui ». La plupart de ces mots toutefois se laisse découvrir aisément (« asteur », « obstineux », « défricheter »).