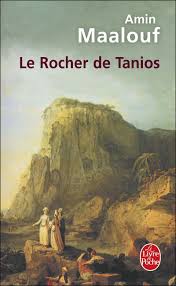 « En ce temps-là, le ciel était si bas qu’aucun homme n’osait se dresser de toute sa taille. Cependant, il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l’on n’attendait jamais le meilleur en ce monde, on espérait chaque jour échapper au pire ». C’est du Liban dont nous parle le Goncourt 1993 d’Amin Maalouf, pour nous conter l’histoire d’une disparition, celle du légendaire Tanios. Avant la disparition mystérieuse, une vie est reconstituée, dans une langue que l’on suivrait sur tous les chemins de l’imaginaire historique.
« En ce temps-là, le ciel était si bas qu’aucun homme n’osait se dresser de toute sa taille. Cependant, il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l’on n’attendait jamais le meilleur en ce monde, on espérait chaque jour échapper au pire ». C’est du Liban dont nous parle le Goncourt 1993 d’Amin Maalouf, pour nous conter l’histoire d’une disparition, celle du légendaire Tanios. Avant la disparition mystérieuse, une vie est reconstituée, dans une langue que l’on suivrait sur tous les chemins de l’imaginaire historique.
Le narrateur dit s’aider de divers documents d’époque (les années 1830) pour reconstituer le climat très particulier de luttes d’influence entre d’une part les autorités locales (Emir d’Egypte, Ottomans, Patriarche chrétien, cheikhs de village) et les puissances européennes (Angleterre, France) : chronique du village de Kfaryabda écrit par un moine, les carnets d’un pasteur anglican, les pensées d’un philosophe muletier. Et bien sûr les récits oraux que rapportent les vieilles personnes plus d’un siècle après les événements.
L’effet de vérité obtenu par ce procédé est aidé par un style enchanteur. La société est décrite de manière très imagée, les corps s’expriment selon des rites précis dans lesquels chaque geste a un sens. Ainsi la séance de visite du matin au cheikh : « Quant au métayer Chalhoub, compagnon de longue date à la guerre comme à la chasse, il allait lui aussi se pencher, mais avec une imperceptible lenteur, s’attendant à voir le maître retirer sa main, puis l’aider à se relever en lui donnant une brève accolade (…) S’agissant du métayer Ayyoub, qui s’était enrichi et qui venait de se faire construire une maison à Dayroun, il fallait l’aider également à se relever et lui donner une brève accolade, mais seulement après qu’il eut effleuré ses lèvres les doigts de son seigneur ».
La scène centrale du roman, l’assassinat du Patriarche, est écrite avec un grand sens du rythme : « Mais c’est au dernier moment qu’il l’aperçut, au tout dernier moment, quand il ne pouvait plus rien arrêter ; cependant que, de son regard il embrassait l’ensemble de la scène –les hommes, les bêtes, leurs geste, leurs expressions : le patriarche qui avançait sur son cheval, suivi de son escorte, une dizaine de cavaliers, et autant d’hommes à pied. Et Gérios, derrière un rocher, tête nue, l’arme à l’épaule. Le coup est parti ».
L’histoire de Tanios, à la recherche de son identité, partagé entre deux figures de père, nous devient attachante dans toutes ses péripéties, jusqu’à la fin inexpliquée : « Ce n’est pas ainsi que se prend la décision de partir. On n’évalue pas, on n’aligne pas inconvénients et avantages. D’un instant à l’autre on bascule. Vers une autre vie, vers une autre mort. Vers la gloire ou l’oubli. Qui dira jamais à la suite de quel regard, de quelle parole, de quel ricanement, un homme se découvre soudain étranger au milieu des siens ? Pour que naisse en lui cette urgence de s’éloigner, ou de disparaître ».
Andreossi
Le rocher de Tanios, Amin Maalouf
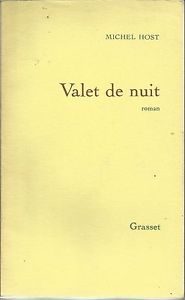 Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.
Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.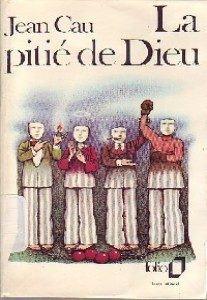 Retour à la littérature cette semaine, avec le prix Goncourt 1961 : assez difficile « à vendre », il faut le reconnaître ! L’occasion une fois de plus de redécouvrir avec le recul des années les choix du célèbre jury… et de prendre du recul par rapport à ceux-ci ! Bonne lecture quand même !
Retour à la littérature cette semaine, avec le prix Goncourt 1961 : assez difficile « à vendre », il faut le reconnaître ! L’occasion une fois de plus de redécouvrir avec le recul des années les choix du célèbre jury… et de prendre du recul par rapport à ceux-ci ! Bonne lecture quand même !  Pour la nouvelle année, on remonte 60 ans en arrière, avec le prix Goncourt 1957 relu par Andreossi. Partir dans le sud de l’Italie en ce début d’année, voici une idée séduisante…en tout cas en 2017… !
Pour la nouvelle année, on remonte 60 ans en arrière, avec le prix Goncourt 1957 relu par Andreossi. Partir dans le sud de l’Italie en ce début d’année, voici une idée séduisante…en tout cas en 2017… ! Notre feuilleton des prix Goncourt se poursuit, toujours grâce à notre ami Androssi. Cette semaine : le prix 1949.
Notre feuilleton des prix Goncourt se poursuit, toujours grâce à notre ami Androssi. Cette semaine : le prix 1949.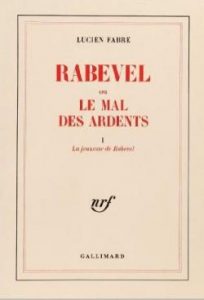 Alors que le prix Goncourt 2016 a été décerné cette semaine à Leïla Slimani pour « Chanson douce » (Gallimard), Andreossi a poursuivi pour nous la relecture des anciens Goncourt, avec le prix 1923.
Alors que le prix Goncourt 2016 a été décerné cette semaine à Leïla Slimani pour « Chanson douce » (Gallimard), Andreossi a poursuivi pour nous la relecture des anciens Goncourt, avec le prix 1923.  Les jurés des prix Goncourt de 1914 à 1918 ont tous couronné des œuvres évoquant la première guerre mondiale. Ces romans font part des horreurs de la guerre, mais l’esprit qui les anime a été fort différent. En cela, cette Flamme au poing de 1917 fait contraste avec
Les jurés des prix Goncourt de 1914 à 1918 ont tous couronné des œuvres évoquant la première guerre mondiale. Ces romans font part des horreurs de la guerre, mais l’esprit qui les anime a été fort différent. En cela, cette Flamme au poing de 1917 fait contraste avec  Revoici un billet maglm, avec le 21ème épisode des Goncourt. Cette semaine : Pascal Quignard ! Merci à Andreossi pour ce très beau billet !
Revoici un billet maglm, avec le 21ème épisode des Goncourt. Cette semaine : Pascal Quignard ! Merci à Andreossi pour ce très beau billet !
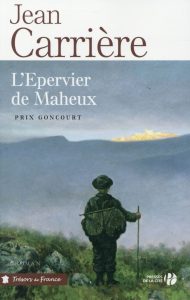 Andreossi nous livre le 18ème épisode du feuilleton des Goncourt, avec le prix 1972… Du rural, du rude… Bonne lecture ! Mag
Andreossi nous livre le 18ème épisode du feuilleton des Goncourt, avec le prix 1972… Du rural, du rude… Bonne lecture ! Mag