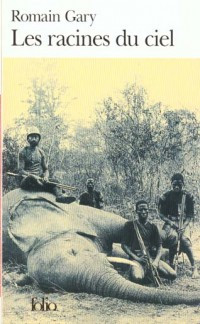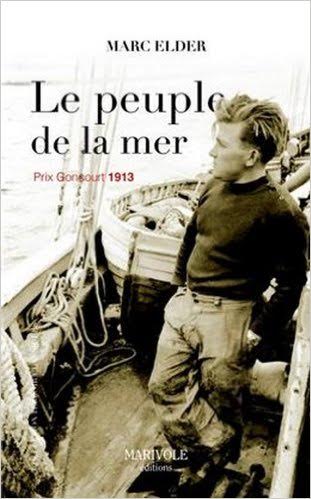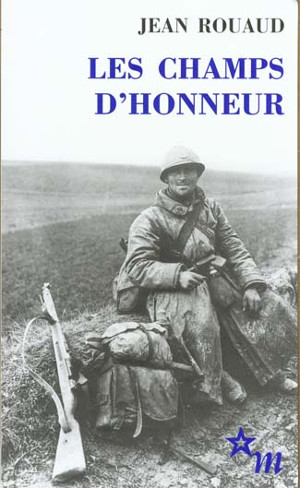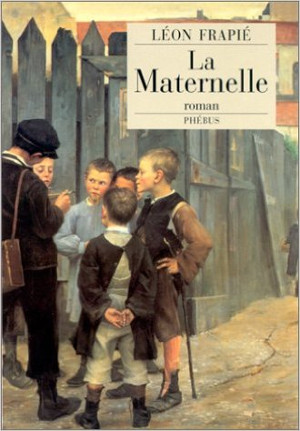Après plusieurs livraisons fort séduisantes, voici la recension du Prix Goncourt 1964 : un cru plutôt faible selon Andreossi… On attend le prochain !
Après plusieurs livraisons fort séduisantes, voici la recension du Prix Goncourt 1964 : un cru plutôt faible selon Andreossi… On attend le prochain !
Mag
Peu de plaisir de lecture dans ce Goncourt 1964, et pourtant ce n’est pas l’action qui manque : un jeune fonctionnaire, Avit, récemment plaqué par sa femme Laurence, vient prendre son poste dans un pays africain qui vient d’accéder à l’indépendance. Il retrouve sur place celui avec qui est partie son épouse, qui lui annonce que c’est fini entre eux puisqu’elle vit désormais avec un ministre du pays. Les Blancs qui acceptent mal la domination des nouveaux maîtres, et les Noirs qui se partagent entre esprit de revanche et lutte pour le pouvoir interviennent tragiquement dans cette histoire d’amour entre une Blanche et un Noir.
On a sans doute reconnu à l’ouvrage, à l’époque de sa sortie, le mérite de poser la question du racisme dans des termes qui n’en cachent pas sa « réciprocité ». Au bout du compte le lecteur est amené à conclure que Blancs comme Noirs sont coupables de folie raciste, et, dans un climat très pessimiste les deux communautés sont renvoyées dos à dos.
Le « héros » bien pâlichon de l’histoire est lui-même pris dans un engrenage de sentiments dont il est incapable de sortir : « A croupeton sur le trottoir, quatre nègres vendent des citrons, des papayes, de beaux ananas. Avit sait (cela ne s’apprend pas) qu’on ne voussoie point des nègres de cette classe, mais il est trop lâche (non pas trop timide : trop lâche) pour leur dire tu. Il lui faut attendre quelqu’un de sa race ».
Le malaise du lecteur d’aujourd’hui tient au fait que le récit reste au ras de l’action sans que jamais nous n’assistions à quelque prise de hauteur. Les personnages n’ont pas assez de consistance pour que la complexité individuelle de leur situation puisse émerger de la fange raciste dans laquelle ils sont plongés. L’auteur omniscient fait penser et parler les différents protagonistes, mais nous ne sommes pas sûrs qu’un point de vue de Blanc ne domine pas entièrement l’ensemble des propos, particulièrement dans le choix des mots.
Ainsi s’exprime le ministre amant de Laurence : « Serait-il donc désormais convenu dans ce pays que tout contact, de quelque ordre qu’il fût, entre une race et l’autre devait être non seulement blâmé, non seulement réprouvé par l’opinion, mais aussi condamné, en tant que tel, par l’Etat ?… Pour autant, bien entendu (l’idée lui était venue tout à coup), qu’on pût continuer de nommer Etat ce ramas de petits intérêts, de sottises, de préjugés, qui expulse aujourd’hui sans l’ombre d’un droit de le faire, et qui emprisonnera demain, qui tuera sans plus de motif, on est en chemin !…Tenait-on si fort à se faire les singes de la domination antérieure ? ».
Le choix du titre du roman, même s’il fait écho à la sauvagerie raciste, n’est pas sans portée non plus dans l’imaginaire Blanc : à vouloir dénoncer le racisme dans l’absolu on semble oublier le fait qu’il naît surtout au sein de situations historiques particulières.
Andreossi
L’Etat sauvage, Georges Conchon. Albin Michel 1964
 Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture !
Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture ! 15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag
15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag

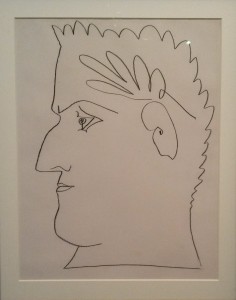

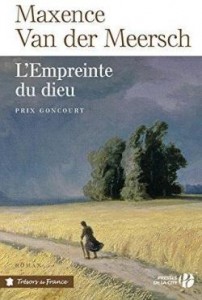 « L’empreinte du dieu », prix Goncourt 36, a inspiré Andreossi. Un billet qui donne bien envie d’aller y voir de plus près… Bonne lecture !
« L’empreinte du dieu », prix Goncourt 36, a inspiré Andreossi. Un billet qui donne bien envie d’aller y voir de plus près… Bonne lecture !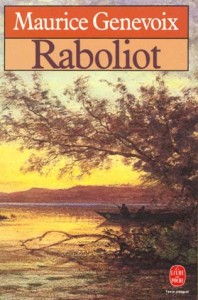 Voici la 13ème livraison du feuilleton des Prix Goncourt signé Andreossi. Il nous emmène cette fois à la campagne… il y a près d’un siècle. Bonne (re)découverte ! Mag
Voici la 13ème livraison du feuilleton des Prix Goncourt signé Andreossi. Il nous emmène cette fois à la campagne… il y a près d’un siècle. Bonne (re)découverte ! Mag