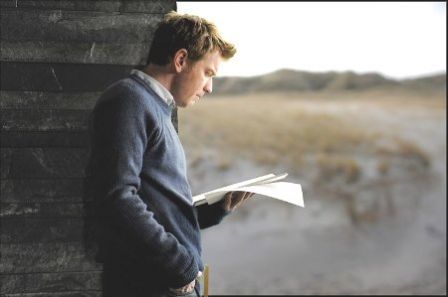Arezzo, Italie. James Miller, britannique, vient présenter son essai sur la valeur, supérieure selon lui, de la copie sur l’original en art. Une Française, jouée par Juliette Binoche et que le film ne nomme pas, y tient une galerie d’art. Elle suit la conférence, puis emmène James dans un petit village de la campagne toscane.
Ils y passeront tout leur dimanche, et le spectateur avec, suivant mot à mot leurs échanges, seul ressort du film, en tant que tel dépourvu de narration, mais contenant un récit – celui de ce couple – totalement captivant.
De la galerie d’art à Arezzo au petit village, le couple se rend dans un musée, puis dans un café, puis au pied d’une statue, dans un restaurant, dans une église et enfin dans une chambre d’hôtel – avec une fin très ouverte dans celle-ci.
Le tout sur fond de noce quasi-continu, ce village étant un défilé de mariages, un arbre (œuvre d’art du musée) y étant réputé porter bonheur.
Cette succession de lieux structure fondamentalement le film : à chaque étape correspond une nouvelle avancée dans le récit du couple.
Au départ, l’on a affaire à un homme et une femme qui semblent ne pas se connaître, se découvrant au prétexte d’une conversation sur la copie et l’original, lui dans les ressorts classiques de la séduction (brin de philosophie, humour, histoires à raconter), elle davantage dans l’échange, l’argumentation, la construction.
Et puis à un moment très précis, la situation bascule : elle et lui se mettent à parler comme s’ils formaient un vrai couple, marié depuis quinze ans. Le système se met en place comme un jeu, dont le point de départ est l’apparence ; il devient progressivement de plus en plus sérieux, au point que l’illusion semble devenir la réalité des personnages, le spectateur se trouvant alors embarqué à son tour dans le balancement et les interrogations sur l’original et la copie. Paroxysme de cette implication, à la fin du film, les protagonistes semblent chacun à un certain moment s’adresser au spectateur en regardant directement la caméra.
Dire que ce film est passionnant est encore peu dire.
Ce qu’il exprime sur l’homme, la femme, le couple a une force et une résonance universelles. Les deux acteurs, dont William Shimell qui à la base n’est pas comédien mais un célèbre baryton, portent les dialogues avec une évidence époustouflante.
Mais au delà des mots, le travail que leur a fait conduire le metteur en scène iranien passe tout autant par les gestes et les corps. Sur ses hauts talons, dans sa robe tournoyante, Juliette Binoche, ultra-féminine semble en permanence en mouvement, à la recherche de l’équilibre perdu, en quête d’ancrage. Ce qu’elle parvient à rendre de son personnage évoque davantage l’incarnation que l’interprétation, tant son registre en termes d’émotions, de combativité et d’abandon est confondant de naturel. Autour du geste, se joue un jeu copie/original vertigineux avec la statue sur la place, une copie, mais dont l’original a l’humain pour modèle, et à laquelle la femme voudrait que l’homme se conforme dans son geste de protection, et qu’en outre l’homme d’un couple d’âge mûr, de façon paternelle, invite James à imiter.
Les jeux de l’illusion et du miroir sont infinis, tant métaphoriquement que visuellement, avec notamment un renvoi à tous les âges du couple : des nouveaux mariés, des jeunes retraités et enfin des très âgés pouvant à peine marcher – tous des couples très unis – vont successivement se manifester devant nos deux protagonistes.
Ici et là l’on suit les reflets, des édifices dans le pare-brise de la voiture – quelle beauté, de la statue sur la place dans le miroir d’un antiquaire (que l’homme évitera aussi soigneusement qu’il évite la statue elle-même), et enfin, dans l’un des touts derniers plans, reflet de James dans le miroir, tendu du coup au spectateur aussi. Que voit l’homme quand il se regarde dans la glace ? Mystère. Mais dehors sonnent les clochent, baignées dans une lumière toscane magnifique, et prolongées d’une vibration merveilleuse, qui semble ne finir jamais.
Copie conforme
Un film de Abbas Kiarostami
Avec Juliette Binoche, William Shimell
Durée 1 h 46
Juliette Binoche a reçu le prix d’interprétation féminine pour son rôle dans Copie conforme au festival de Cannes clôturé ce dimanche 23 mai 2010.
Photo © MK2 Diffusion



 Créé à Naples en 1819, La Donna del lago n’avait jamais été monté à Paris.
Créé à Naples en 1819, La Donna del lago n’avait jamais été monté à Paris. Nul besoin d’un récit au sens traditionnel, nul besoin de tout comprendre pour aimer.
Nul besoin d’un récit au sens traditionnel, nul besoin de tout comprendre pour aimer.

 Dans les pages Débats du quotidien Le Monde daté de ce jeudi 13 mai, l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Yves Simon se place résolument, dans les ondulations actuelles du niqab et de la burqa, du côté du visage découvert.
Dans les pages Débats du quotidien Le Monde daté de ce jeudi 13 mai, l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Yves Simon se place résolument, dans les ondulations actuelles du niqab et de la burqa, du côté du visage découvert.