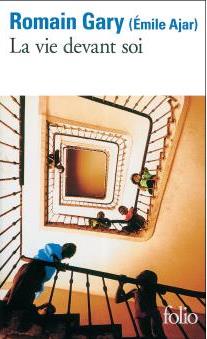
La lecture d’un peu plus de cent romans auréolés du prix Goncourt a apporté son lot de contrastes, du véritable enthousiasme à la franche consternation. Certes la forme de cette chronique, en voulant laisser une assez grande place à l’œuvre malgré un format réduit, a sensiblement atténué le premier sentiment, mais la subjectivité revendiquée d’un lecteur du vingt et unième siècle a fait ses choix : plus du tiers des textes couronnés ont eu un intérêt limité, voire très limité.
Cela ne paraît pas dépendant de l’ancienneté de la parution, tout au plus certaines périodes sont apparues plus creuses que d’autres en récits qui ont retenu l’attention : les années 40 par exemple, marquées par la seconde guerre mondiale, n’ont pas été à la hauteur des années 10 et 20 qui ont vu de très bons romans ayant pour thème la guerre de 14-18 primés. Seul l’attachant Pareil à des enfants de Marc Bernard, en 1942, émerge du lot, mais ne concerne pas le temps de l’Occupation. Autre période assez creuse mais plus longue, celle qui s’étend des années 60 aux années 90, dont la moitié des œuvres primées n’ont pas convaincu. Le nouveau siècle par contre semble prometteur.
Les thématiques de ces romans reflètent assez bien les questions majeures de nos sociétés : le thème de la guerre est le plus évident, pour un siècle qui a été bien servi de ce point de vue. Nous pouvons compter une trentaine de titres qui évoquent la guerre, avec pour les réussites, Le Feu, de Henri Barbusse, ou Civilisation, de Georges Duhamel et plus récemment Syngué sabour de Atiq Rahimi. Les romans « familiaux » constituent une autre grande catégorie et avec ceux qui concernent les histoires de couples ils totalisent aussi une trentaine d’ouvrages.
La bourgeoisie et la petite bourgeoisie sont les milieux sociaux nettement privilégiés, et rares sont les auteurs qui ont su avec talent rendre compte des milieux plus modestes, mais un Emile Ajar, avec La vie devant soi, nous a comblé. Les campagnes, en particulier, n’ont pas été bien mises en valeur par la littérature des Goncourt, si on excepte le très ancien Louis Pergaud et son De Goupil à Margot. Les écrivains ont été plus inspirés lorsqu’ils se sont éloignés de notre continent, et plus encore lorsqu’eux-mêmes et elles- mêmes venaient d’ailleurs. René Maran (Batouala), Antonine Maillet (Pélagie-la–Charrette), Patrick Chamoiseau (Texaco)ont merveilleusement enrichi la langue française.
L’élargissement des thématiques au cours du temps se remarque aussi par l’intérêt pour le passé. A partir des années 80 les auteurs récompensés ont plus souvent quitté leur époque strictement contemporaine pour placer leurs récits quelques décennies avant, ou même dans les siècles précédents. Cela nous a valu par exemple les très bons livres de Frédérick Tristan (Les égarés), de Jean Rouaud (Les champs d’honneur) ou de Laurent Gaudé (Le soleil des Scorta). Autre constatation, dans le choix du type de narrateur : nous avons été généralement plus sensible aux romans écrits à la première personne qu’à la troisième, comme si la vision « de l’intérieur » favorisait l’adhésion au récit. C’est le cas pour Béatrix Beck (Léon Morin, prêtre), Francis Walder (Saint Germain ou la négociation), Vintila Horia (Dieu est né en exil) ou encore Yves Navarre (Le jardin d’acclimatation).
Enfin, le thème de l’oppression, de la domination, a été à l’origine d’œuvres de qualité que n’a pas manqué de distinguer le prix Goncourt, dès les premières décennies d’attribution, avec René Maran (Batouala) et Henri Fauconnier (Malaisie) sur la question de la colonisation, puis plus tard, avec Romain Gary (Les racines du ciel) qui mêle colonialisme et écologie, André Schwartz-Bart sur l’antisémitisme (Le dernier des Justes), et Tahar Ben Jelloun (La nuit sacrée) sur la domination masculine.
Au total, il est difficile de conclure sur l’opportunité à suivre les jurés du Goncourt dans leur recommandation, même si, après tout, près de deux livres primés sur trois ont été lus avec intérêt. Peut-être serait-il curieux de comparer avec un autre prix littéraire : le Fémina par exemple, revendiqué comme concurrent direct dès 1904.
Andreossi

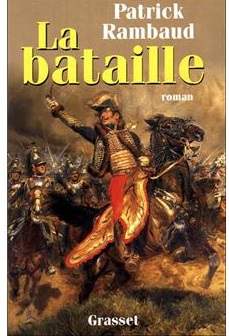

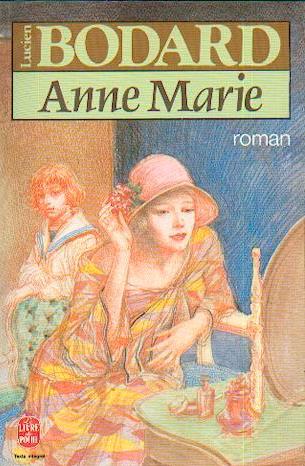
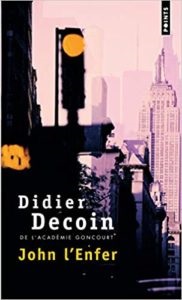
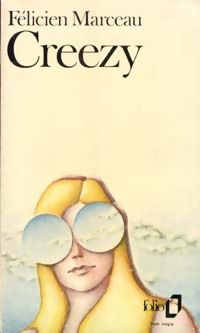
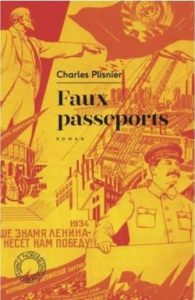 Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur.
Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur.
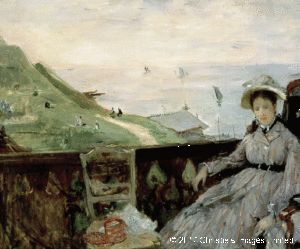


 Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France.
Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France.