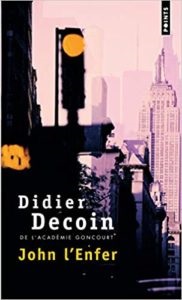
Le roman de Didier Decoin, prix Goncourt 1977, compte quatre personnages principaux : John l’Enfer, Amérindien laveur de carreaux sur les gratte- ciel, Ashton Mysha, Polonais officier de la marine marchande, Dorothy Kayne, sociologue urbaine, et la ville de New York, dans laquelle tout ce monde se retrouve dans une atmosphère de déliquescence manifeste.
Car la ville, dans ces années 70 du vingtième siècle, n’est pas en forme : « C’est la ville qui est vieille, crie Anderson. Elle tient plus sur ses pattes. Lui faites pas mal, l’Enfer. (…) L’un et l’autre ils ont vu la ville se contorsionner (…) Tous deux savent que la cité dissimule sous sa poussière et son clinquant une charpente qui se sclérose davantage de jour en jour ». Nos trois protagonistes épousent cette entropie urbaine : John et Ashton se retrouvent sans travail, Dorothy, à la suite d’un accident, perd la vue, au moins temporairement, et vit avec un bandeau sur les yeux en permanence.
Les deux hommes décident d’aider Dorothy dans son malheur et les trois vivent dans le même appartement, Ashton en tant qu’amant et John comme amoureux transi. La jeune femme elle-même semble subir les événements et elle n’est pas le personnage le plus crédible de l’affaire. Autour d’eux la ville continue de s’effriter, les immeubles pourrissent ou sont envahis par l’eau des canalisations qui éclatent, les clans politiques se déchirent, les chiens errants envahissent les rues. Sous la surface, la pourriture : le brillant animateur de télé se révèle graine de violeur.
Ce démantèlement finit par toucher les corps, non seulement ceux des laveurs de carreaux qui s’écrasent au sol mais aussi celui d’Ashton qui vend son corps à un médecin douteux qui récupèrera les morceaux, après un accident mortel, pour des greffes. Mais l’argent de la vente permet à nos trois amis de vivre luxueusement quelques temps.
Quel espoir dans cette ambiance si délétère ? John l’Enfer rêve d’un retour au passé : « S’il collait son oreille dans la poussière, le Cheyenne entendrait sous les massifs de Washington Square le souffle des eaux souterraines ébranlant les fondations de la ville à la manière d’une sève puissante. Parce qu’il y avait des rivières, ici ; des rivières et des forêts ; et ça revient du fond des temps, ça patiente, et ça s’empare- à la fin ».
Si l’on s’intéresse au devenir des personnages du roman, par contre l’auteur ne réussit pas complètement à nous faire ressentir le climat de délabrement urbain dont il nous parle. Il nous manque une écriture plus évocatrice, plus poétique.
Andreossi
John l’Enfer. Didier Decoin
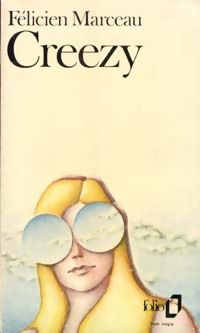
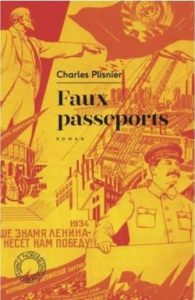 Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur.
Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur.
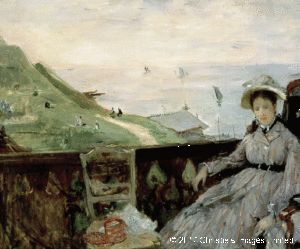


 Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France.
Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France. Chers lecteurs,
Chers lecteurs,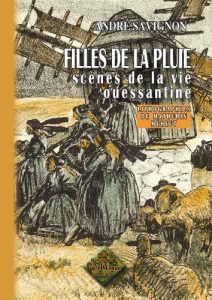 Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain.
Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain. Sans la voix du président du jury (en 1933, Rosny aîné), qui compte double, le Goncourt aurait échappé à André Malraux, au profit du roman Le roi dort, de Charles Braibant, totalement oublié depuis. Cela n’aurait sans doute pas empêché le succès de La condition humaine, dont la qualité ne fait pas de doute au lecteur d’aujourd’hui.
Sans la voix du président du jury (en 1933, Rosny aîné), qui compte double, le Goncourt aurait échappé à André Malraux, au profit du roman Le roi dort, de Charles Braibant, totalement oublié depuis. Cela n’aurait sans doute pas empêché le succès de La condition humaine, dont la qualité ne fait pas de doute au lecteur d’aujourd’hui.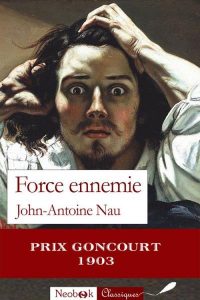 Verrait-on aujourd’hui le jury du prix Goncourt élire un roman publié à compte d’auteur, alors que les éditeurs rivalisent d’ardeur pour mettre en avant leurs favoris ? En 1903, à l’occasion du premier prix Goncourt, c’est pourtant ce qui est arrivé à John Antoine Nau. Et pour le moins à propos d’un livre fort original à divers points de vue.
Verrait-on aujourd’hui le jury du prix Goncourt élire un roman publié à compte d’auteur, alors que les éditeurs rivalisent d’ardeur pour mettre en avant leurs favoris ? En 1903, à l’occasion du premier prix Goncourt, c’est pourtant ce qui est arrivé à John Antoine Nau. Et pour le moins à propos d’un livre fort original à divers points de vue. Le feuilleton des prix Goncourt : c’est reparti ! Andreossi nous en livre cette semaine le 20ème épisode. Vous laisserez-vous tenter, ne serait-ce que pour échapper à la déferlante de la rentrée littéraire ? … Bonne lecture et à bientôt !
Le feuilleton des prix Goncourt : c’est reparti ! Andreossi nous en livre cette semaine le 20ème épisode. Vous laisserez-vous tenter, ne serait-ce que pour échapper à la déferlante de la rentrée littéraire ? … Bonne lecture et à bientôt !