
Le temps de la longue patience est celui de l’attente de la guerre en 1939, puis celui de l’occupation allemande. Michel Robida a obtenu le prix Fémina en 1946 pour ce roman qui conte l’histoire de la génération des hommes qui étaient enfants durant la première guerre mondiale et qui brutalement se trouvent confrontés à nouveau au même danger : « Quand nous étions enfants on nous disait déjà : ‘Dans vingt-cinq ans, il faudra remettre cela’. Nous avons toujours été menacés. Notre adolescence, notre jeunesse ont sans cesse été marquées par cette crainte, par cette certitude ».
Michel Robida, petit-fils du célèbre illustrateur Albert Robida, est entré dans la Résistance, a été arrêté par la gestapo et interné. Journaliste à la radio, il a écrit une dizaine de romans. Il nous fait donc vivre une expérience au moins en partie vécue à travers les portraits de deux amis aux trajectoires d’abord divergentes. Philippe est entrepreneur, bien installé dans la vie bourgeoise et marié. Au début du conflit, il est affecté à l’Etat major à Paris. Bernard part au front où il est blessé, et connaît une histoire d’amour avec Martine, jeune Suédoise, davantage curieuse que passionnée.
Ces trois figures représentent trois positions différentes face à l’envahisseur nazi. Philippe, dit-il, doit faire vivre son usine, il travaillera avec l’ennemi. Comme l’avoue son épouse après l’arrivée au pouvoir du maréchal Pétain : « Il n’y a qu’à faire comme tout le monde. C’est si simple. L’exemple nous vient d’en haut ». Bernard, sans fanfaronnade, entre doucement en Résistance. Martine, dont la nationalité lui assure la neutralité, reste assez détachée, un peu à la manière dont elle conçoit sa relation avec Bernard. Celui-ci rompt lorsqu’il apprend qu’elle a parlé à un Allemand : « Aucune des femmes, aucun des hommes de sa parenté, de son entourage, n’avaient jamais adressé la parole à un Allemand depuis l’occupation. Chacun vivait à côté d’eux sans les voir ».
Arrêté, Bernard tente l’évasion dans le convoi qui le conduit vers l’Allemagne, échoue, est blessé et meurt peu après, non sans avoir pu transmettre à Philippe son désir que celui-ci prenne sa place en résistance, ce qu’il fait effectivement.
Le roman se lit aisément, dans une écriture sans chichis, et surtout évite le pathos. Nous ne savons que très peu de choses sur les activités secrètes de Bernard, et l’appel à la lutte contre l’occupant est très discrètement évoqué. On comprend ainsi l’auteur lorsqu’il fait dire à un des protagonistes : « Je ne crois pas, dans la vie courante, à la grande scène tragique qui oppose soudain deux personnages jusque là occupés de leurs soucis, de leurs ennuis quotidiens ». Et aussi, au moment de l’exode de juin 1940 : « Le tragique était si intense qu’il n’avait pas besoin d’être souligné. Mais il se développait dans une gamme mineure, sûr et secret comme un chancre ».
Andreossi
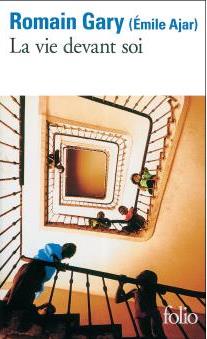
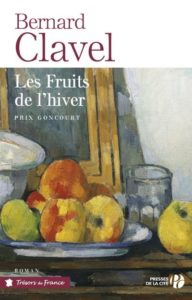 Il fait souvent froid dans le Jura de Bernard Clavel : Les Fruits de l’hiver, Goncourt 1968, sont ceux de l’occupation allemande, mais aussi ceux de la vieillesse du couple Dubois. En cinq chapitres plutôt lents, des premières difficultés à « fabriquer », comme on dit au pays, son bois de chauffage, jusqu’au lit de mort du père Dubois, diverses étapes du vieillissement nous sont décrites, dans un style « réaliste » qui ne parvient pas complètement à nous faire ressentir l’intimité du vieillir.
Il fait souvent froid dans le Jura de Bernard Clavel : Les Fruits de l’hiver, Goncourt 1968, sont ceux de l’occupation allemande, mais aussi ceux de la vieillesse du couple Dubois. En cinq chapitres plutôt lents, des premières difficultés à « fabriquer », comme on dit au pays, son bois de chauffage, jusqu’au lit de mort du père Dubois, diverses étapes du vieillissement nous sont décrites, dans un style « réaliste » qui ne parvient pas complètement à nous faire ressentir l’intimité du vieillir.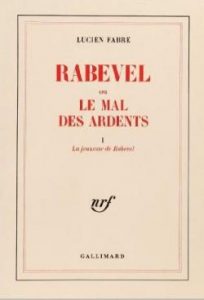 Alors que le prix Goncourt 2016 a été décerné cette semaine à Leïla Slimani pour « Chanson douce » (Gallimard), Andreossi a poursuivi pour nous la relecture des anciens Goncourt, avec le prix 1923.
Alors que le prix Goncourt 2016 a été décerné cette semaine à Leïla Slimani pour « Chanson douce » (Gallimard), Andreossi a poursuivi pour nous la relecture des anciens Goncourt, avec le prix 1923.  15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag
15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag

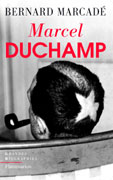 Marcel Duchamp est-il seulement celui qui renversa une pissotière pour en faire une fontaine ?
Marcel Duchamp est-il seulement celui qui renversa une pissotière pour en faire une fontaine ? Les Phéniciens sont connus pour avoir été le peuple de marchands et de navigateurs qui, au cours du 1er millénaire avant J.-C., depuis la côte du Levant (actuel Liban) aux côtes italiennes et espagnoles en passant par le nord de l’Afrique, la Sardaine, les îles égéennes, Malte et Chypre… a essaimé sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Leur civilisation garde pourtant, aujourd’hui encore, une part de mystère.
Les Phéniciens sont connus pour avoir été le peuple de marchands et de navigateurs qui, au cours du 1er millénaire avant J.-C., depuis la côte du Levant (actuel Liban) aux côtes italiennes et espagnoles en passant par le nord de l’Afrique, la Sardaine, les îles égéennes, Malte et Chypre… a essaimé sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Leur civilisation garde pourtant, aujourd’hui encore, une part de mystère.