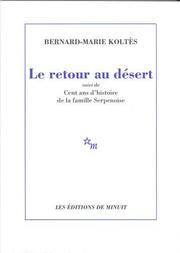 Le retour au désert, pièce de Bernard-Marie Koltès (1948-1989) fait cette saison son entrée au répertoire de la Comédie-Française dans une mise en scène réussie de son administratrice Muriel Mayette.
Le retour au désert, pièce de Bernard-Marie Koltès (1948-1989) fait cette saison son entrée au répertoire de la Comédie-Française dans une mise en scène réussie de son administratrice Muriel Mayette.
Ce fort et beau spectacle mérite vraiment d’être vu (voir le billet sur la pièce).
A ceux qui n’auront pas l’occasion d’assister à la représentation, on ne peut que conseiller d’en lire le texte, édité aux Editions de Minuit.
Le retour au désert est celui de Mathilde en province, dans une préfecture de l’est de la France, où elle vient ferrailler avec son passé, la bourgeoisie, la famille, son frère Adrien.
Dès le début de la pièce, qui met en scène les retrouvailles, Mathilde et Adrien ne parviennent pas à se saluer fraternellement. Très vite, les reproches débordent ; mais aussi, déjà, une sourde tendresse :
MATHILDE. – Tu es plus con qu’un gorille, Adrien. Tu préfères les caricatures, tu préfères les reproductions bon marché, la laideur à tout ce qui est beau et noble. Non, je ne la regarderai jamais comme ta femme. Marie est morte, tu n’as plus de femme.
ADRIEN. – Et toi, tu n’as pas plus de mari que moi de femme. D’où sortent-ils, ces deux-là ? Tu ne le sais pas toi-même. Ne me donne pas de leçon, Mathilde. Nous sommes frère et soeur, absolument. Bonjour, Mathilde, ma soeur.
MATHILDE. – Bonjour, Adrien.
ADRIEN. – Et moi qui croyais te retrouver avec la peau brunie et ridée comme une vieille Arabe. Comment fais-tu, avec ce foutu soleil d’Algérie, pour rester lisse et blanche ?
MATHILDE. – On se protège, Adrien, on se protège. Dis-moi, mon frère : tu ne te décides toujours pas à porter des chaussures ? Et quand tu sors, comment fais-tu ?
ADRIEN. – Je ne sors pas, Mathilde, je ne sors pas.
La gouvernante, Madame Queuleu assiste avec épouvante aux cris et déchirements de Mathilde et Adrien.
Dans les mots de Mme Queuleu, Koltes dresse un tableau cruel du silence, de la tranquillité, de l’étouffement de la province :
MME QUEULEU. – Eh bien, oui, frappez-vous, défigurez-vous, crevez-vous les yeux, qu’on en finisse. Je vais aller vous chercher un couteau, pour aller plus vite. Aziz, apporte-moi le grand couteau de la cuisine, et prends-en deux pour faire bonne mesure ; je les ai aiguisés ce matin, cela ira plus vite. Ecorchez-vous, griffez-vous, tuez-vous une bonne fois, mais taisez-vous, sinon je vous couperai moi-même la langue en la prenant à la racine au fond de vos gorges pour ne plus entendre vos voix. Et vous vous battrez en silence, du moins, personne n’en saura rien, et on pourra continuer à vivre. Car vous ne vous battez que par des mots, des mots, des mots inutiles qui fond du mal à tout le monde, sauf à vous. Ah, si je pouvais être sourde, tout cela ne me dérangerait pas. Car cela ne me dérange pas que vous vous battiez ; mais faites-le en silence, qu’on n’en sente pas les blessures, nous, autour de vous, dans notre corps et dans notre tête. Car vos voix deviennent chaque jour plus fortes et plus criardes, elles traversent les murs, elles font tourner le lait à la cuisine. Vivement le soir, quand vous boudez ; au moins, on peut travailler. Faites que le soleil se couche de plus en plus tôt, et qu’ils se détestent en silence. Moi, j’abandonne.
Mais les premières victimes de ce retour au désert, et de la relation passionnelle entre le frère et la soeur sont peut-être Fatima et Edouard, les enfants de Mathilde, et Mathieu, le fils d’Adrien :
FATIMA. – (…) Ton frère, il serait complètement à poil si tu le lâchais. Pourquoi ne veux-tu pas le lâcher ? Qu’est-ce que tu y gagnes, sinon de te désintéresser de tes enfants ? Car tu ne nous regardes même plus, tu es trop occupée à t’engueuler, et Edouard, le pauvre Edouard, a sa tête qui est en train de flancher, il y du jeu dans ses rivets, il ne marche pas droit et tu ne remarques rien. Tu t’en fous ?
Maman, je veux rentrer en Algérie. Je ne comprends rien aux gens d’ici. Je n’aime pas cette maison, je n’aime pas le jardin, ni la rue, ni aucune des maisons ni aucune des rues. Il fait froid la nuit, il fait froid le jour, le froid me fait peur davantage que la guerre.
Mathieu apprend qu’il va partir dans l’armée en Algérie. Dialogue très émouvant avec Aziz, le domestique :
AZIZ. – Tout le monde va à l’armée. Tu nais, tu têtes, tu grandis, tu fumes en cachette, tut te fais battre par ton père, tu vas à l’armée, tu travailles, tu te maries, tu as des enfants, tu bats tes enfants, tu vieillis et tu meurs plein de sagesse. Toutes les vies sont comme cela.
(…)
ADRIEN. – Comment c’est, l’Algérie ?
AZIZ. – J’ai oublié.
(…)
ADRIEN. – Et la guerre, comment c’est, Aziz ?
AZIZ. – Je ne sais pas, je ne l’ai jamais su, et je ne veux pas le savoir.
MATHIEU. – Moi non plus, je ne voudrais pas le savoir.
AZIZ. – Mon vieux Mathieu, ne sois pas triste. On ira ce soir chez Saïfi, tu oublieras ta tristesse.
MATHIEU. – Je ne veux pas oublier ma tristesse. Et la mort, comment c’est ?
AZIZ. – Comment veux-tu que je le sache ? Plus besoin d’argent, plus besoin de lit pour te coucher, plus de travail du tout, pas de souffrance, je suppose. Je suppose que ce n’est pas trop mal.
MATHIEU. – Je ne veux pas mourir.
Le retour au désert. Bernard-Marie Koltès
Les Editions de Minuit, 1988/2006
95 p., 8,50 €

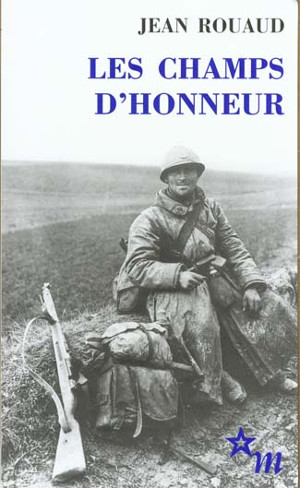 Pour vous souhaiter un joyeux Noël, un conseil de lecture réitéré : celui des Champs d’honneur de Jean Rouaud, qui avait été évoqué ici dans le cadre du feuilleton dédié aux prix Goncourt.
Pour vous souhaiter un joyeux Noël, un conseil de lecture réitéré : celui des Champs d’honneur de Jean Rouaud, qui avait été évoqué ici dans le cadre du feuilleton dédié aux prix Goncourt.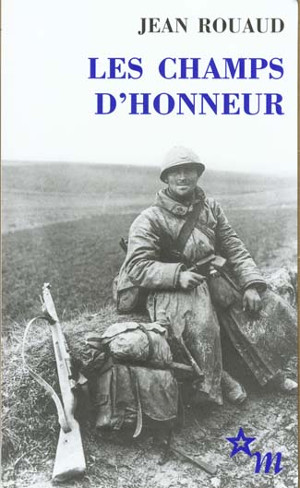
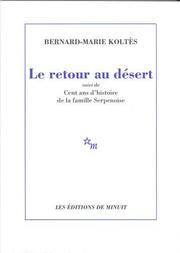 Le retour au désert, pièce de Bernard-Marie Koltès (1948-1989) fait cette saison son entrée au répertoire de la Comédie-Française dans une mise en scène réussie de son administratrice Muriel Mayette.
Le retour au désert, pièce de Bernard-Marie Koltès (1948-1989) fait cette saison son entrée au répertoire de la Comédie-Française dans une mise en scène réussie de son administratrice Muriel Mayette.