
C’est drôle la vie. On va au théâtre depuis tellement d’années qu’on n’ose pas les aligner pour les compter. On y va une fois de plus, presque sans y penser, et c’est comme si c’était la première fois.
Devant une salle aux trois-quarts vide pour cause de grève des transports, les comédiens entrent. A leur manière de le faire, entre lisière de salle et scène, de nous regarder, d’être éclairés, présents, il se passe déjà quelque chose.
La pièce commence : c’est un cours de paléoanthropologie (homo erectus, homo sapiens, homme de Néandertal etc.) et on adore. La mise en scène, magnifique, est tout de suite en place : ombre et lumière, noir et blanc et couleur, graphisme, ombres chinoises, écriture, images choisies.
Puis l’histoire en elle-même démarre : un homme a tué un nourrisson, s’est dénoncé pour être jugé. Mais il n’est pas sûr que ce soit un infanticide : l’enfant n’en était peut-être pas un, issu d’une espèce découverte en Afrique de l’Est, dont on ignore si elle est humaine ou animale. Quelle était la nature de la créature assassinée ? Le procès s’ouvre : c’est à la fois une enquête et un récit (celui des anthropologues), et c’est passionnant.
Des débats scientifiques – incapables de conclure – on passe au débat philosophique autour de la question fondamentale Qu’est-ce que l’Homme ?, et toutes ses tentatives de réponses autour du langage, de la conscience etc. On laissera le spectateur découvrir la réponse finalement proposée par la pièce, délivrée par l’homme de foi. On ne dira pas non plus si l’accusé est en définitive condamné pour infanticide ou pas.
Mais des questions par lesquelles ce spectacle aussi profond et vibrant qu’intelligent se termine, on observera que toutes n’étaient pas posées avec la même acuité il y a trente ans, et que la question fondamentale de la philosophie, face aux tentations d’amélioration infinie de l’Homme, semble être aujourd’hui Qu’est-ce que l’Homme veut veut faire de lui-même ?
Mag
ZOO ou l’assassin philanthrope,
Jusqu’au 12 avril 2022
Théatre de la Ville – Espace Cardin
D’après Zoo ou l’assassin philanthrope et Les animaux dénaturés de Vercors
Mise en Espace & Conception Emmanuel Demarcy-Mota
Collaboration Artistique Christophe Lemaire, Julie Peigné, François Regnault
Conseillers Scientifiques Carine Karachi, Jean Audouze
Scenographie Yves Collet
Lumières Christophe Lemaire, Yves Collet
Son Flavien Gaudon
Musiques Arman Méliès
Création vidéo Renaud Rubiano
Avec la Troupe du Théâtre de la Ville : Marie-France Alvarez, Nicolas Avinée, Charles-Roger Bour, Céline Carrère, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Anne Duverneuil, Sarah Karbasnikoff, Stéphane Krähenbühl, Ludovic Parfait Goma, Jackee Toto
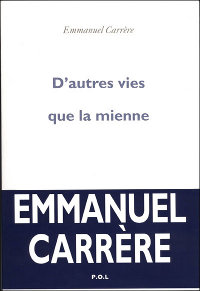 Ce récit autobiographique a au début le goût un peu amer du bonheur gâché : Emmanuel Carrère passe avec sa compagne et leurs enfants respectifs des vacances dans un hôtel luxueux au Sri Lanka.
Ce récit autobiographique a au début le goût un peu amer du bonheur gâché : Emmanuel Carrère passe avec sa compagne et leurs enfants respectifs des vacances dans un hôtel luxueux au Sri Lanka. Emmanuel Carrère, lassé d’écrire des histoires où il est question d’enfermement et de folie, désireux d’aller « vers le dehors, vers les autres, vers la vie » part en Russie pour y réaliser un reportage.
Emmanuel Carrère, lassé d’écrire des histoires où il est question d’enfermement et de folie, désireux d’aller « vers le dehors, vers les autres, vers la vie » part en Russie pour y réaliser un reportage.