 La jeune femme narratrice du prix Goncourt 1962 est un personnage attachant, bien qu’elle apparaisse assez compliquée à son entourage. On sait peu de choses sur elle, mais on sait l’essentiel : une douleur fondamentale, un deuil indépassable, qui lui font refuser les relations avec ceux qui l’approchent. C’est qu’elle est hantée par les fantômes de ses parents et de son ami, qu’elle a perdus en Pologne, durant la guerre.
La jeune femme narratrice du prix Goncourt 1962 est un personnage attachant, bien qu’elle apparaisse assez compliquée à son entourage. On sait peu de choses sur elle, mais on sait l’essentiel : une douleur fondamentale, un deuil indépassable, qui lui font refuser les relations avec ceux qui l’approchent. C’est qu’elle est hantée par les fantômes de ses parents et de son ami, qu’elle a perdus en Pologne, durant la guerre.
Elle consent à suivre pourtant celui qu’elle appelle le vieil homme, dont elle accepte l’amitié. Arrivés dans le Midi, leurs rapports changent. L’homme gentil et prévenant se découvre amoureux, et celle qu’il nomme Maria (on ne saura jamais son « vrai » prénom) le repousse et l’attire alternativement. Elle fait la connaissance sur la plage de trois « enfants », dont deux sont plutôt des adolescents, et s’attache à Anny, malheureuse en famille et qui finit par se suicider.
Maria navigue entre deux mondes, celui de son passé, avec ses morts qu’elle continue de fréquenter, et le monde du présent qui la désarçonne bien souvent. La difficulté à rester la survivante domine le récit : « Pour vous, maintenant, tout est facile, bien sûr. Mais moi ! Moi, me direz-vous ce que je dois faire ? Qu’est-ce qui m’oblige à me traîner ainsi de jour en jour, interminablement ? Et pourquoi me faut-il l’accepter ? Pour quelle raison ? Qui l’ordonne ? »
La question du temps est lancinante, et au moment de la rupture, d’avec le vieil homme et d’avec le temps des vacances prolongées dans le Midi, elle constate : « Voici un galet, lisse et froid, d’une teinte indéfinissable, que j’ai ramené de la plage –souvenir d’une enfance perdue que j’ai si vainement cherché à revivre l’été dernier. Une autre fuite pour n’avoir pas à payer mon évasion avec le vieil homme. Un jour, peut-être, n’aurai-je plus à me dérober, un jour je deviendrai peut-être semblable à un galet lisse et froid, oublié sur une plage, ayant enfin trouvé la forme parfaite pour échapper au temps ».
Anna Langfus est malheureusement une auteure oubliée. Polonaise ayant trouvé refuge à Paris après avoir subi les sévices de la Gestapo et connu l’extermination de sa famille, elle a eu une carrière littéraire courte (elle est morte à 46 ans) mais très appréciée à chaque sortie de ses trois romans. Ses pièces de théâtre ont aussi évoqué la Shoah. Le prix Goncourt ne permet pas toujours d’éviter l’oubli, mais peut parfois aider à redécouvrir.
Andreossi
Les bagages de sable, Anna Langfus
 Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre.
Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre. Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.
Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.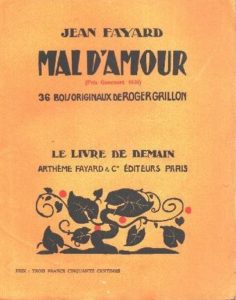 Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit…
Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit… Est-il une occasion plus merveilleuse de découvrir Alcina, de Haendel, que dans une telle production ? Difficile à imaginer. Le Théâtre des Champs-Elysées était plein à craquer ce vendredi soir pour cette deuxième représentation (sur quatre seulement), et le dense public n’a pas été déçu.
Est-il une occasion plus merveilleuse de découvrir Alcina, de Haendel, que dans une telle production ? Difficile à imaginer. Le Théâtre des Champs-Elysées était plein à craquer ce vendredi soir pour cette deuxième représentation (sur quatre seulement), et le dense public n’a pas été déçu. Un Philippe Jaroussky qui, pour en revenir à ce mémorable Alcina, partageait l’affiche avec l’immense star du lyrique Cecilia Bartoli. La belle romaine impressionna par une interprétation tout en subtilité de cette reine cruelle, particulièrement émouvante en amoureuse abandonnée par son amant dans le superbe « Ah, mio cor ! ». L’amant en question, Ruggiero, n’était autre que Philippe Jaroussky soi-même. Sa célèbre voix de contre-alto, d’une virtuosité époustouflante, séduit tant dans les solos que dans les ensembles avec les voix féminines, dont il faut signaler la mezzo Varduhi Abrahamyan dans le rôle de sa promise, Bradamante. Jouant d’abord un rôle d’homme pour dissimuler à Alcina sa véritable identité, elle révèle ensuite à Ruggiero qui elle l’est et le convainc de la suivre et d’abandonner la terrible Alcina. La plasticité et la suavité de sa voix la mettaient parfaitement à sa place au sein d’une distribution si enlevée.
Un Philippe Jaroussky qui, pour en revenir à ce mémorable Alcina, partageait l’affiche avec l’immense star du lyrique Cecilia Bartoli. La belle romaine impressionna par une interprétation tout en subtilité de cette reine cruelle, particulièrement émouvante en amoureuse abandonnée par son amant dans le superbe « Ah, mio cor ! ». L’amant en question, Ruggiero, n’était autre que Philippe Jaroussky soi-même. Sa célèbre voix de contre-alto, d’une virtuosité époustouflante, séduit tant dans les solos que dans les ensembles avec les voix féminines, dont il faut signaler la mezzo Varduhi Abrahamyan dans le rôle de sa promise, Bradamante. Jouant d’abord un rôle d’homme pour dissimuler à Alcina sa véritable identité, elle révèle ensuite à Ruggiero qui elle l’est et le convainc de la suivre et d’abandonner la terrible Alcina. La plasticité et la suavité de sa voix la mettaient parfaitement à sa place au sein d’une distribution si enlevée.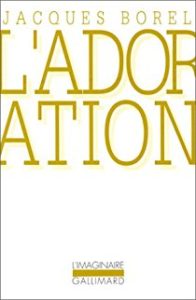 Une grosse autobiographie a eu les honneurs du Goncourt 1965. Ce discours sur soi ne manque pas d’intérêt et l’écriture est impeccable, faite de phrases longues et bien balancées. Bien sûr le lecteur intéressé souscrit aux lois du genre : une vie présentée comme un roman qui serait vrai, hypothèse qui demande d’accepter ce qui n’est, au bout du compte, que l’épanouissement d’un ego sans possibilité de confirmation par les autres protagonistes du roman.
Une grosse autobiographie a eu les honneurs du Goncourt 1965. Ce discours sur soi ne manque pas d’intérêt et l’écriture est impeccable, faite de phrases longues et bien balancées. Bien sûr le lecteur intéressé souscrit aux lois du genre : une vie présentée comme un roman qui serait vrai, hypothèse qui demande d’accepter ce qui n’est, au bout du compte, que l’épanouissement d’un ego sans possibilité de confirmation par les autres protagonistes du roman. Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence.
Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence. On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis.
On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis.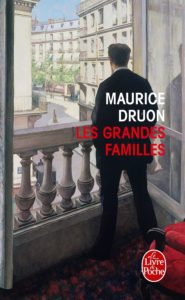 Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.
Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer. Il y a trois ans, on avait beaucoup aimé, du même auteur, Comment vous racontez la partie vue dans ce même théâtre du Rond-Point à Paris. Le propos y était corrosif, la mise en scène efficace, le jeu des acteurs excellent.
Il y a trois ans, on avait beaucoup aimé, du même auteur, Comment vous racontez la partie vue dans ce même théâtre du Rond-Point à Paris. Le propos y était corrosif, la mise en scène efficace, le jeu des acteurs excellent. Autour d’elle, dans une atmosphère devenue étouffante et tendue à l’extrême, chacun des personnages sent le sol tanguer sous ses pieds, Boris-le-sans-vaillance vacille sous la menace d’une liquidation judiciaire, Yvonne la veuve a toujours peur d’avoir perdu son sac devenu, avec son petit calepin dedans, son (seul) compagnon. Quant au couple d’amis, il finit par céder aussi, abandonnant son souci du prochain et sa bien-séance de bon aloi, remuant la vieille mère, jetant le dessert du grand restaurant, se dessoudant un instant… La Bella figura finit par craquer de toute part. Seule Andrea, assurément la plus esseulée de tous, parvient, grâce à son apparence de légèreté et de fantaisie, à continuer à faire Belle figura. Et apparaît en définitive comme la plus lucide de tous.
Autour d’elle, dans une atmosphère devenue étouffante et tendue à l’extrême, chacun des personnages sent le sol tanguer sous ses pieds, Boris-le-sans-vaillance vacille sous la menace d’une liquidation judiciaire, Yvonne la veuve a toujours peur d’avoir perdu son sac devenu, avec son petit calepin dedans, son (seul) compagnon. Quant au couple d’amis, il finit par céder aussi, abandonnant son souci du prochain et sa bien-séance de bon aloi, remuant la vieille mère, jetant le dessert du grand restaurant, se dessoudant un instant… La Bella figura finit par craquer de toute part. Seule Andrea, assurément la plus esseulée de tous, parvient, grâce à son apparence de légèreté et de fantaisie, à continuer à faire Belle figura. Et apparaît en définitive comme la plus lucide de tous.


 Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.
Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.