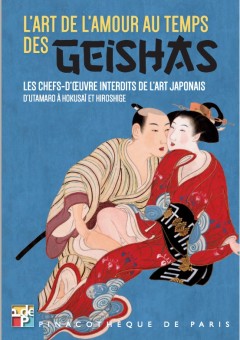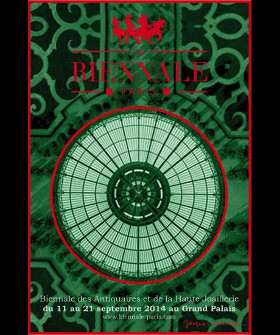Ils sont dix comédiens, huit femmes, deux hommes. Leurs corps ne sont pas canoniques ; ils expriment d’où ils viennent. Des hommes bruns et ramassés. Des femmes aux cuisses larges, dont les visages et les chairs ont vécu. Ils sont peut-être de Palerme, cette ville de Sicile où Emma Dante, auteur, metteur en scène, a créé sa compagnie à la fin des années 1990. Une ville pauvre, des vies de misère, où la famille est la seule richesse. Où on mêle à la pasta la seule aubergine qui reste, coupée en finissimes tranches, pour nourrir les sept sœurs et leur père. Parce que la mère, elle n’est plus là. Elle reviendra, un moment, spectre blanc et riant, pour embrasser avec tendresse son mari qui manque d’air depuis qu’elle est partie. Car ici les vivants sont en noir et les défunts en blanc. Qu’elle est cruelle la Camarde, qui laisse les filles orphelines et emporte les enfants qui jouent dans la mer ou à Diego Maradona.
Mais elles rient, quand même, les sœurs Macaluso, elles rient à perdre la raison, et elles chantent. Parce qu’un jour, un seul jour, elles sont allées à la mer. Et elles étaient si heureuses d’y aller. Le jour tant attendu a finalement été tragique, et les déchire encore, mais le souvenir de la joie de l’attente, de la joie de l’instant d’avant les fait encore rire et chanter. Et danser aussi, sur ces airs mélancoliques et beaux qui rappellent cette mer si brillante « parce que le soleil s’y cogne dedans », rendent la joie plus grande et la tristesse plus douce. C’est plus que joué, c’est incarné, terriblement vivant sur un plateau nu et dans un temps très ténu. C’est du grand et beau théâtre.
« Le Sorelle Macaluso »
Au théâtre du Rond-Point à Paris
De Emma Dante
Avec Serena Barone, Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Italia Carroccio, Davide Celona,Marcella Colaianni, Alessandra Fazzino, Daniela Macaluso, Leonarda Saffi, Stéphanie Taillandier
Production et diffusion : Aldo Miguel Grompone
Coproduction : Teatro Stabile di Napoli, Festival d’Avignon, Théâtre National / Bruxelles,
Folkteatern / Göteborg, en collaboration avec la compagnie Atto Unico /Sud Costa
Occidentale, en partenariat avec le Teatrul National Radu Stanca / Sibiu.
Spectacle créé dans le cadre du projet Villes en scène / Cities on stage, avec le soutien du
Programme Culture de l’Union Européenne.
En italien et palermittan et surtitré en français
Durée 1 h 10
Jusqu’au 25 janvier 2015
Puis en tournée :
les 28 et 29 janvier 2015 à Montluçon, Le Fracas
les 27 et 28 mai 2015 à Aix-en-Provence, Opéra Pavillon Noir
les 30 et 31 mai 2015 à Toulon, Théâtre Liberté
Spectacle créé pour la 68ème édition du Festival d’Avignon