Même si l’espace de la galerie Sud-Est, aménagé tout en longs halls, est davantage propice à l’accueil d’un public nombreux qu’à la confidentialité, c’est une approche intimiste du travail de Raymond Depardon que le Grand Palais propose juqu’au 10 février prochain.
En 150 tirages, dont quelques très grands formats, le parcours montre le travail en couleurs du célèbre photographe-documentariste français, permettant de revisiter quelques cinquante ans de carrière autour de moments forts.

La couleur l’accompagne dès ses débuts : le Garet, à Villefranche-sur-Saône, ferme familiale où il a grandi. « J’ai photographié les canards, le berger allemand, tout ce qui m’entourait. Ma maman aussi, mais pas ou très peu mon père », se souvient-il. Bien plus tard, il reviendra dans ces petites exploitations de moyenne montagne et, dans ses films documentaires, donnera la parole à ses habitants, comme Marcel Privat, dont on voit une photo ici, à côté de celles du Garet.
Il débarque à Paris en 1958. Il a seize ans. Très vite, il photographie Edith Piaf, des starlettes de l’époque, dont certaines sont depuis devenues des stars, comme Catherine Deneuve. Puis viendront les reportages, le Sahara au début des années 1960, le Chili pour le premier anniversaire de l’élection du président Salvador Allende en 1971, Beyrouth en pleine guerre civile en 1978, Glasgow en 1980.
« De la fin des années 50 au début des années 80, je faisais de la couleur parce qu’il fallait faire de la couleur mais je ne pensais pas en couleurs. J’ai laissé partir ces images dans un flux et disparaître. J’ai eu la révélation de la couleur en 1984, au moment de la mission de la DATAR qui avait pour objectif de dresser un portrait de la France. J’ai accepté en hommage à mon père et en repensant à la souffrance qu’il éprouva lors de la construction de l’autoroute qui allait amputer la ferme du Garet d’une partie de ses terres et anéantir le travail de toute une vie. Il y avait dans la cour de la ferme le tracteur rouge de mon frère et la mobylette bleue de Nathalie, ma nièce. Et tout à coup, la couleur m’est apparue comme une évidence », explique-t-il.
Délaissant ensuite la couleur, il n’y reviendra que dans les années 2000, à l’occasion de commandes pour la Fondation Cartier pour l’art contemporain, dont la dernière Terre natale, ailleurs commence ici est évoquée avec le cliché de deux jeunes amazoniennes, commenté par le photographe : « Elles se sont placées face à la caméra, dans leur langue, elles ont dit le bien-être de la forêt, de la rivière, de la pêche, des poissons sains pour leurs enfants. Elles ont parlé de leur colère contre les gens d’ailleurs qui arrivent avec tous leurs déchets. En quelques minutes, elles avaient tout dit, il n’y avait rien à rajouter ».
On peut ajouter à ces travaux celui sur la France, mené à partir de 2004 (La France de Depardon, exposé à la BNF en 2010), auquel la photographie d’un commerce à la grille tirée, à Nérac dans le Lot-et-Garonne fait forcément penser.
C’est à l’occasion de ces reportages que Raymond Depardon s’est plu à photographier en couleurs des lieux sans événement, et des personnes qui s’y trouvaient : une jeune fille sans domicile qui prend le soleil en Argentine, des femmes dans leurs tenues colorées au Tchad, une terrasse de café bien rouge à Paris… Il aime capturer les couleurs de ce et ceux qu’il croise au fil de ses pérégrinations solitaires. C’est ce plaisir-là qu’il qualifie de « moment si doux », et qui donne son titre à cette exposition si personnelle.
Raymond Depardon, Un moment si doux
Grand Palais, Galerie Sud-Est – entrée av. W. Churchill – Paris 8ème
TLJ sf le mar. de 10 h à 20 h, nocturne le mer. jsq 22 h
Entrée 11 euros (tarif réduit 8 euros)
Jusqu’au 10 février 2014



 En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre).
En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre).
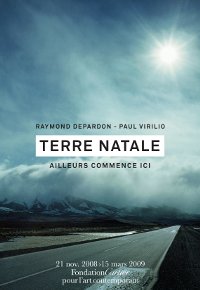
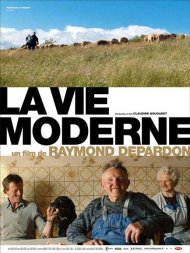 Ce sont des routes désertées, au milieu de paysages magnifiques mais qui ne sont pas là pour ça. Au bout du bout, ce sont des hameaux de pierre qui semblent avoir été toujours là.
Ce sont des routes désertées, au milieu de paysages magnifiques mais qui ne sont pas là pour ça. Au bout du bout, ce sont des hameaux de pierre qui semblent avoir été toujours là.